Discover Pourquoi donc ?
Pourquoi donc ?
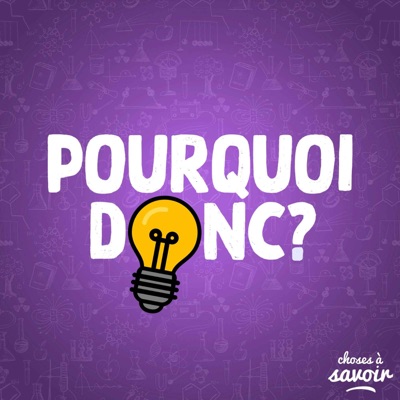
Pourquoi donc ?
Author: Choses à Savoir
Subscribed: 4,674Played: 349,914Subscribe
Share
© Choses à Savoir
Description
Je réponds de façon claire et directe à toutes les questions essentielles, en une minute chrono !
Si vous cherchez le podcast Petits Curieux, c'est par ici: https://chosesasavoir.com/podcast/petits-curieux-2/
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
943 Episodes
Reverse
Le “gang des 40 éléphants” est l’un des groupes criminels les plus fascinants — et les plus méconnus — de l’histoire britannique. Actif à Londres du XIXᵉ siècle jusqu’aux années 1950, ce gang est unique pour une raison majeure : il était entièrement composé de femmes, organisées, redoutablement efficaces, et capables de tenir tête à la police comme aux grands syndicats du crime.Leur nom vient du quartier Elephant and Castle, au sud de Londres, où beaucoup d’entre elles vivaient. Dès le départ, elles se spécialisent dans un domaine précis : le vol à l’étalage, mais à une échelle industrielle. À une époque où les magasins se multiplient et où la surveillance est encore rudimentaire, les “40 Elephants” deviennent maîtres dans l’art de dérober des objets de luxe.Pour cela, elles mettent au point des techniques inédites. Elles portent sous leurs jupes ou manteaux des vêtements spécialement cousus pour cacher bijoux, soieries ou parfums. Certaines robes sont équipées de poches secrètes qui permettent de faire disparaître des marchandises en quelques secondes. D’autres membres ont des rôles précis : espionner les routines des vendeurs, distraire les employés ou transporter les biens volés hors de Londres.Ce gang est également unique par son organisation interne, très moderne pour l’époque. Il fonctionne avec une hiérarchie claire, des règles strictes et même un système de solidarité : si une membre est arrêtée, le groupe l’aide à payer avocats et amendes. Certaines dirigeantes deviennent légendaires, comme Alice Diamond, surnommée “Diamond Annie”, connue pour sa taille imposante, ses bagues en diamants… et son autorité sans partage.Le gang se distingue aussi par sa longévité exceptionnelle. Alors que la plupart des groupes criminels disparaissent en quelques années, les 40 Elephants prospèrent pendant presque un siècle. Elles s’adaptent sans cesse : dans les années 1920, elles étendent leurs activités au cambriolage de maisons riches, au racket ou à la revente de marchandises sur un véritable marché parallèle.Enfin, leur singularité tient au contexte social. À une époque où les femmes ont peu de droits, peu d’argent et peu d’indépendance, ce gang représente un phénomène rare : un réseau féminin puissant, organisé et redouté, contrôlant une partie de la criminalité londonienne.Le gang des 40 éléphants reste ainsi unique : un mélange de ruse, d’audace, d’organisation et de résistance aux normes sociales. Un chapitre surprenant et encore trop peu connu de l’histoire criminelle européenne. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
En mai 2014, un événement inédit a secoué le monde bancaire : BNP Paribas, première banque française, a accepté de payer une amende colossale de 8,97 milliards de dollars au gouvernement américain. Le motif ? La banque avait contourné les embargos imposés par les États-Unis à Cuba, l’Iran et le Soudan entre 2004 et 2012. Ces pays étaient considérés par Washington comme des États soutenant le terrorisme ou violant les droits humains.Quels faits étaient reprochés exactement ? BNP Paribas avait réalisé, via certaines filiales, des transactions en dollars pour le compte de clients liés à ces pays. Or, toute opération en dollars transitant à un moment donné par le système financier américain est soumise à la législation des États-Unis. Cela signifie que même une banque étrangère peut être poursuivie à partir du moment où elle utilise la monnaie américaine. C’est l’un des points clés de ce dossier.La banque a reconnu avoir non seulement effectué ces paiements, mais parfois mis en place des procédures visant à masquer l’identité des clients ou l’origine réelle des fonds pour éviter les contrôles américains. Sur le plan du droit américain, la sanction était donc légale : la banque avait violé les règles de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui encadre les embargos.Là où le dossier devient explosif, c’est sur le plan du droit international. Beaucoup d’experts et de gouvernements ont dénoncé une sanction « extraterritoriale ». Autrement dit, les États-Unis appliquent leurs lois à des entités étrangères, opérant hors de leur territoire, simplement parce qu’elles utilisent la monnaie américaine ou un serveur situé aux États-Unis. Pour nombre de juristes, cela revient à imposer au reste du monde la politique étrangère américaine.Les critiques soulignent que BNP Paribas n’a pas violé le droit français ni le droit international, et que les embargos américains n’engageaient que les États-Unis. Pourtant, Washington a considéré que l’utilisation du dollar suffisait à justifier son intervention. Ce type de sanction a depuis été utilisé contre de nombreuses entreprises européennes, provoquant un réel malaise diplomatique.L’affaire BNP a ainsi mis en lumière un rapport de force : les États-Unis disposent d’une arme économique puissante — le contrôle du dollar — qui leur permet d’étendre leur influence bien au-delà de leurs frontières. Elle a également relancé le débat sur la souveraineté européenne et la capacité du continent à protéger ses entreprises des pressions américaines.Une sanction financière, donc, mais aussi un choc géopolitique. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
L’expression française « noyer le poisson » signifie détourner l’attention, embrouiller volontairement une explication ou éviter de répondre franchement à une question. Mais l’image, elle, provient d’un geste très concret… et très ancien.À l’origine, l’expression appartient au monde de la pêche. Avant l’industrialisation, les poissons fraîchement pêchés étaient conservés vivants dans un seau ou une cuve d’eau. Lorsqu’un poissonnier voulait vendre un poisson abîmé, déjà mourant ou de mauvaise qualité, une petite astuce consistait à… le plonger dans beaucoup d’eau et le brasser. Le mouvement de l’eau donnait l’illusion d’un animal encore vif. En « noyant » littéralement le poisson sous un flot d’eau, on masquait sa faiblesse pour tromper l’acheteur.Très vite, cette image est devenue métaphorique : on « noie le poisson » quand on crée un flux d’informations, de paroles ou de détails pour dissimuler l’essentiel, comme l’eau qui dissimule l’état réel de l’animal.L’expression apparaît dans la langue au XVIIIᵉ siècle, période où la pêche fraîche est très présente dans les villes. Les dictionnaires du XIXᵉ siècle confirment déjà son sens figuré : « embarrasser une affaire au point de la rendre inextricable » ou « fatiguer un adversaire en l’empêchant d’y voir clair ».On y voit aussi un lien avec la rhétorique politique : lorsqu’un orateur répond par des détours, qu’il multiplie les digressions ou qu’il ajoute des détails superflus pour éviter une réponse directe, il « noie le poisson ».En somme : noyer le poisson, c’est noyer la vérité.Le mot « snob » apparaît en Angleterre à la fin du XVIIIᵉ siècle, mais son origine reste l’un de ces petits mystères linguistiques savoureux. L’explication la plus souvent citée renvoie aux universités britanniques, notamment Oxford et Cambridge. À l’époque, on inscrivait parfois les étudiants issus de familles modestes en notant à côté de leur nom l’abréviation s.nob., pour sine nobilitate, c’est-à-dire « sans noblesse ».Ces étudiants, exclus des privilèges aristocratiques, auraient parfois essayé d’imiter les attitudes, les goûts et les codes de la haute société pour paraître plus distingués. Peu à peu, « snob » aurait désigné quelqu’un qui singeaient les élites, qui voulait paraître plus important qu’il ne l’était réellement.Une autre explication, moins académique mais amusante, affirme que snob viendrait du vieux dialecte anglais snob, qui signifiait « cordonnier » ou « roturier ». Là encore, l’idée de quelqu’un de modeste cherchant à imiter les classes supérieures se retrouve.Dans tous les cas, au XIXᵉ siècle, le mot prend son sens moderne : une personne qui admire exagérément ce qu’elle croit supérieur, qui méprise ce qu’elle juge vulgaire, ou qui s’efforce d’adopter les comportements « à la mode ».Aujourd’hui, dire de quelqu’un qu’il est « snob », c’est dire qu’il préfère l’apparence au naturel, et la distinction au bon sens. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Dans toute l’histoire du prix Nobel, deux hommes seulement ont pris la décision — libre, assumée, publique — de refuser l’une des distinctions les plus prestigieuses au monde : Jean-Paul Sartre en 1964 et Lê Duc Tho en 1973. Deux refus très différents, mais qui disent chacun quelque chose d’essentiel sur leur époque et sur leurs convictions.Le premier à franchir ce pas radical est Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain français, figure majeure de l’existentialisme. En 1964, l’Académie suédoise lui décerne le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. La réaction de Sartre est immédiate : il refuse le prix. Non par modestie, mais par principe. Sartre a toujours refusé les distinctions officielles, estimant que l’écrivain doit rester libre, non récupéré par le pouvoir, les institutions ou la notoriété. Pour lui, accepter un prix comme le Nobel reviendrait à « devenir une institution », ce qui contredisait son engagement politique et intellectuel.Il avait d’ailleurs prévenu l’Académie, avant même l’annonce, qu’il ne souhaitait pas être nommé. Cela ne change rien : il est proclamé lauréat malgré lui. Sartre refuse alors publiquement, dans un geste retentissant. Ce refus est souvent perçu comme l’expression ultime d’une cohérence : l’écrivain engagé qui refuse d’être couronné. Ce geste, unique dans l’histoire de la littérature, marque durablement la réputation du philosophe, admiré ou critiqué pour son intransigeance.Neuf ans plus tard, c’est au tour de Lê Duc Tho, dirigeant vietnamien et négociateur lors des Accords de Paris, de refuser le prix Nobel de la paix. Le prix lui est attribué conjointement avec l’Américain Henry Kissinger pour les négociations qui auraient dû mettre fin à la guerre du Vietnam. Mais pour Lê Duc Tho, il n’y a pas de paix à célébrer. Les hostilités se poursuivent, les bombardements aussi. Refuser le Nobel devient alors un acte politique : il déclare ne pouvoir accepter un prix de la paix tant que la paix n’est pas réellement obtenue.Contrairement à Sartre, son refus n’est pas motivé par un principe personnel, mais par une analyse de la situation géopolitique. Son geste est moins philosophique que stratégique, mais tout aussi historique. Il reste le seul lauréat de la paix à avoir décliné le prix.Ces deux refus, rares et spectaculaires, rappellent que le prix Nobel, pourtant considéré comme l’une des plus hautes distinctions humaines, peut devenir un terrain d’expression politique ou morale. Sartre par conviction, Lê Duc Tho par cohérence historique : deux gestes, deux époques, deux refus qui ont marqué l’histoire du prix. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
L’effet idéomoteur est l’un de ces phénomènes fascinants où le cerveau déclenche des mouvements… alors que nous sommes persuadés de ne pas bouger. Il s’agit de micro-contractions musculaires involontaires, déclenchées non par une décision consciente, mais par nos attentes, nos émotions ou nos représentations mentales. Mis en lumière au XIXᵉ siècle par le médecin William Carpenter, ce mécanisme explique une étonnante quantité de phénomènes considérés comme « paranormaux ».Notre cerveau fonctionne comme une machine à anticiper. Lorsqu’on pense à un mouvement — même aussi vaguement que « ça pourrait bouger » — le cerveau active discrètement les circuits moteurs associés. Le geste est minuscule, parfois à peine mesurable, mais il est suffisant pour donner l’illusion qu’une force extérieure agit. En d’autres termes : imaginer un mouvement, c’est déjà commencer à le produire.Un exemple particulièrement éclairant est celui du pendule divinatoire. Beaucoup de personnes affirment que leur pendule répond à leurs questions en oscillant vers “oui”, “non”, ou en dessinant des cercles mystérieux. Pourtant, des expériences menées en laboratoire montrent que ces oscillations dépendent directement des attentes du participant. Si l’on bande les yeux du sujet ou qu’on truque la question pour qu’il n’ait aucune idée de la réponse, les mouvements se stabilisent ou disparaissent presque totalement. C’est la conviction intérieure — « le pendule va bouger dans cette direction » — qui provoque de minuscules contractions musculaires dans les doigts, amplifiées par le poids de la chaîne. Le résultat semble magique… mais il ne l’est pas : c’est le cerveau qui pilote la main sans en avertir la conscience.Le même mécanisme est à l’œuvre dans l’écriture automatique. Une personne tient un stylo, se détend, se concentre sur l’idée qu’une “voix” pourrait s’exprimer à travers elle. Très vite, le stylo glisse, trace des mots, parfois des phrases entières. Pourtant, ce ne sont pas des esprits : les pensées, même floues, activent les zones motrices du cerveau. Les mouvements sont initiés par la personne elle-même, mais à un niveau tellement inconscient qu’elle a l’impression d’être guidée.Ce qui rend l’effet idéomoteur si passionnant, c’est qu’il montre une vérité déroutante : nous ne maîtrisons pas totalement nos gestes, et notre cerveau peut créer des illusions d’agency — cette impression qu’une force extérieure agit à notre place. C’est un rappel spectaculaire de la puissance de nos attentes, et de la manière dont notre esprit peut devenir son propre illusionniste. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le symbole de la pharmacie — une croix verte lumineuse — est aujourd’hui tellement familier qu’on a l’impression qu’il a toujours existé. Pourtant, son origine est récente, et elle mêle histoire médicale, héritages religieux et stratégie de communication.1. Aux origines : la croix… mais pas vertePendant longtemps, en Europe, le symbole associé aux apothicaires n’était pas la croix verte, mais plutôt :le caducée (bâton surmonté d’un serpent),ou le symbole du bowl of Hygieia (coupe et serpent).La croix, elle, vient du christianisme. Au Moyen Âge, de nombreux soins sont prodigués par les ordres religieux : moines, religieuses, hôpitaux rattachés aux monastères. La croix devient alors un signe associé aux soins, aux remèdes et à la compassion.2. La croix verte apparaît au XIXᵉ siècleAu XIXᵉ siècle, chaque pays cherche à uniformiser l'identification des pharmacies. Certains utilisent une croix rouge… mais un problème survient : en 1863, la Croix-Rouge adopte officiellement ce symbole pour ses actions humanitaires. Pour éviter toute confusion — notamment en temps de guerre — les pharmaciens doivent trouver un autre signe.C’est alors qu’apparaît :la croix verte en France,la croix verte ou bleue selon les pays européens.Le choix du vert n’est pas religieux : c’est un choix symbolique. Le vert évoque :la nature,les plantes médicinales,la guérison,la vie,et même l’espérance.À une époque où la pharmacie repose encore beaucoup sur la botanique, la couleur paraît parfaite.3. Une norme française devenue un standard européenAu début du XXᵉ siècle, la croix verte s’impose progressivement en France grâce aux syndicats professionnels. Elle devient un repère visuel simple et efficace, facilement lisible dans la rue, puis se modernise :s’allume en néon dans les années 1950,devient animée (clignotante, rotative),puis numérique dans les années 2000, capable d’afficher température, heure ou animations.Aujourd’hui, la croix verte est adoptée dans une grande partie de l’Europe, même si certains pays gardent leur propre symbole (par exemple le « mortar and pestle » aux États-Unis).4. Un symbole fort, entre science et traditionAu final, la croix verte résume parfaitement la philosophie de la pharmacie : un héritage ancien (la croix), réinterprété de manière moderne (le vert) pour afficher à la fois soins, science et plantes médicinales.C’est cette combinaison qui explique que la croix verte soit devenue l’un des symboles médicaux les plus reconnus au monde. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
La phrase « On ne naît pas femme, on le devient », écrite par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe (1949), est devenue l’une des formules les plus célèbres de la pensée moderne. À elle seule, elle résume une révolution intellectuelle qui a profondément transformé la compréhension du genre, de l’égalité et du féminisme.À l’époque, on considère largement que les différences entre hommes et femmes sont « naturelles » : tempéraments, talents, rôles sociaux, tout serait fixé par la biologie. Cette vision justifie l’exclusion des femmes de nombreux domaines : vie politique, travail, création artistique, autonomie financière. De Beauvoir brise ce discours en affirmant que la « féminité » n’est pas un destin biologique mais une construction sociale.Sa phrase signifie que les femmes deviennent femmes parce qu’on les forme, les éduque, les habille, les oriente et parfois les contraint à adopter certains comportements et rôles. Une petite fille n’a pas « naturellement » envie de jouer à la poupée ou de devenir douce et effacée : elle est socialisée pour répondre à ces attentes. La société, la famille, l’école, la culture, les religions façonnent ce qu’elle « doit » être.Cette idée renverse un ordre millénaire. Si les différences sont construites, alors elles ne sont pas immuables : elles peuvent être changées, contestées, déconstruites. De Beauvoir ouvre ainsi la voie au féminisme contemporain, qui analyse comment les normes sociales fabriquent les inégalités.La force de cette phrase tient aussi à sa clarté. En quelques mots, elle met en lumière ce que les chercheuses appelleront plus tard la distinction entre sexe (biologique) et genre (social). Elle anticipe de plusieurs décennies les débats actuels sur l’identité, la performativité du genre et les stéréotypes.Sa réception en 1949 est explosive. Le livre choque, autant par son diagnostic que par sa liberté de ton. La phrase est accusée de nier la nature féminine, voire la maternité. En réalité, elle dit autre chose : que rien dans le corps des femmes ne justifie leur subordination.Depuis, cette formule est devenue un slogan, un symbole, presque un repère philosophique. Elle est citée dans les manuels scolaires, les mouvements militants, les universités et la culture populaire. Elle reste aujourd’hui un point de départ essentiel pour comprendre les mécanismes de domination, mais aussi pour réfléchir à la manière dont chacun peut construire son identité.C’est cette puissance explicative, politique et symbolique qui fait de « On ne naît pas femme, on le devient » l’une des phrases les plus emblématiques du XXᵉ siècle. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Messaline, épouse de l’empereur Claude au Ier siècle, est restée dans la mémoire collective comme l’une des femmes les plus sulfureuses de l’Antiquité. Sa réputation – largement façonnée par les auteurs antiques comme Tacite, Suétone et Juvénal – repose sur l’idée d’une impératrice nymphomane, manipulatrice et dangereuse.Mais derrière la légende, une réalité s’impose : refuser une relation sexuelle avec Messaline pouvait être… mortel.Pourquoi ?Parce que Messaline n’était pas seulement la femme de l’empereur. Elle était l’autorité suprême au palais, la maîtresse du pouvoir intime. Dans une cour impériale où tout reposait sur l’opportunisme, la peur et les jeux d’alliances, contrarier la volonté de l’impératrice revenait à se mettre en danger politique direct.1. Elle disposait d’un pouvoir réelMême si Claude semblait lointain et souvent manipulé, Messaline contrôlait les faveurs, les nominations et l'accès à l'empereur. Elle faisait et défaisait des carrières.Elle fit, par exemple, exécuter le sénateur Appius Silanus après l'avoir piégé dans un faux complot.Si elle pouvait faire éliminer un aristocrate puissant, qu’en était-il d’un simple citoyen qui lui résistait ?2. Les auteurs antiques la présentent comme vindicativeLes sources – biaisées mais concordantes – montrent une femme qui punissait ceux qui lui déplaisaient. Juvénal raconte qu’elle se rendait de nuit dans les lupanars sous un pseudonyme, et qu’elle exigeait des hommes qu’elle avait choisis qu’ils se soumettent, sous peine de représailles. Même si cela relève en partie du discours moraliste romain, cela reflète bien l’image qu’avaient les contemporains : Messaline n’était pas quelqu’un à contrarier.3. Refuser, c’était l’humilier publiquementDans une société romaine obsédée par le statut, faire perdre la face à l’impératrice revenait à la menacer symboliquement. Or l’humiliation, dans une cour impériale, était souvent suivie d’une répression.Un refus pouvait être interprété non comme un choix personnel, mais comme un acte politique, presque une offense envers l’empereur lui-même.4. La fin de Messaline montre l’étendue de son pouvoirAvant sa chute en 48, elle avait osé se remarier publiquement avec Caïus Silius, un patricien en vue — un acte qui aurait été impensable si elle n'avait pas accumulé un pouvoir démesuré. Pour Juvénal, elle “régnait” littéralement dans le palais.Cela illustre pourquoi personne n’osait lui dire non : elle pouvait tout prendre, et tout faire tomber. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le mot “tong” vient… d’un bruit. Littéralement. Il s’agit d’une onomatopée : le tong évoque le claquement caractéristique de la sandale contre le talon lorsque l’on marche avec ce type de chaussure. Ce son sec, répété à chaque pas, a donné son nom à l’objet.Mais c'est un peu plus compliqué en r'realité. A l'origine, avant d'arriver chez nous et de correspondre à ce bruit, le mot vient de l’anglais “thong”, qui signifie à l’origine “lanière”, “courroie”, et plus précisément la bande qui passe entre les orteils. Dans l’anglais moderne, “thong sandals” désigne les sandales à entre-doigts. En Australie, on parle même simplement de thongs pour désigner les tongs.Lorsque le mot traverse la Manche au début du XXe siècle, il est adapté phonétiquement par les francophones. La prononciation anglaise “thong” (/θɒŋ/) devient rapidement “tong”, plus simple à prononcer et plus cohérent avec le son produit par la sandale. Cette coïncidence phonétique — le bruit et le mot — favorise l’adoption du terme dans la langue française.L’objet, lui, est bien plus ancien que son nom. Les sandales à entre-doigt existent depuis l’Égypte ancienne, où on en fabriquait déjà en papyrus ou en cuir. On en trouve aussi en Inde, au Japon (les geta), ou encore en Grèce antique. Mais le mot “tong”, tel qu’on l’utilise aujourd’hui, apparaît réellement au moment où ce type de sandale devient populaire en Occident, après la Seconde Guerre mondiale.Le véritable essor vient dans les années 1950 et 1960, avec l’arrivée massive de modèles en caoutchouc importés du Japon. L’entreprise japonaise Shōroku Shōkai — ancêtre de MoonStar — commercialise alors des sandales bon marché, confortables, faciles à produire, qui deviennent vite incontournables sur les plages. Les Américains les appellent “flip-flops”, là encore pour leur bruit. Les Français retiennent plutôt la version anglo-australienne “tong”.Ce mélange entre origine linguistique anglaise (la “lanière”) et ressemblance avec le claquement sonore explique pourquoi ce mot s’est imposé si facilement. Le français adore les onomatopées, et “tong” sonnait à la fois simple, efficace et immédiatement reconnaissable.En résumé :Origine anglaise : thong = lanière entre les orteils.Adaptation française : “tong”, mot qui évoque le bruit de la sandale.Succès mondial : la sandale à entre-doigt devient un symbole estival, et son nom s’impose naturellement. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
La réponse tient à une combinaison de biologie, d’hydratation et de mécanique vocale. Dès le réveil, plusieurs phénomènes se cumulent et modifient temporairement la façon dont nos cordes vocales vibrent.D’abord, il faut comprendre que la voix dépend directement des cordes vocales, deux replis musculaires situés dans le larynx. Elles vibrent grâce à l’air expulsé par les poumons, un peu comme les cordes d’un instrument. Plus elles sont fines et tendues, plus la voix est aiguë. Plus elles sont épaisses et détendues, plus la voix descend. Or, pendant la nuit, le corps entier se met au repos, et ces tissus n’échappent pas à la règle : les muscles du larynx se relâchent. Au réveil, ils n’ont pas encore retrouvé leur tonus habituel, ce qui rend les cordes vocales légèrement plus épaisses et moins tendues. Le résultat : un son plus grave.Deuxième facteur : la déshydratation nocturne. Même si l’on ne bouge pas beaucoup, on continue à perdre de l’eau en respirant. Les cordes vocales ont besoin d’être parfaitement lubrifiées pour vibrer librement. Mais au matin, elles sont souvent plus sèches. Cette moindre hydratation modifie leur élasticité et augmente la friction lorsqu’elles vibrent, ce qui contribue à alourdir la voix. C’est pour cela qu’un verre d’eau ou une simple douche chaude peut suffire à “réveiller” la voix : l’hydratation revient, la muqueuse retrouve sa souplesse, et le timbre remonte.Troisième élément : le mucus. Pendant la nuit, les voies respiratoires produisent naturellement des sécrétions. Une partie s’accumule autour des cordes vocales, formant parfois un léger film qui empêche la vibration optimale. C’est ce qui explique la sensation de “voix enrouée” ou de “voix pâteuse” au saut du lit. Un simple raclement de gorge ou quelques minutes de parole permettent généralement d’éliminer ce mucus, et la voix retrouve progressivement son registre habituelEnfin, le rythme circadien joue aussi un rôle. Le matin, le taux de cortisol, hormone qui influence notamment l’énergie musculaire, n’est pas encore pleinement stabilisé. Le corps sort lentement de sa phase de repos profond. Cette transition hormonale, discrète mais réelle, participe à la sensation d’une voix qui “remonte” au fil de la matinée.En résumé, si notre voix est plus grave le matin, c’est parce que les cordes vocales sont relâchées, moins hydratées et légèrement encombrées, avant que le corps ne retrouve son fonctionnement diurne. Une explication simple, mais qui raconte beaucoup sur la mécanique fine de la parole humaine. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pendant plus de trois millénaires, l’Égypte ancienne a accordé aux chats un statut unique dans le monde antique. Ils n’étaient pas simplement des animaux appréciés : ils étaient des êtres sacrés, intimement liés à la vie quotidienne, à la religion et à l’ordre du monde. Mais pourquoi une telle vénération ?D’abord pour une raison simple : le chat était extrêmement utile. À une époque où les réserves de céréales pouvaient décider de la survie d’un village, les rongeurs représentaient une menace majeure. Les chats, en chassant rats, souris et serpents, protégeaient les greniers et donc la nourriture, la richesse et la stabilité du foyer. Les Égyptiens voyaient dans cette efficacité une sorte de magie naturelle : un animal capable d’agir, silencieusement, pour préserver l’ordre contre le chaos.De cette utilité est née une symbolique. Le chat devient le compagnon de la déesse Bastet, représentée sous forme de femme à tête de chat. Bastet était la divinité protectrice du foyer, de la maternité et de la douceur, mais aussi une déesse capable de combativité. Le chat, avec son apparence paisible mais ses réactions fulgurantes, incarnait parfaitement cette double nature. Les Égyptiens pensaient que la présence d’un chat dans une maison y apportait protection et bienveillance. D’ailleurs, il était fréquent de placer des amulettes de chats sur les enfants pour éloigner les mauvais esprits.À partir du Ier millénaire avant notre ère, le culte se développe encore : des milliers de chats sont momifiés et déposés en offrande dans les temples dédiés à Bastet, notamment celui de Bubastis, centre religieux majeur. Certains chats étaient embaumés avec le même soin que les humains, enveloppés de bandelettes ornementées et enterrés dans des nécropoles entières. Ces momies ne représentaient pas des “animaux de compagnie”, mais des médiateurs sacrés capables d’intercéder entre les hommes et les dieux.Cette vénération s’accompagnait d’une protection juridique. Tuer un chat, même accidentellement, pouvait être puni de mort. Un historien grec rapporte qu’un Romain, ayant renversé un chat, fut lynché par une foule malgré l’intervention des autorités. C’est dire la place que l’animal occupait dans l’imaginaire collectif.En résumé, les Égyptiens vénéraient les chats parce qu’ils voyaient en eux un allié essentiel, un symbole de protection et un reflet du divin. Animal utile, créature élégante, gardien silencieux : le chat réunissait toutes les qualités pour devenir un pilier de la culture pharaonique — et, d’une certaine manière, continuer à fasciner le monde encore aujourd’hui. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
L’idée peut surprendre : la prostitution existe-t-elle dans le monde animal ? Évidemment, il ne s’agit pas de prostitution au sens humain du terme, c’est-à-dire d’une activité consciente, socialement codifiée et liée à des notions de moralité ou d’échange économique. Mais il existe bel et bien, chez plusieurs espèces, des comportements où un acte sexuel est échangé contre une ressource, un avantage matériel, ou un service. Les biologistes parlent alors de “sexual trading”, ou échange sexuel intéressé.Le cas le plus célèbre est celui des manchots d’Adélie, que tu mentionnes. Chez eux, les nids sont construits avec des galets, une ressource rare et très convoitée. Certaines femelles, lorsqu’elles manquent de pierres, se rendent discrètement dans le territoire d’un mâle qui n’est pas leur partenaire. Elles s’accroupissent devant lui, adoptent la posture d’accouplement… et obtiennent un galet, parfois plusieurs, avant de retourner à leur nid. Fait intéressant : dans de nombreux cas observés par les éthologues, il n’y a même pas d’accouplement réel — la femelle mime l’offre, le mâle cède le galet, et chacun repart. Un échange symbolique, mais efficace.Ce n’est pas un cas isolé. Chez les bonobos, espèce de primates réputée pour utiliser le sexe comme outil social, des individus peuvent offrir des relations sexuelles pour obtenir de la nourriture ou pour apaiser des tensions. Ici, le sexe devient une monnaie d’échange, permettant d’accéder à des ressources ou d’améliorer sa position dans le groupe.Chez certaines araignées, des mâles offrent des “cadeaux nuptiaux” – généralement des insectes emballés dans de la soie – pour obtenir l’accès à la reproduction. Dans quelques espèces, des femelles feignent l’acceptation du cadeau, se nourrissent puis s’enfuient sans coopérer sexuellement. À l’inverse, certains mâles offrent des cadeaux vides, de simples cocons de soie, trompant la femelle pour obtenir une copulation rapide.Même dans le monde marin, le phénomène existe. Chez les dauphins tursiops, des alliances de mâles peuvent “offrir” protection et nourriture à une femelle, qui en échange reste sexuellement disponible pour eux. Ce comportement s’étend parfois sur des mois.Tous ces exemples montrent que le sexe peut constituer une véritable monnaie comportementale dans la nature. Les animaux n’ont pas conscience de prostituer leur corps — ils répondent simplement à des pressions écologiques où l’échange d’un acte reproducteur contre une ressource augmente leurs chances de survie ou de reproduction.En d’autres termes, il n’y a pas de prostitution au sens moral, mais il existe bel et bien des échanges sexuels transactionnels dans la nature. Un rappel fascinant que l’économie… commence parfois bien avant l’apparition des humains. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le mot “pseudocide” intrigue : on dirait un terme issu d’un roman policier. Pourtant, il désigne un phénomène bien réel, parfois tragique, parfois déroutant. Le pseudocide, c’est tout simplement l’acte de simuler sa propre mort. Une disparition organisée, volontaire, parfois extrêmement sophistiquée, dont l’objectif est toujours le même : faire croire au monde que l’on n’existe plus.Le pseudocide se distingue de la disparition volontaire ou de la cavale classique par un élément clé : il implique une mise en scène. La personne laisse derrière elle des indices destinés à convaincre les proches, les enquêteurs ou la presse qu’elle est décédée. Accident de voiture truqué, vêtements abandonnés en bord de mer, bateau retrouvé vide, fausse agression… les scénarios varient, mais suivent une logique commune : créer suffisamment de vraisemblance pour que personne ne soupçonne une fuite.Mais pourquoi simuler sa mort ? Les motivations sont multiples. Certains cherchent à échapper à des dettes, à la justice, ou à une situation personnelle devenue insupportable. D’autres veulent fuir une pression médiatique ou familiale. Il existe même des cas où le pseudocide est commis par désespoir, comme une manière radicale de rompre avec une vie jugée ingérable.L’histoire regorge d’exemples étonnants. L’un des plus célèbres est celui de John Darwin, un Britannique qui, en 2002, simule sa mort en canoë pour échapper à ses dettes. Pendant cinq ans, il vit dans une chambre secrète au domicile conjugal, avant que l’affaire n’éclate lorsque lui et sa femme apparaissent naïvement sur une photo prise… au Panama. D’autres cas restent mystérieux, comme celui de certaines célébrités supposément “disparues” mais que l’on croit apercevoir des années plus tard.Le pseudocide est rarement couronné de succès durable. Simuler sa mort entraîne presque toujours des conséquences juridiques lourdes : fraude à l’assurance, falsification de documents, obstruction à la justice. Et surtout, un pseudocide s’effondre souvent à cause de détails anodins : un retrait bancaire, un message envoyé, une photo publiée, une simple erreur humaine qui dévoile la supercherie.Sur le plan psychologique, disparaître ainsi demande une préparation mentale extrême : renoncer à ses proches, couper toute communication, vivre sous une nouvelle identité, accepter la solitude et le stress constant de l’anonymat. Beaucoup de “revenants” témoignent d’un profond malaise, comme si l’acte de fuir sa vie l’avait rendue encore plus lourde à porter.En somme, le pseudocide est un acte de rupture totale, spectaculaire et souvent tragique. Une disparition qui, derrière son apparente audace, révèle surtout une immense détresse ou un désespoir prêt à tout pour recommencer à zéro. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’histoire d’un cheval allait devenir l’un des épisodes les plus inattendus et les plus poignants de la Résistance. Son nom : Iris XVI, un bel alezan appartenant à l’École de cavalerie de Saumur. Un animal réputé pour son calme, son intelligence… et sa fidélité presque humaine. Mais en 1940, lorsque les troupes allemandes envahissent la région, son destin bascule.Les Allemands réquisitionnent tout : bâtiments, armes, véhicules… et chevaux. Iris XVI se retrouve alors affecté à un officier allemand, un certain colonel qui, comme beaucoup de ses camarades, ignore tout du tempérament particulier de l’alezan français. Ce qu’il ne sait pas non plus, c’est que les chevaux de Saumur, dressés selon une tradition prestigieuse, obéissent à des signaux très subtils, à une complicité et à une manière de monter propres à la cavalerie française. Les ordres germaniques, brusques, secs, autoritaires, ne font qu’agacer l’animal.Mais chez Iris XVI, l’agacement se transforme vite en acte de défiance.Lors d’une inspection, le colonel allemand salue un supérieur, passe devant sa troupe… et met pied à l’étrier. À peine installé en selle, il ordonne au cheval de partir au trot. Iris XVI ne bronche pas. Nouvel ordre, cette fois d’un ton sec. Silence. Le cheval reste immobile, les oreilles couchées. Furieux, l’officier lui enfonce les éperons. L’alezan bondit alors… mais pas dans la direction attendue.Dans un mouvement vif et précis, il se cabre, pivote, puis projette brutalement son cavalier au sol. Le colonel chute lourdement, sous les rires étouffés des soldats français qui assistent à la scène sans pouvoir intervenir. Humilié, blessé dans son orgueil, l’officier allemand se relève, livide. Quelques secondes suffisent pour transformer son humiliation en vengeance.Il ordonne l’impensable.Iris XVI, un cheval qui n’a fait qu’obéir à son instinct et à son dressage, est déclaré “dangereux” et “incontrôlable”. Le verdict tombe comme une condamnation : fusillé pour acte de résistance. Le cheval est abattu sur la place de l’École de cavalerie de Saumur, sous les yeux horrifiés des Français réquisitionnés. Sa dépouille est enterrée à la hâte, sans cérémonie.Mais malgré les années, l’histoire n’a jamais disparu. Elle circule d’abord en murmures, devient une légende parmi les anciens cavaliers de Saumur, puis un symbole : celui d’un animal qui, par son comportement instinctif, s’est opposé à l’occupant. Beaucoup y voient un acte de résistance digne d’un soldat.Aujourd’hui encore, Iris XVI est considéré comme le seul cheval officiellement fusillé pour acte de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Son nom flotte comme un hommage : celui d’un animal qui n’a pas accepté de se laisser dompter par l’ennemi. Un héros silencieux, tombé sans savoir qu’il incarnait l’honneur de toute une institution. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
La question paraît absurde, presque inquiétante, et pourtant la réponse est simple : nous consommons régulièrement du dioxyde de silicium, aussi appelé silice, classé comme additif alimentaire sous le nom de E551. Et cette silice n’est rien d’autre qu’un proche cousin… du sable.Attention : il ne s’agit pas du sable granuleux que l’on trouve sur la plage, mais d’une forme extrêmement fine et amorphe, invisible à l’œil nu. Cette poudre très légère possède une propriété précieuse pour l’industrie alimentaire : elle empêche les aliments de coller entre eux. C’est ce qu’on appelle un agent anti-agglomérant. Sans elle, de nombreux produits de nos placards formeraient des blocs durs et inutilisables.On retrouve cet additif dans le café soluble, les soupes en poudre, les sauces instantanées, certaines épices, les compléments alimentaires, mais aussi dans le très banal sel de table. Le rôle du E551 est toujours le même : absorber l’humidité, rendre le produit fluide, permettre un meilleur dosage et éviter les paquets compacts.Mais d’où vient cette idée d’ajouter de la silice alimentaire ? En fait, cette pratique est ancienne. Dès les années 1950, les industriels comprennent que la poudre de silice améliore la conservation et la manipulation des produits secs. Elle ne modifie ni le goût ni la couleur, elle est stable, bon marché, efficace… et naturellement abondante : la silice constitue environ 60 % de la croûte terrestre.La question qui fâche vient alors : est-ce dangereux ? Les agences sanitaires – européennes comme américaines – considèrent la silice amorphe comme sûre aux doses utilisées dans l’alimentation. Elle traverse notre organisme sans être absorbée. En revanche, une autre forme de silice, appelée silice cristalline, est à éviter lorsqu'elle est inhalée sous forme de poussière : elle est classée cancérogène dans certaines conditions. Ce n’est cependant pas celle que l’on trouve dans les aliments.Paradoxalement, nous en consommons tous, quotidiennement, sans nous en rendre compte. Et l’on pourrait aller encore plus loin : la silice est également utilisée dans certains vins, dans la filtration de la bière, dans le pain industriel ou encore dans certaines friandises, toujours pour stabiliser les textures.En somme, nous ne mangeons pas du sable au sens littéral, mais un ingrédient très commun, purifié, contrôlé et utile. Un minéral discret qui accompagne en silence la plupart des produits secs de nos cuisines. Et dont nous ignorons presque toujours la présence. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
L’expression « bouc émissaire » a une origine à la fois biblique, religieuse et symbolique, remontant à plus de trois mille ans. Aujourd’hui, elle désigne une personne injustement accusée et punie à la place des véritables responsables — mais son sens premier était beaucoup plus concret et rituel.Tout commence dans l’Ancien Testament, dans le Livre du Lévitique (chapitre 16), texte fondamental de la tradition juive. À l’époque, les Hébreux célébraient chaque année le Yom Kippour, le grand jour de l’expiation. Ce jour-là, le grand prêtre d’Israël accomplissait un rituel destiné à purifier le peuple de ses fautes. Deux boucs étaient choisis : l’un était sacrifié à Dieu, l’autre devenait le bouc émissaire. Le prêtre posait symboliquement les mains sur sa tête et transférait sur lui les péchés de toute la communauté. Puis l’animal, chargé de ces fautes, était chassé dans le désert, vers un lieu inhabité appelé « Azazel ». Il emportait ainsi les péchés du peuple loin du camp.Ce rite très ancien visait à purifier la collectivité en rejetant symboliquement le mal hors d’elle. L’expression hébraïque originelle, ‘azazel, a longtemps prêté à confusion : on ne savait pas s’il s’agissait d’un lieu, d’un démon du désert ou du nom donné au bouc lui-même. Les premières traductions de la Bible en grec, puis en latin, ont choisi de rendre le terme par « bouc pour l’éloignement » (caper emissarius), d’où vient notre expression française « bouc émissaire ».Au fil des siècles, la dimension religieuse a disparu, mais l’image est restée puissante. Le bouc émissaire est devenu une métaphore sociale et psychologique. Dans toute société, lorsqu’un groupe traverse une crise — guerre, famine, épidémie, échec politique — il cherche souvent un responsable unique, un individu ou une minorité sur qui reporter la faute collective. C’est ce mécanisme que le philosophe et anthropologue René Girard a théorisé au XXe siècle : selon lui, les sociétés humaines maintiennent leur cohésion en désignant une victime expiatoire, qu’on exclut ou qu’on sacrifie pour apaiser les tensions internes.Ainsi, le « bouc émissaire » d’aujourd’hui — qu’il soit un collègue, un groupe social ou un peuple — n’est que l’héritier moderne du rituel antique : une manière de se débarrasser du mal ou du conflit en le projetant sur un autre. L’expression rappelle à quel point le besoin de désigner un coupable est ancré dans nos mécanismes les plus anciens de survie et de cohésion collective. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Si certaines personnes adorent les films d’horreur tandis que d’autres les fuient, la raison se trouve en grande partie dans notre cerveau. Les neurosciences montrent que tout dépend de la manière dont chacun traite la peur, cette émotion universelle mais extrêmement variable d’un individu à l’autre.Lorsqu’on regarde une scène effrayante, l’amygdale, une petite structure située au cœur du cerveau, s’active. C’est elle qui déclenche la réponse de peur : accélération du rythme cardiaque, sécrétion d’adrénaline, contraction musculaire. En temps normal, cette réaction prépare à fuir ou à se défendre. Mais dans un cinéma ou sur un canapé, le cerveau sait qu’il n’y a aucun danger réel. Résultat : la peur devient une expérience contrôlée, une montée d’adrénaline sans risque, un peu comme les montagnes russes.Chez les amateurs de films d’horreur, cette activation de l’amygdale s’accompagne souvent d’une libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Ils ressentent donc un mélange paradoxal de peur et d’excitation. C’est cette combinaison – la montée du stress suivie du soulagement – qui crée le frisson agréable. Des chercheurs de l’Université de Copenhague ont montré en 2020 que le cerveau des amateurs de films d’horreur alterne très vite entre état d’alerte et retour à la sécurité, un peu comme un entraînement émotionnel : ils apprennent à “jouer” avec leur peur.À l’inverse, certaines personnes ont une hyperactivité de l’amygdale ou une moindre régulation de cette zone par le cortex préfrontal, la région du raisonnement. Leur cerveau a plus de mal à distinguer la fiction du réel. Pour elles, les images d’horreur déclenchent un véritable état de stress, avec libération excessive de cortisol (l’hormone du stress), sueurs et anxiété prolongée. D’où le rejet total du genre.Enfin, le goût de la peur dépend aussi de la personnalité et du câblage neuronal. Les personnes curieuses, en quête de sensations fortes, ou dotées d’un système dopaminergique plus sensible (comme les amateurs de sports extrêmes) trouvent dans l’horreur une stimulation gratifiante. D’autres, plus anxieuses ou empathiques, activent plus intensément les circuits de la douleur et du dégoût.En résumé, aimer les films d’horreur, c’est une question de chimie cérébrale : pour certains cerveaux, la peur est un jeu excitant ; pour d’autres, c’est une alarme qu’il vaut mieux ne jamais déclencher. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
La mer Caspienne est un cas unique au monde : immense étendue d’eau fermée, elle est qualifiée de mer par son nom, mais de lac par sa géographie. Pourtant, d’un point de vue juridique international, elle n’est ni tout à fait l’un ni l’autre.Située entre la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l’Azerbaïdjan et l’Iran, la mer Caspienne est un bassin endoréique : elle n’a aucune communication naturelle avec les océans. Selon la géographie physique, c’est donc un lac salé, le plus grand du monde, avec une superficie de 370 000 km². Mais sa salinité (autour de 12 g/l) et son immense taille ont longtemps nourri l’ambiguïté : historiquement, les peuples riverains l’ont appelée “mer”, et les cartes l’ont toujours représentée ainsi.La vraie question, toutefois, est politico-juridique. Car si la Caspienne est une mer, elle relève du droit maritime international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (dite de Montego Bay, 1982). Dans ce cas, chaque pays riverain aurait une zone économique exclusive et un plateau continental, avec des droits d’exploitation sur le pétrole et le gaz situés dans sa partie. Si, en revanche, on la considère comme un lac, il faut la partager selon des règles spécifiques de droit interne entre États, par des accords bilatéraux ou multilatéraux.Pendant des décennies, cette ambiguïté a provoqué des tensions diplomatiques. L’effondrement de l’URSS en 1991 a tout compliqué : de deux États riverains (URSS et Iran), on est passé à cinq. Chacun voulait défendre sa part des immenses gisements d’hydrocarbures sous le fond caspien. L’enjeu était colossal.Après des années de négociations, un compromis a été trouvé en 2018 avec la Convention d’Aktau, signée par les cinq pays. Elle a établi un statut hybride :La mer Caspienne n’est ni un océan ni un lac au sens strict.Son eau de surface est partagée comme celle d’une mer, ouverte à la navigation commune.Mais son fond marin (où se trouvent les ressources) est divisé entre les États, comme pour un lac.Ainsi, la Caspienne bénéficie d’un régime juridique sui generis, c’est-à-dire unique en son genre. Ce statut permet à chacun des pays riverains d’exploiter ses ressources tout en maintenant une souveraineté partagée sur l’ensemble. En somme, la mer Caspienne est juridiquement… un peu des deux : une mer par son nom et ses usages, un lac par sa nature, et un compromis diplomatique par nécessité. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le charbon, qu’il soit de bois ou de houille, a la particularité d’absorber l’oxygène de l’air et de s’oxyder lentement à sa surface. Cette réaction chimique, appelée oxydation exothermique, dégage de la chaleur. Si le tas de charbon est volumineux et mal ventilé, la chaleur ne peut pas se dissiper. Peu à peu, la température interne monte, jusqu’à atteindre le point où la matière s’enflamme d’elle-même — souvent autour de 150 à 200 °C. C’est ce qu’on appelle l’auto-inflammation.Ce risque augmente avec plusieurs facteurs :La granulométrie : les petits morceaux, voire la poussière de charbon, s’oxydent beaucoup plus vite que les blocs massifs.L’humidité : paradoxalement, un léger taux d’humidité favorise l’oxydation, car l’eau agit comme un catalyseur ; en revanche, un excès d’eau peut ralentir le processus.La compacité du tas : un amas dense limite la circulation d’air, ce qui empêche le refroidissement naturel.La chaleur ambiante : en été ou dans un local mal ventilé, le risque est multiplié.L’auto-échauffement se déroule souvent en plusieurs jours ou semaines, de manière insidieuse. Le charbon semble stable en surface, mais à l’intérieur, la température grimpe progressivement. Lorsque l’air atteint ces zones chaudes par des fissures ou des interstices, il alimente brusquement la combustion : le tas peut alors s’enflammer spontanément, sans aucune étincelle.Les conséquences peuvent être graves : incendies de dépôts, émissions de gaz toxiques (notamment du monoxyde de carbone), voire explosions dans les espaces clos. C’est pourquoi les charbonnages et centrales thermiques ont mis en place des protocoles stricts : stockage en couches minces, contrôle de la température interne, aération permanente, voire inertage à l’azote dans certains cas.Pour les particuliers, la prudence s’impose : il ne faut jamais entasser le charbon en gros tas dans un local fermé. Il est conseillé de le stocker en petites quantités, à l’abri de l’humidité mais dans un espace bien ventilé, et de remuer régulièrement le tas pour éviter l’accumulation de chaleur.En résumé, le charbon, même éteint, n’est pas une matière inerte : son contact prolongé avec l’air suffit, dans certaines conditions, à allumer un feu sans flamme ni étincelle. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le « test de la chaise bancale » est une épreuve informelle mais redoutée utilisée dans certains entretiens d’embauche pour évaluer la réaction d’un candidat dans une situation d’inconfort. Comme son nom l’indique, il s’agit littéralement d’une chaise instable, dont un pied est légèrement plus court que les autres, ou d’un siège volontairement inconfortable. Le but n’est pas de juger la posture du candidat, mais sa manière de réagir à un désagrément inattendu.Ce test appartient à la catégorie des épreuves de résistance psychologique. Il ne repose pas sur des critères objectifs, mais sur l’observation du comportement. L’employeur ou le recruteur cherche à voir si le candidat garde son calme, s’il tente de réparer la situation, s’il manifeste de la gêne, de l’agacement, ou au contraire de l’humour. En somme, ce n’est pas le confort qui est testé, mais la résilience émotionnelle et la gestion du stress.L’idée est de recréer une mini-crise, un moment de perte de contrôle, dans un contexte où le candidat ne s’y attend pas. Face à cette situation, plusieurs attitudes peuvent apparaître : certains s’enfoncent dans la chaise en serrant les dents, d’autres la réajustent naturellement, d’autres encore signalent poliment le problème. Le recruteur observe alors la spontanéité, la capacité à s’adapter, et surtout la manière dont la personne exprime une gêne. Dans les métiers de relation client, de management ou de vente, cette réaction en dit parfois plus qu’un CV.Ce type de test s’inscrit dans une mouvance plus large d’entretiens “non conventionnels”, popularisés dans les années 2000 par certaines entreprises américaines, comme Google ou Zappos, qui posaient des questions déstabilisantes du type : « Combien de balles de golf peut-on mettre dans un avion ? ». L’objectif est le même : sonder la personnalité, la créativité, et la réaction à l’imprévu.Toutefois, le test de la chaise bancale est controversé. Certains psychologues du travail estiment qu’il ne mesure rien de fiable et peut être perçu comme une forme de manipulation, voire d’humiliation. D’autres rappellent qu’un bon entretien doit mettre le candidat en confiance, non en déséquilibre. Dans les faits, ce genre de test tend à disparaître dans les grands groupes, mais il subsiste parfois dans les petites structures ou les secteurs où la personnalité compte autant que les compétences.En définitive, la « chaise bancale » est moins un test qu’un symbole : celui d’un monde du travail qui, au-delà des diplômes, cherche à jauger l’attitude, la souplesse et la capacité à rester digne, même quand tout vacille — littéralement. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.







👌👌
en Iran, cette année il y a 27 jours fériés !!!😁
Mettre des pubs McDonald's pour influencer des enfants ? Sérieusement ?
Du contenu qui peut parfois être intéressant même pour les adultes. Cependant, 45s de pubs sur 2 minutes d'épisodes c'est dingue... c'est-à-dire que si je veux laisser le podcast une demi-heure, je vais avoir plus de 11 minutes de pubs ?!? En plus, des pubs Mc Donald's pour un contenu destiné aux enfants, c'est ethniquement inapproprié. Jamais je laisse ça à mes enfants.
il a 10 chiffres il ne faut pas oublier le 0 ;)
Les "manags"?
franchement je ne savais pas