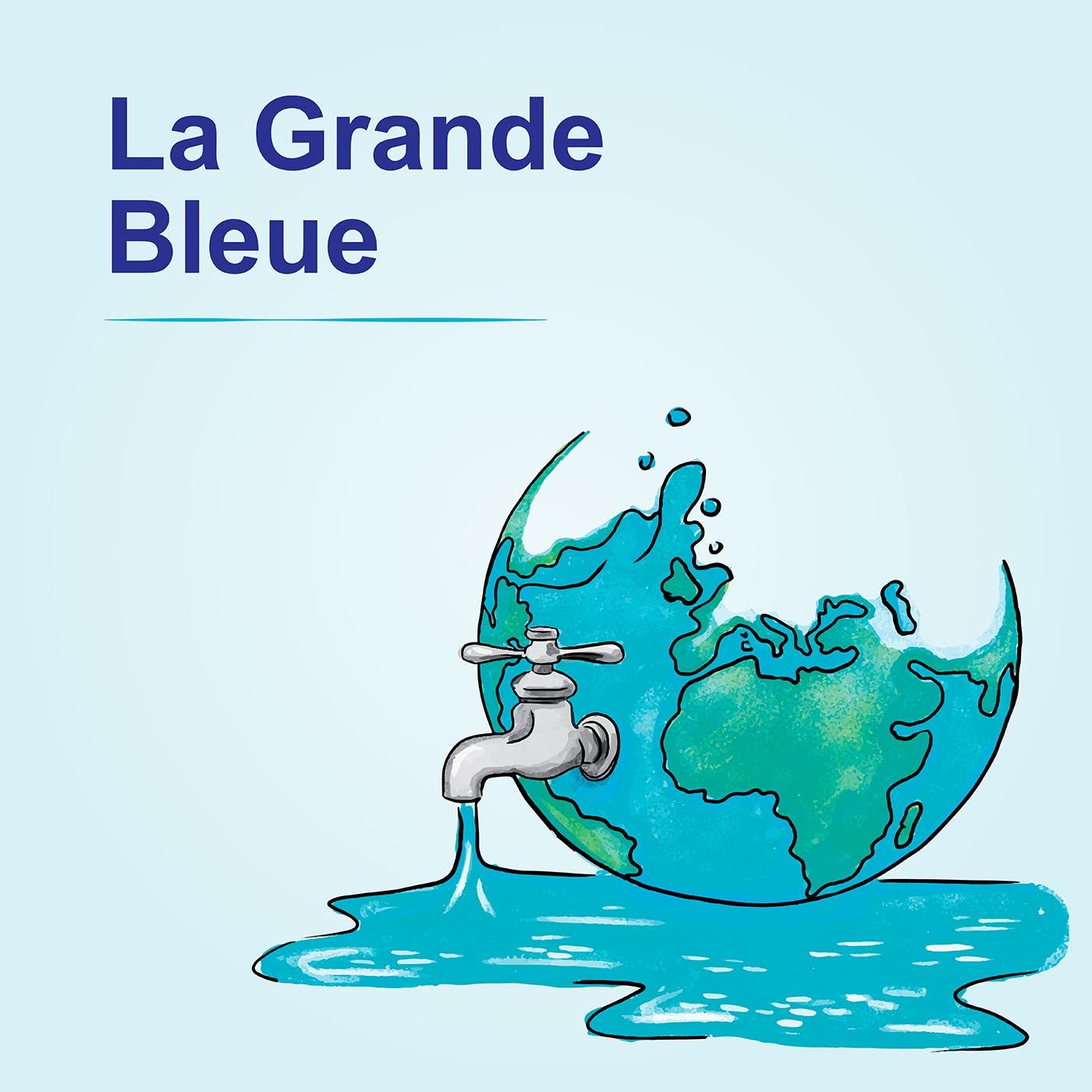Discover La grande bleue
La grande bleue

La grande bleue
Author: Sébastien Chauveau Production
Subscribed: 11Played: 73Subscribe
Share
© Sébastien Chauveau Production
Description
La grande bleue est une émission qui vous fait voguer sur toutes les façades maritimes. Des déchets plastiques à l’érosion, de la pollution chimique aux activités touristiques, nautiques et économiques, du transport aux algues vertes en passant par la faune, la flore, le bien-être, l’énergie, le recyclage, la dessalinisation, les marées, la prévention... je vous fais plonger sur toutes les côtes du monde, et aborde pour vous toutes les thématiques environnementales de nos océans. L'émission est agrémentée d'ambiances maritimes. Le milieu est suffisamment riche pour que je ne vous en fasse pas profiter. Ouvrez vos oreilles, et laissez vous emmener au gré des vagues, des oiseaux, des bateaux, des récits, des avis et des confidences des spécialistes.
20 Episodes
Reverse
Dans cette émission de La grande bleue, nous avons abordé différents aspects du milieu maritime. Nous avons parlé d’économie, de santé, de pollution, de valorisation. Nous avons aussi mis un coup de projecteur sur une association : la Ligue de protection des oiseaux. Nous avons rencontré une équipe qui nettoyait et remettait en forme les oiseaux blessés, perdus ou mazoutés.
Pour la dernière croisade de cette série, nous partons à la rencontre de David Beaulieu et de son association : Eco-Mer. Comme beaucoup d’autres, elle milite et agit pour la protection des océans. Mais à la différence de certaines, elle est assise sur une volonté non dissimulée de travailler pour la cause de la mer, pas de satisfaire à des égaux personnels ou à des envies frénétiques de communication. David et son équipe sont des gens qui vivent, pensent et respirent les océans à longueur de temps.
La mer fascine. Elle est calme. Elle est déchaînée. Elle monte. Elle descend. Elle est huileuse. Elle est plate. Tous ces phénomènes interrogent ceux qui ne sont pas des spécialistes des mathématiques, de l’hydrodynamisme, de l’astronomie. C’est ce qui en partie attire les foules sur les côtes.
Chaque année, les marées font la joie de milliers d’observateurs. Plus elles sont grosses, plus elles impressionnent, plus elles passionnent. Les marées : c’est ce dont nous parlons dans cet épisode de La grande bleue.
Quand on aborde l’environnement marin, on ne peut pas éluder l’érosion. On en parle suffisamment dans les revues scientifiques, au lendemain des tempêtes, lors des incidents sur les côtes. Le phénomène est mondialement connu. Il est naturel ou anthropique. Traduisez : qu’il peut être induit, soit par les lois de la nature, soit par celles de l’activité humaine. C’est d’érosion dont nous parlons dans ce numéro de La grande bleue.
C’est un état de fait. L’eau douce manque dans le monde, plus exactement l’eau potable. On peut dire que les pays qui sont avancés sont moins concernés par la pénurie d’eau douce que ceux qui sont dits « pauvres » ou plus en « reculés ». Il n’empêche, il y a des contrées méditerranéennes qui connaissent d’importants déficits hydriques. Elles n’ont pas de quoi subvenir à leurs besoins en eau douce.
Tout le monde ne le sait pas, mais le dessalement de l’eau est une technique très répandue. C’est souvent une solution incontournable. Tout autant que le recyclage des eaux usées et souterraines. En 2008, le bassin méditerranéen représentait un quart du dessalement mondial. Vous l’aurez compris, nous parlons de dessalinisation dans cet épisode de l’émission La grande bleue.
Quand on évoque la mer, l’un des sujets qui revient dans les discussions, c’est la pollution. Elle lamente les observateurs. Elle résigne les touristes et les promeneurs. Elle exaspère les institutionnels et les chercheurs.
Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a quelquefois où l’on aspirerait presque à ce que les océans charrient plus de polluants. L’une des principales difficultés au recyclage des produits maritimes est l’approvisionnement. C’est ce qui fait défaut au rendement, et qui freine le développement des nouvelles filières. Dans cet épisode de La grande bleue, nous allons voir ce que deviennent les plastiques, les algues, les poissons et les coquillages, après leur échouage.
Les océans cultivent les paradoxes. D’un côté, ils sont un havre de sérénité. De l’autre, ils sont décriés pour les risques qu’ils font courir à notre santé. D’un côté, ils nous détendent et nous ressourcent. De l’autre, ils nous intoxiquent et nous empoisonnent. La mer est-elle vraiment celle à qui il faut s’en remettre. Peut-on s’y baigner ? Peut-on en consommer les coquillages et les poissons ? A-t-on raison de faire confiance aux analyses et aux règlements ? C’est ce que nous allons voir au cours de cet épisode de La grande bleue.
Nous avons déjà évoqué dans cette émission les bénéfices de la mer sur notre alimentation. Il faut savoir qu’elle soigne aussi. Nos océans renferment pléthore de plantes et d’animaux marins qui entrent dans de multiples spécialités pharmaceutiques. Les recherches vont bon train dans le domaine. Des études sont menées pour développer de nouveaux procédés, comme l’emploi des étoiles de mer pour soigner le cancer ; des méduses en écran solaire ; du corail en traitement de l’ostéoporose. La mère comme remède : c’est le thème de ce nouvel épisode de La grande bleue.
Les océans occupent la plus importante surface du globe. Ils sont présents sur un peu plus des deux tiers de la surface de la terre. Ce sont de vrais capteurs des rayons du soleil et du vent. Malgré tout l’intérêt qu’il convient d’apporter à la production par les énergies marines, le sujet souffre d’une certaine lenteur. Il faut dire que les énergies des mers supportent de multiples contraintes, parmi lesquelles leur localisation. Ce sont de ces énergies dont nous parlons dans cet épisode de La grande bleue.
La mer n’est pas que déchets plastiques, rejets d’hydrocarbures, algues vertes... C’est aussi une source d’énergie très prisée des médecins, nutritionnistes, sportifs, curistes... Il faut dire que les différents scandales autour de la viande et ses conséquences sur l’homme, notamment d’avoir des cancers, ont contribué à ce que les produits maritimes soient placés au-devant de la scène de l’alimentation humaine. Le curseur du meilleur est notamment mis ici sur les algues et les poissons, avec plus ou moins de raison. C’est ce dont nous parlons dans cet épisode de La grande bleue.
La mer n’est pas que nature. Elle n’est pas qu’un champ d’exploration. Elle est un lieu d’activité. Les pêcheurs ne sont ni plus ni moins que les paysans des terres. C’est d’eux et
de leur métier dont nous parlons dans ce numéro de La grande bleue.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. A chaque catastrophe maritime, son lot d’oiseaux échoués. Les choses tendent à s’améliorer. Mais encore trop de goélands, guillemots et autres Fous de Bassans disparaissent chaque année.
Dans cet épisode de la Grande bleue, je vous raconte le quotidien de gens qui se battent pour protéger les oiseaux marins. Nous partons à la station LPO de l’Ile Grande, à Pleumeur-Bodou, dans les Côtes-d’Armor. C’est l’un des sites de référence en matière de soins aux oiseaux en France. C’est le plus ancien de notre pays.
Lorsque l’on aborde la faune et la flore, marine ou terrestre, on entre dans un vaste sujet. La biodiversité est quelque chose de complexe. Parce qu’il y a celle que l’on connaît, et celle que l’on ne connaît pas. Les océans n’échappent pas à la règle. Il y a des fonds et des habitats qui ne sont pas identifiés.
Pour la faune et la flore que l’on connaît, on peut dire que le principal problème est l’eutrophisation, c’est-à-dire la pollution. Mais il n’y a pas que cela : l’homme n’est pas étranger aux désordres maritimes. La pêche à pied, la construction, la pollution, sont autant de perturbations qui engendrent des pressions néfastes sur le milieu marin. C’est de faune et de flore dont nous parlons dans cet épisode.
Ils sont devenus un critère de choix, une arme de sélection. Les labels sont l’estampille qu’il faut avoir. Qu’ils soient Pavillon bleu ou Port propre, pour les plus connus, les labels économicotouristiques ont le vent en poupe. Ils font partie intégrante du paysage maritime.
Aujourd’hui, lorsque l’on part en vacances, fait de la plongée, sort ou accoste son bateau, notre regard se tourne souvent vers cette exigence : le label.
Même si l’on s’en défend et que l’on reconnaît que ce n’est pas toujours la garantie absolue de ce qui nous est vendu. Il n’empêche que la bataille fait
rage dans les communes et autres ports pour décrocher le fameux sésame. Quitte parfois à enfreindre les règles de la loyauté. Je suis toujours Sébastien
Chauveau. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Grande bleue, consacré aux labels maritimes.
Dès que le soleil pointe son nez et que les températures s’élèvent, c’est la même rengaine. Les bords de mer sont irrespirables. Le spectacle est désolant. Ca dure depuis un certain temps maintenant.
C’est le poison des bretons. Les algues vertes sont une plaie pour cette région. Malgré les efforts consentis pour s’en débarrasser, elles sont toujours là. Ce qui exaspère les habitants bien sûr, mais aussi les touristes et les acteurs économiques.
Vous avez compris : c’est autour des algues vertes que va tourner ce nouveau numéro de La grande bleue. C’est surtout un mal breton, dont, hélas, « on ne parle peu ou pas assez », déplorent ceux qui montent au créneau pour déplorer l’invasion des algues vertes. Ceux-là même ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que le dossier était brûlant. Je m’en suis rendu compte, aussi, quand j’ai sollicité des interviews auprès de plusieurs incontournables du dossier, qui m’ont systématiquement invoqué des plannings chargés.
« Les autoroutes de la mer permettront de désengorger les axes routiers, en offrant la possibilité d’un important report modal. En outre, ce transfert réduira nos émissions de gaz à effet de serre. » C'étaient les promesses gouvernementales. C’était aussi celles de l’Europe. On connaît le résultat. Il n’est pas si mauvais que cela, mais il n’est pas à la hauteur des espoirs.
On sait ce que sont les autoroutes terrestres. On connaît moins celles de la mer. Pourtant, le maritime a de quoi séduire. En faisant transiter les camions par les océans, on réduit les rejets de CO2 et de particules fines dans l’atmosphère. On désengorge les massifs montagneux. On limite les bouchons et les accidents sur les routes. On sécurise les marchandises. On évite la fatigue. On favorise le développement durable.
Quand on a dit tout cela, on peut penser que les autoroutes maritimes sont la panacée. On peut croire qu’elles sont très fréquentées. On peut avoir la conviction qu’elles font baisser les statistiques de l’accidentologie. On peut en déduire qu’elles sont rentables. Eh bien, pas tant que cela. Vous allez vous rendre compte en écoutant cet épisode de La grande bleue que les autoroutes de la mer ont de la gîte en France. Qu’elles ne sont pas un long fleuve tranquille. Qu’elles voguent au gré des marées géographiques et économiques.
Personne ne conteste que les lacs, les rivières, les littoraux, sont des ressources indiscutables. Ce sont des milieux qui sont à haute valeur ajoutée, aussi bien sur le plan écologique, social qu’économique. Pour certaines régions, de France et d’ailleurs, le milieu aquatique est une manne touristique non négligeable. C’est le cas pour le sud-est de la France, mais aussi pour l’ouest du pays.
Il va sans dire que, lorsque des milliers de touristes débarquent en masse, jusqu’à multiplier par dix ou vingt la capacité des petites villes ou par cent celles de petites criques ou plages, ce n’est pas sans faire de dégâts. Le pire n’est pas là. C’est du côté des activités nautiques qu’il faut porter son regard.
Elles sont, comme le tourisme, génératrices d’importantes retombées financières. Elles sont, comme le tourisme aussi, révélatrices de fortes pressions et de grosses nuisances pour les gens et l’environnement. Ce sont de ces effets dont nous parlons dans ce cinquième épisode de La grande bleue.
On le voit depuis le premier épisode de cette émission, la mer est un bouillon de culture. On y croise des micros et macrodéchets, comprenez beaucoup de matières plastiques. On y trouve aussi du pétrole. Eh bien, sachez que les océans renferment également des produits chimiques, en plus ou moins grande quantité. Plus de cent quatre-vingts tonnes transitent par les océans chaque année. C’est trois fois plus qu’il y a 20 ans.
Il y a le transport, certes, mais il y a aussi ce qui est déversé dans les océans. Et là, les chiffres sont éloquents. L’Unesco annonce entre trois cents et cinq cent milliards de kilos de produits chimiques qui seraient déversés par an par les industriels du monde entier dans les océans. Cela représenterait une pollution de douze mille kilos à la seconde.
Les produits chimiques représentent 2 % du transport maritime international. Il s’agit essentiellement de matières liquides et gazeuses, parmi lesquelles on recense : des dérivés du pétrole, des minéraux et des métaux, du chlore, du phosphore, des acides, de l’ammoniac, de l’azote, des graisses animales et végétales. Mais la pollution chimique marine, c’est aussi : des engrais et des pesticides, des déchets nucléaires et industriels, des gaz d’échappement et des eaux usées... C’est de toute cette pollution dont nous parlons cette fois.
Exxon Valdez, 37.000 tonnes ; Torrey Canyon, 119.000 tonnes ; Odyssey, 132.000 tonnes ; Haven, 145.000 tonnes ; Amoco Cadiz, 223.000 tonnes ; Castillo de Bellever, 252.000 tonnes ; ABT Summer, 260.000 tonnes ; Nowruz, 272.000 tonnes ; Atlantic Impress, 287.000 tonnes ; Ixtoc 1, 467.000 tonnes ; Deepwater, 835.500 tonnes ; guerre du Golfe, 1.000.000 à 1.500.000 tonnes... Ce sont les plus importantes marées noires de l’histoire. En France, la dernière date de 1999. C’était l’Erika. Le pétrolier avait perdu 30.000 tonnes de fioul lourd au large des côtes du Finistère. Ne sont pas répertoriées dans ce triste palmarès, les petites marées noires ou les marées noires silencieuses. On en recenserait plusieurs centaines à travers le monde depuis le début des années 2000.
Après les déchets plastiques, les macro et micro-déchets, nous parlons dans ce troisième épisode de La grande bleue des marées noires. Bien que les règlementations se sont sérieusement durcies ces vingt dernières années pour limiter les risques, les pollutions accidentelles par hydrocarbures ont quasiment disparu, mais celles qui sont qualifiées de « chroniques » sont toujours là, avec leurs dégâts.
Ce que l’on nomme, au début de cet épisode, dans la vidéo publiée par l’AFP en mai 2012 comme 8e continent, est aussi qualifié par certains spécialistes de 5e ou 7e continents. Vous aurez compris qu’il est en grande partie question ici de pollution plastique. C’est ce dont nous avons parlé dans l’épisode précédent. Mais nous allons voir, dans ce 2e numéro de La grande bleue, que la pollution marine ne tourne pas qu’autour du plastique : que nos océans renferment un tas de détritus, qui sont principalement le reflet de notre vie.
Environ 10 % des déchets qui sont connus terminent leur vie dans le milieu naturel. Sur ces 10 %, une majorité reste dans le fond des océans. C’est dire la quantité, astronomique, de déchets qui finissent en mer. Revue de détail avec François Galgani, de l’IFREMER, spécialiste européen de la surveillance des déchets marins, et Patrick Deixonne, navigateur/explorateur et chef des expéditions 7e continent.
Depuis l’aube de l’humanité, les gens ont pris l’habitude de tout jeter dans l’eau. En fait, ce sont l’eau et le feu qui épurent. Les cours d’eau, les caniveaux dans les villes, les égouts, sont de vraies poubelles. Tout ce que l’on y jette finit par descendre à la mer, et cela y descend d’autant plus facilement que les matières sont légères. C’est le cas des plastiques, que l’on retrouve en quantité phénoménale partout dans les océans.
Pourquoi vous dis-je tout cela ? Parce que vous êtes à bord de La grande bleue, l’émission qui vogue au gré des océans pour vous parler d’environnement. Durant vingt épisodes de quinze minutes, je pars à la rencontre de passionnés, de défenseurs et de spécialistes de la cause maritime. Avec eux, je parle de pollution et de règlementation ; je reviens sur certaines aberrations ; je mets aussi le cap sur des initiatives locales.
Comme vous l’aurez compris, dans ce premier numéro, je m’intéresse aux pollutions plastiques. Elles sont répandues dans les océans. Sur les plus de cinq mille milliards de particules que constitue la pollution marine, presque deux cent soixante-dix mille tonnes sont des particules plastiques. Portées par les courants, elles passent d’un continent à l'autre. Elles n’épargnent aucun fond marin, aucune côte.
Pour expliquer le fléau, je m’en remets à Isabelle Poitou, directrice de l’association Mer Terre. Avec cette scientifique, docteur en aménagement de l’urbanisme et spécialiste des déchets en milieu aquatique, je retrace le parcours des plastiques. Je fais l’état des lieux de cette pollution ; je reviens sur ses conséquences ; j’aborde la question de la biodégradabilité ; j’évoque les dernières dispositions législatives. Je suis Sébastien Chauveau. Je serai votre serviteur pour tous les épisodes de cette émission.