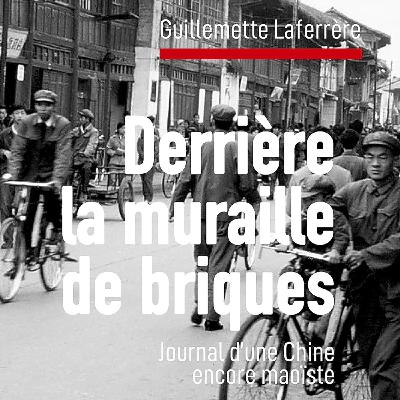Discover Histoire de Chine
Histoire de Chine

12 Episodes
Reverse
Lors du colloque international Carrefours culturels qui s’est tenu à l’université des Langues étrangères à Pékin en mai 2021, Angel Pino a dressé les grandes lignes de la traduction et de la réception de la littérature chinoise du XXe siècle en France.
Dans ce podcast, Angel Pino revient sur son intervention, en nous présentant les trois grandes phases de la traduction des œuvres chinoises.
Une première phase couvre la période où des missionnaires se sont intéressés à la littérature chinoise sans pour cela se livrer que très peu à la traduction. Quelques années auparavant, des traductions du fait de Chinois francophones étaient publiées dans le périodique La politique de Pékin, journal pour la communauté française vivant en Chine.
Une seconde phase concerne l’arrivée au pouvoir du Parti communiste en 1949 et la fondation de la République populaire de Chine jusqu’à la mort de Mao. À cette époque-là, ce sont des raisons politiques qui expliquent la curiosité française pour la littérature chinoise. C’est ainsi que les premières traductions d’œuvres romanesques apparaissent chez des éditeurs appartenant à la galaxie du Parti communiste français ou aux Éditions en langues étrangères de Pékin.
Une troisième phase débute avec la « période de réforme et d’ouverture » de la Chine. C’est au tour des détracteurs du régime chinois de s’activer en privilégiant les œuvres littéraires à vocation documentaire, même si, assez vite, une nouvelle génération de sinologues prendra le relais dans une optique désormais résolument littéraire.
Professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne, Angel Pino a dirigé le département d’études chinoises ainsi que le Centre d’études et de recherches sur l’Extrême-Orient (CEREO). Ses domaines de recherche couvrent la littérature chinoise moderne et contemporaine, la littérature taïwanaise et l’histoire de la sinologie, en particulier celle des traductions. Il est notamment l’auteur d’une Bibliographie générale des œuvres littéraires modernes d’expression chinoise traduites en français (éditions You Feng, 2014).
En 1977, l’Association universitaire franco-chinoise dépose à la bibliothèque municipale de Lyon l’ensemble des collections de l’Institut franco-chinois de Lyon (IFCL), gardées depuis 1950 dans les locaux du fort Saint-Iréné, qui fut le siège de l’Institut.
Suite à la dissolution de l’association universitaire en 1980, le fonds, enrichit des archives de l’IFCL en 1985, est transmis à l’université Lyon 3 - Jean Moulin. Le fonds reste pour autant déposé à la bibliothèque de Lyon, qui en assure la conservation et la valorisation.
Il s’agit d’une collection unique, créée hors de Chine dans le cadre officiel d’un organisme éducatif franco-chinois, constituée entre la fin de l’Empire (1911) et la prise du pouvoir par les communistes (1949), qui plus est à Lyon, par des Chinois pour des Chinois. Ces archives ont été épargnées par les transformations politiques que la Chine a connues après 1949. Le contenu du fonds, reflet de l’édition chinoise d’alors et de toutes les tendances politiques et culturelles, en fait un objet d’étude unique du seul point de vue historique.
La collection de livres et de périodiques de la bibliothèque de L’IFCL constitue le noyau du fonds chinois de la Bibliothèque de Lyon. Un fonds qui n’a cessé de s’enrichir, grâce à des dons de sinologues français ou de bibliothèques sinologiques de recherche.
Olivier Bialais, notre invité, bibliothécaire en charge du fonds chinois de la bibliothèque municipale de Lyon nous invite à découvrir sa richesse et sa diversité dans ce nouveau podcast.
Marc Riboud nait à Saint Genis Laval près de Lyon, dans une famille de la grande bourgeoisie lyonnaise. Cinquième enfant d’une fratrie de 7, il est le frère des industriels Antoine et Jean. Timide et solitaire, et peut-être parce qu’il parle peu, il se verra offrir pour ses 14 ans un appareil photo par son père, pour apprendre à voir. Dès lors, Marc ne se séparera plus de son appareil photo. Il en fera son métier, avec talent.
En 1953, il obtient sa première publication dans le magazine Life pour sa photographie d’un peintre de la tour Eiffel, ce qui lui vaudra d’intégrer l’agence Magnum, créée en autres par Robert Capa et Henri Cartier-Bresson.
En 1955, il quitte l’Europe, traverse le Moyen Orient en Land Rover jusqu’à Calcutta, où il restera un an, avant de rejoindre la Chine en janvier 1957 où il séjournera plusieurs mois.
Marc Riboud sera l’un des rares photographes européens à avoir eu accès à la Chine communiste, alors que le pays était fermé. Puis les visites en Chine de Marc Riboud s’enchainent, comme en 1965 où il fixera sur ses pellicules les prémices de la révolution culturelle.
Jean Loh est conférencier spécialiste de la photographie chinoise et un contributeur régulier de « l’œil de la photographie». Collectionneur de photo, il créera la galerie Beaugeste à Shanghai, de 2007 à 2018, où il fit la promotion de photographes chinois et occidentaux ayant documenté la Chine. La galerie Beaugeste exposera à deux reprises les photographies de Marc Riboud. Commissaire d’exposition, il organisera la Rétrospective Marc Riboud présentée dans 14 villes en Chine de 2010 à 2014 ainsi que les 80 ans du Studio Harcourt dans les 4 villes du nord-est de la Chine.
À l’automne 1921 eut lieu la première rentrée de l’Institut franco-chinois de Lyon. 127 étudiants chinois, sélectionnés après un sévère concours organisé à Pékin, Shanghai et surtout Canton débarquent à Marseille. Ils arrivent à Lyon le 25 septembre 1921 pour s’installer dans le fort Saint Irénée, propriété du ministère des armées françaises, que les lyonnais appelleront alors le fort des chinois.
L’institut franco-chinois ouvrira ses portes dans un contexte de tensions très fortes, au regard des heurts qui opposeront les étudiants ouvriers du mouvement Travail-Études présents en France et l’organisation sino-française de l’Institut franco-chinois de Lyon.
De 1921 à 1946, 473 étudiants destinés à devenir l’élite de la nouvelle Chine seront recrutés et formés dans les universités et grandes écoles lyonnaises.
Olivier Bialais est diplômé d’une maîtrise de littérature chinoise de l’Institut national des langues et civilisation orientales (Inalco) et d’un master en lettres chinoises de Bordeaux 3. Il a résidé plus de six ans à Taïwan, dont deux passés comme assistant de recherche au département de littérature et de philosophie de l’Academia Sinica. Il a ensuite passé plusieurs années en Corée du Sud, notamment comme professeur de français au Korean Defense Language Institute. Revenu en France, il est aujourd’hui bibliothécaire au fonds chinois de la bibliothèque municipale de Lyon.
[…] Comme j’ai aimé la Chine ! Il y a ainsi des pays, que l’on accepte, que l’on épouse, que l’on adopte d’un seul coup comme une femme, comme s’ils avaient été faits pour nous et nous pour eux ! […]
Paul Claudel « Choses de Chine », 1936
Après une première affectation de vice-consul à New York, il est nommé à Shanghai où il débarque en juillet 1895. Il ne rentrera en Europe qu'en 1909, après quatorze années passées dans l'empire du Milieu, où ses différentes affectations l’emmenèrent à Hankou et surtout Fuzhou, Pékin et Tianjin. Ce sont donc quinze années passées en Chine pendant lesquelles Paul Claudel écrira un recueil de poèmes en prose, Connaissance de l’Est, où il restituera ses impressions sur la Chine et sa culture, et notamment sur Shanghai, tel un photographe, l’écriture étant le moyen pour lui de fixer ce qu’il voit.
Pour nous parler de Paul Claudel, nous recevons Huang Bei (黄蓓), professeure de littérature du monde et de littérature comparée au Département de Chinois de l’Université Fudan et spécialiste de Paul Claudel et de Victor Segalen. En 2007, elle fut l’autrice de l’ouvrage Segalen et Claudel ; Dialogue à travers la peinture extrême-orientale, paru aux éditions Presses universitaires de Rennes.
Si vous êtes un passionné d'histoire, un étudiant en études asiatiques, ou simplement quelqu'un qui s'intéresse à la culture et à la société chinoise, alors « Derrière la muraille de briques, Journal d'une Chine encore maoïste » est un livre que vous devez lire absolument. Écrit par Guillemette Laferrère, ce livre est un voyage fascinant à travers le temps et l'espace, qui nous emmène au cœur de la Chine maoïste.
Guillemette Laferrère, diplômée de l’INALCO, débarque à Kunming en 1981 pour enseigner le français à des étudiants qui souhaitent parfaire leurs études et préparer les éventuels boursiers de l’Institut franco-chinois de Lyon. Lorsqu’elle arrive dans la ville, il n’y a pas eu de présence française depuis une trentaine d’années.
Son livre est tiré de son journal et de ses lettres à sa famille. Jour après jour, elle décrit sa vie quotidienne dans cette région isolée de la Chine, où le poids de la révolution culturelle est encore présent, où la Chine communiste roule en bicyclette, et où la présence étrangère est surveillée. Elle témoigne de ses étonnements et de ses difficultés, dans ce monde très éloigné de la France, dont plus grand-chose ne subsiste aujourd’hui, mais aussi de ses belles rencontres et de ses discrètes amitiés.
« Ce récit est une expérience autobiographique, un témoignage unique et inédit d'un pays et d'un temps à la fois révolus et paradoxalement contemporains. »
Entre biopic et fiction, Albert Londres doit disparaître aborde le mystère du dernier reportage d'Albert Londres, le premier grand journaliste d'investigation de l'histoire. Qu'est-il venu faire à Shanghai et qu'y a-t-il découvert ? « De la dynamite », de son propre aveu ?
Borris a réalisé les illustrations de la BD, le scénario est de Frédéric Kinder. Illustrateur, Borris a sorti en 2010 Lutte Majeure (Casterman) sur un scénario de Céka (Prix Bulles Zik, meilleur album au festival de Moulins et sélection Angoulême 2011). Puis, il s'essaie pour la première fois au scénario pour Charogne en collaboration avec Benoit Vidal, album qu'il dessine pour les éditions Glénat (Prix "Polar" meilleur one-shot BD au festival de Cognac en 2018, Prix Quais du Polar à Lyon en 2019).
Xavier Paulès est maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) où il a été le Directeur du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine (entre 2015 et 2018). Il y occupe la chaire dédiée à l'histoire sociale des plaisirs : Opium et jeux de hasard dans la Chine de la première modernité (1850-1949).
En 2011, il a publié un remarquable livre sur l'histoire de l'opium en Chine.
Détails du livre
Éditions Payot & Rivages, 21 septembre 20113
20 pages
Format : 14 x 22.5 x 2,3 cm
ISBN : 978-2228905893
Anne Dalles-Maréchal est docteure en anthropologie religieuse et histoire des religions de l’EPHE. Elle enseigne à l’université de Saint-Etienne-Jean Monet et est membre associée du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL). Depuis 2021, elle travaille précisément sur les missions chrétiennes en Mandchourie, entre 1838 et 1949 dans une perspective anthropologique et historique. Elle est la commissaire de l'exposition Sur les rives du fleuve Amour, une mission du Nord de la Chine (1838-1949) organisée par les Missions Etrangères de Paris (MEP) et l'Institut de Recherche France Asie (IRFA).
Cette exposition propose de suivre l'entreprise missionnaire des MEP en Mandchourie dans un parcours en trois temps : (1) le voyage comme rite de passage : parvenir jusqu’en Mandchourie, (2) la Mandchourie « sauvage » : observer les populations locales et (3) la rencontre des cultures : définir sa place dans le monde.
Pour en savoir plus
Page de l'exposition sur le site des Missions Etrangères de Paris
Dossier de presse
Lien vers la conférence donnée le 30 septembre 2023 (à venir)
Détails pratiques
Lieu : Missions Etrangères de Paris – Mission 128, 128 rue du Bac, 75007 Paris
Dates : du 15 septembre au 18 novembre 2023
Horaires : du mardi au samedi, de 10h à 18h
Tarif : sans inscription, participation libre
Jean-Luc Pinol, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’ENS Lyon, est le commissaire de l'exposition : Shanghai 1937, la zone Jacquinot, 1ère zone de réfugiés de l’histoire présentée au Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris.
Cette exposition sur l’aide aux civils en temps de guerre à partir de l’expérience de Shanghai durant le conflit sino-japonais, est aussi un hommage au père missionnaire français, Robert Jacquinot de Besange, jésuite, qui a donné son nom à la première zone de refuge (citée en exemple dans les commentaires de la Convention de Genève de 1949). Elle se présente sous la forme d'une dizaine de panneaux ainsi que par la projection continue du film Le Samaritain de Shanghai, de Sébastien Cassen, produit par la société VraiVrai Film.
Détails pratiques :
Lieu : Centre Sèvres, 35b rue de Sèvres, 75006 Paris
Dates : du 16 au 18 septembre, et en format réduit jusqu'au 13 octobre 2023
Horaires : de 14h à 18h
Tarif : sans inscription, participation libre
Le premier roman de Marie-Astrid Prache nous plonge dans l'émouvant destin de Larissa Andersen. Née en Sibérie, exilée en Chine en 1922, Larissa est danseuse, poète, muse, apatride, peut-être même espionne. Femme infiniment libre et vivante, amoureuse endiablée, artiste accomplie, qui est cette inconnue qui a fait les grandes heures du Paris de l'Orient ?
Près d'un siècle plus tard, une autre femme en quête d'oubli à Shanghai croise le regard de Larissa Andersen. À travers ses photos, ses journaux intimes, ses lettres, ses poèmes, un dialogue sensible se tisse entre ces deux femmes au carrefour de leur existence.
De ces destins croisés naît une ode poignante à Shanghai, ville aussi insaisissable que l'eau dont elle est tirée, terre d'accueil où, toujours, l'on ne fait que passer.
Ce roman, remarquablement bien documenté, nous fait revivre l’histoire des russes qui, au lendemain de la révolution d’octobre, choisirent de quitter leur pays. Sur les pas de Larissa, nous suivrons le cheminement mouvementé de ces émigrés vers la Chine. Nous suivrons Larissa dans le Shanghai des années 30 jusque dans des temps plus troublés des années 1950. Des emprunterons des chemins qui se croisent et s’emmêlent avec le Shanghai d’aujourd’hui.
Le dernier roman graphique de Marcelino Truong met en scène le jeune Minh, artiste à Hà Nội en 1953, que sa famille aisée décide de mettre à l'abri à la campagne afin qu'il ne soit pas enrôlé dans l'Armée Nationale de l’État associé du Việt Nam. Arrivé sur place, il est alors obligé de rejoindre le Việt Minh ! Le voilà en route pour la Chine, puis Điện Biên Phủ.
Très documenté, ce roman aborde de façon balancée un sujet largement ignoré : le soutien décisif de la Chine de Mao dans la Guerre d'Indochine.