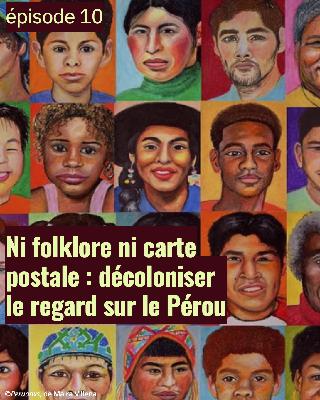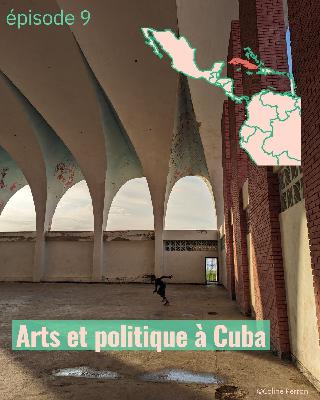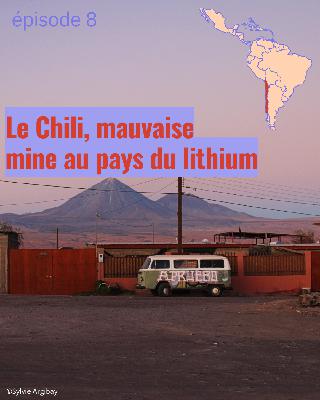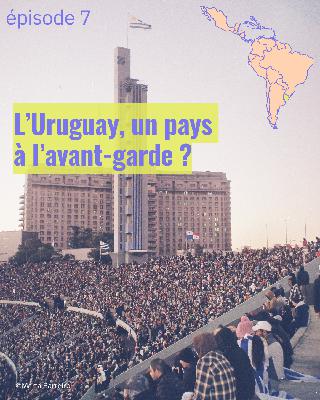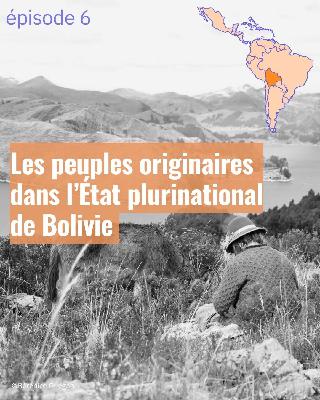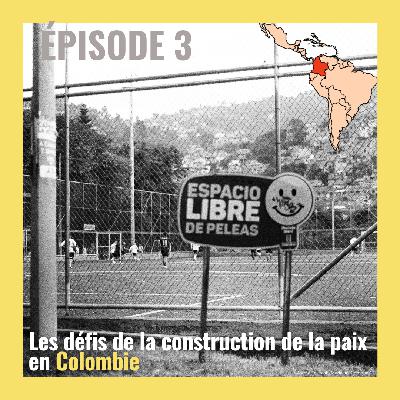Discover Semillas Latinas
Semillas Latinas

Semillas Latinas
Author: Semillas Latinas
Subscribed: 2Played: 14Subscribe
Share
© 2025 - www.radiocampusparis.org
Description
Semillas Latinas est une émission dédiée à la célébration des cultures d’Amérique latine et à l’analyse des enjeux socio-politiques qui s’y déploient. Un pays spécifique et une thématique centrale, en lien avec l'histoire, les traditions et les défis contemporains de la région concernée, sont mis à l'honneur pendant une heure, un samedi soir par mois, à 20h.
Nous offrons à nos auditeur·ices des approches variées - actualité politique, chroniques littéraires, artistiques et archéologiques, analyses urbanistiques et environnementales, critiques et recommandations culturelles - auxquelles vient s'ajouter l’éclairage d’expert·e·s, d’activistes et d’étudiant·e·s invité·es dans le studio. Une attention particulière est accordée à la mise en lumière des multiples combats pour la défense des droits humains en ce premier quart du XXIe siècle.
Avec Semillas Latinas, nous espérons réussir à semer de petites graines (“semillas”) dans les esprits, graines vouées à germer et à faire mûrir les intérêts, voire les passions que peuvent susciter les pays latino-américains en France, depuis le Mexique jusqu’au Cône Sud.
Page instagram : semillaslatinasradio
Une émission de Sylvie Argibay, Manon Méziat, Anael Michel, Paloma Petrich, Pauline Rossano et Astrée Toupiol, avec Mickael Adarve à la réalisation.
L'habillage sonore de Semillas Latinas a été réalisé par Iñaki Modrego, Emilio Rossano et Pauline Rossano, que nous remercions chaleureusement.
Nous offrons à nos auditeur·ices des approches variées - actualité politique, chroniques littéraires, artistiques et archéologiques, analyses urbanistiques et environnementales, critiques et recommandations culturelles - auxquelles vient s'ajouter l’éclairage d’expert·e·s, d’activistes et d’étudiant·e·s invité·es dans le studio. Une attention particulière est accordée à la mise en lumière des multiples combats pour la défense des droits humains en ce premier quart du XXIe siècle.
Avec Semillas Latinas, nous espérons réussir à semer de petites graines (“semillas”) dans les esprits, graines vouées à germer et à faire mûrir les intérêts, voire les passions que peuvent susciter les pays latino-américains en France, depuis le Mexique jusqu’au Cône Sud.
Page instagram : semillaslatinasradio
Une émission de Sylvie Argibay, Manon Méziat, Anael Michel, Paloma Petrich, Pauline Rossano et Astrée Toupiol, avec Mickael Adarve à la réalisation.
L'habillage sonore de Semillas Latinas a été réalisé par Iñaki Modrego, Emilio Rossano et Pauline Rossano, que nous remercions chaleureusement.
13 Episodes
Reverse
Pour ce dernier épisode de la saison, les Semillas Latinas explorent les héritages coloniaux qui perdurent dans la société péruvienne contemporaine. Loin des clichés folkloriques et des représentations touristiques, cette émission adopte une démarche décoloniale pour analyser les traces persistantes de plus de trois siècles de domination coloniale : génocide de 90% de la population autochtone, imposition d'un système féodal, et mise en place de l'Inquisition.
Le paradigme décolonial, pensée critique qui émerge dans les années 1990 en Amérique latine, analyse comment les logiques coloniales survivent aux indépendances politiques. Cette approche examine la persistance des rapports de pouvoir coloniaux dans trois domaines fondamentaux : les structures de pouvoir économique et politique; la hiérarchisation des savoirs considérés comme "légitimes", la marginalisation systématique de certains corps, langues et cultures.
José Carlos Mariátegui, intellectuel marxiste péruvien, avait déjà observé que l'indépendance politique n'avait pas démantelé l'ordre colonial. Les structures économiques, l'accès à la terre et l'exploitation des ressources continuaient de reproduire les inégalités héritées de la période coloniale. Cette analyse sera approfondie par d'autres penseurs péruviens comme Aníbal Quijano avec sa notion de "colonialité du pouvoir".
Astrée Toupiol et Paloma Petrich analysent le racisme structurel péruvien, héritage direct des hiérarchies raciales coloniales. Ce système produit de véritables fractures géographiques, sociales et politiques, où les plus marginalisé·e·s demeurent invisibilisé·e·s. Cette situation génère une "schizophrénie sociale" paradoxale : d'un côté, on célèbre le poncho pour attirer les touristes, de l'autre, on méprise le quechua dans les espaces éducatifs et professionnels. À l'ère numérique, cette violence se double d'un phénomène de bashing régional, où les Péruvien·ne·s subissent une double discrimination: un racisme interne profondément enraciné ; et des représentations péjoratives relayées à l'échelle latino-américaine… créant une forme de "concours de mépris” entre peuples frères. Face à cette violence, de nouvelles voix émergent sur les réseaux sociaux comme la chanteuse de pop andine Milena Warthon ou l'artiste franco-péruvienne Claudia Rivera invitent à décoloniser les corps, les voix et les imaginaires.
Sylvie Argibay s'entretient avec Lissell Quiroz autour de son ouvrage Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d'Amérique latine, co-écrit avec Philippe Colin (La Découverte, 2023). L'entretien explore la théorie décoloniale qui prend l'invasion de l'Amérique en 1492 comme point de départ pour déconstruire le paradigme de la modernité et questionner la colonialité du pouvoir. Au Pérou, cette colonialité divise les populations : les plus précaires sont les personnes racisées, les indigènes "acculturé·e·s" en ville (cholos), et les afrodescendant·e·s. Cependant, la colonialité génère aussi des résistances multiformes avec les communautés préservant leurs modes de vie et cosmovisions traditionnelles ou les révolutions historiques comme celle de Tupac Amaru…
Manon Méziat décortique les biais coloniaux du tourisme au Machu Picchu. Le tourisme, majoritairement occidental et blanc, transforme Cusco en "laboratoire de classification raciale". Cette mise en tourisme ressemble à une appropriation sociale du patrimoine, monopolisant les services au profit des élites et créant une division sociale du travail. Ce processus d'exotisation transforme les destinations en "paradis" fantasmés par l'imagination occidentale, essentialisant les rapports de pouvoir de genre, de race et de classe.
Pauline Rossano nous emmène dans un voyage sonore à travers les Andes précolombiennes, où le fil transcende sa fonction matérielle pour devenir mémoire et langage vivant. Sous l'Empire inca, le tissage devient affaire d'État. On tisse même les données avec les quipus, ces cordes nouées servant à enregistrer histoires et naissances. L'arrivée des Espagnols bouleverse cette tradition : importation du coton, création d'ateliers coloniaux (obrajes), industrialisation de l'art du fil. Malgré cette colonisation textile, les femmes andines perpétuent leur art dans le secret des foyers, forme de résistance silencieuse. À l'ère de la mondialisation, hommes et femmes d'ailleurs apportent leurs motifs et symboles. Le tissage devient ainsi miroir culturel vivant et métaphore d'un pays aux mille visages.
Anael Michel analyse l'expression du racisme dans les arts coloniaux. Après le Traité de Tordesillas qui octroie l'influence péruvienne à l'Espagne, se crée le vice-royaume du Pérou avec ses hiérarchies raciales complexes. Malgré l'interdiction officielle, les métissages créent de nouvelles catégories socio-ethniques, et sous l'influence des Lumières hispaniques, se développe un goût pour la classification rationaliste des catégories humaines basée sur la couleur de peau. Cette obsession classificatoire trouve son expression artistique dans les "tableaux de castes", œuvres coloniales destinées à montrer la diversité humaine des colonies selon une grille de lecture raciale rigide.
Vous écouterez, dans cet épisode, de la cumbia péruvienne,avec le groupe Agua Marina et son morceau "El Casorio" et la chanteuse Rossy War avec "Nunca pensé llorar". Un poème de l'artiste afro-péruvienne Victoria Santa Cruz, inspiré d'une blessure d'enfance liée au racisme, couronnera cet épisode.
Un épisode réalisé par encore une fois grâce au génie de Mickaël Adarve.
Excellente écoute sur Semillas Latinas !
Équipe de production :
Présentation : Mickaël Adarve et Astrée Toupiol
Interview : Sylvie Argibay
Chroniques : Anael Michel, Manon Méziat, Paloma Petrich, Pauline Rossano, Astrée Toupiol
Réalisation : Mickaël Adarve
Les liens entre les arts et la politique sont au cœur de cet épisode dédié à Cuba ! Cet État insulaire des Caraïbes où « effervescence culturelle » rime avec « crise structurelle », où la profusion créatrice défie la répression politique, où le chemin de l’exil complexifie encore plus le regard porté sur l’île… La situation actuelle contraste nettement avec le pouvoir de fascination qu’exerce encore Cuba dans nos imaginaires, et plus encore avec les idéaux de la révolution cubaine.
Pour mieux comprendre les politiques culturelles menées à Cuba entre 1959 et la fin du XXe siècle, Coline Perron, doctorante en histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg, revient sur cette génération d’artistes formée à partir de la révolution, lorsque l’accès à la culture et à l’éducation est devenu une priorité absolue. Elle analyse aussi les tensions qui ont progressivement émergé entre les artistes et le régime, du fait de la volonté du gouvernement de prendre le contrôle sur la scène artistique.
Cette problématique se conjugue au présent dans la chronique que Manon Méziat et Paloma Petrich consacrent à la naissance du Mouvement San Isidro (MSI), un collectif d’artistes, de journalistes, et d’universitaires cubain·e·s tous et toutes unies autour d’un mot d’ordre : la liberté d’expression. Le groupe tire son nom du quartier de La Havane où s'est formé en septembre 2018, en réaction au décret 349. Cette mesure impose que toute expression artistique soit préalablement approuvée par les institutions officielles.
Ce mois-ci, l’invitée de Semillas Latinas n'est autre que Janette Habel, politologue aguerrie et chercheuse associée à l’Institut de Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL). Elle revient sur les causes de la crise multifactorielle que traverse l’île, liée à l’embargo états-unien, à la pandémie de covid-19 mais aussi à des erreurs politiques aux lourdes conséquences, de la part du régime castriste.
Cet épisode se poursuit avec une riche palette de chroniques culturelles. Pauline Rossano analyse le cinéma cubain des années 1960, profondément traversé par les idéaux révolutionnaires. L’œuvre de Sara Gómez, première femme à cubaine à réaliser un long-métrage, et illustration de ce cinéma engagé, est ici mise à l’honneur. Critique du processus révolutionnaire, elle en interroge les angles morts : le patriarcat, le racisme et l'héritage colonial.
Enfin, un double hommage à la musique cubaine est rendu par Mickaël Adarve, qui revient aux sources de la musique afro-cubaine, et par Astrée Toupiol, qui nous parle de ce que c’est qu'être musicien·ne à Cuba en pleine crise. Avec des machines rafistolées, des soirées sans électricité, la fête continue – intense, débrouillarde et profondément vivante !
Et bien sûr, profitez tout au long de l’émission de morceaux de musique cubaine, avec le titre « Patria y Vida », interprété par six artistes afro-cubains et devenu un incontournable chant de révolte contre le régime castriste, puis « Último Adiós » de La Lupe, chanteuse de salsa, bolero et boogaloo.
Excellente écoute !
Présentation : Anael Michel et Pauline Rossano // Interview : Sylvie Argibay // Chroniqueuses : Coline Perron, Manon Méziat, Paloma Petrich, Pauline Rossano, Mickael Adarve et Astrée Toupiol // Réalisation : Mickaël Adarve.
Con carne, mais surtout con lithium. C’est au Chili que vous fait voyager l’équipe de Semillas Latinas ce mois-ci !
Ce pays, riche en paysages et en matières premières, est le deuxième producteur mondial de lithium, derrière l’Australie. Surnommé « l’or blanc du XXIe siècle », le lithium est un métal hautement stratégique pour la transition énergétique promue par les pays du Nord Global pour sortir des énergies fossiles. Dès les années 70, sous Salvador Allende, l’extraction minière – alors centrée sur le cuivre – était nationalisée et pensée comme levier de développement. Aujourd’hui encore, le pays continue d’exploiter ses ressources naturelles pour faire tourner son économie. Vincent Arpoulet, doctorant en histoire économique à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL) de la Sorbonne-Nouvelle, a été l’invité de Semillas Latinas pour parler des coûts sociaux et environnementaux de l’extraction de lithium dans le nord du pays.
Astrée Toupiol retrace, dans sa chronique, le processus constitutionnel chilien. Dans ce pays, la Constitution rédigée en 1980 sous le régime militaire d’Augusto Pinochet, reste marquée par l’idéologie néolibérale de la dictature (1973-1990) avec un rôle minimal de l’État. Source de critiques de la part de la population chilienne, cette Constitution a été remise en question lors de l’Estallido social, une série de manifestations qui débutent en 2019, en réaction à l’augmentation du prix de métro à Santiago.
Anael Michel nous propose quant à elle de revenir sur le conflit pluriséculaire qui oppose l’État chilien et le peuple mapuche. Elle retrace l'histoire de cette nation autochtone et explique les revendications territoriales qui sont les siennes, dans un pays qui a toujours nié sa diversité ethnique et culturelle.
En seconde partie d’émission, Manon Méziat nous propose un tour du monde des poètes et poétesses chilien·n·es. La dimension internationale est très présente chez les grandes figures littéraires du XXe siècle et s’explique par le contexte politique de l’époque : nombre d’intellectuel·le·s sont contraint·e·s à l’exil sous le régime dictatorial de Pinochet.
Pour clôturer cette émission, Pauline Rossano nous parle d’un art urbain, populaire et politique, qui ne cesse d’évoluer et de se réinventer : le street art. Au Chili, c’est à Santiago ou encore à Valparaiso que l’on peut admirer les façades aux milles couleurs.
Immergez-vous tout au long de l’émission dans la musique chilienne, avec la chanteuse féministe et engagée Ana Tijoux et son morceau « Shock », une chanson composée en 2011, qui critique le néolibéralisme prôné par l’État chilien ; et Calle Mambo, un groupe chilien fusionnant cumbia, hip-hop et musiques andines et leur morceau « Huracán ». Le groupe sera en concert au Tamanoir le 17 mai !
Animation : Paloma Petrich et Mickaël Adarve // Co-interview : Sylvie Argibay // Chroniqueuses : Astrée Toupiol, Anael Michel, Manon Méziat et Pauline Rossano // Réalisation : Sylvie Argibay
Ce mois-ci, l’Uruguay et ses politiques sociales avant-gardistes sont mises à l’honneur !
L’Uruguay est le plus petit pays d’Amérique du Sud, coincé entre deux géants, l’Argentine et le Brésil, ce qui lui a valu d’être surnommé el paisito, le « petit pays », avec une population de seulement 3,4 millions d’habitant·e·s. L’Uruguay se distingue pour être le pays le moins inégalitaire d’Amérique latine qui jouit d’une stabilité démocratique remarquable.
Ce pays s’est fait connaître pour avoir élu, en 2009, le président le plus pauvre du monde ! Cette figure n’est autre que José « Pepe » Mujica, ancien guérillero, célébré à l’international pour son mode de vie austère et pour la promulgation, sous son quinquennat (2010-2015), de trois lois qui ont fait de l’Uruguay un pays à l’avant-garde : le droit à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), le mariage entre personnes de même sexe et la légalisation du cannabis, une première mondiale ! Dans cet épisode, nous revenons sur le contenu et les limites de ses politiques sociales au travers d’un échange polyphonique avec Manon Méziat et Sylvie Argibay qui nous partagent leur expertise sur le sujet !
En l'honneur de la semaine internationale des droits de femmes, Anael Michel nous embarque à la découverte de la 5ème édition du festival Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud qui s’est tenu à Paris du 6 au 9 mars 2025. Ce festival de cinéma militant œuvre à la visibilisation des femmes et des personnes queer d’Amérique du Sud. Elles nous parle, dans ce reportage, des inégalités de genre dans l’industrie du cinéma face à l’omniprésence des hommes dans tous les métiers les plus valorisés du 7ème art.
Astrée Toupiol, quant à elle, nous emmène découvrir un modèle alternatif d’accès au logement : les coopératives d’habitat, un modèle qui se développe depuis plusieurs décennies pour répondre aux besoins des ménages modestes. Elle nous explique en quoi les coopératives de logement en autogestion, basées sur l’autoconstruction et la propriété collective sont une solution innovante pour répondre à l’urgence habitationnelle !
L’exploration du contexte historique et politique uruguayen se poursuit avec Pauline Rossano et sa chronique fictionnelle « Amaro et les Tupamaros » qui nous embarque pour une exploration sonore de la révolte des guérilleros Tupamaros et du coup d’État militaire de 1973 qui s’en est suivi.
Pour clôturer l’émission, Manon Méziat et Sylvie Argibay nous parlent du candombe, un genre musical et une pratique communautaire, inscrit en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, et représentant la manifestation culturelle la plus notoire de la communauté afro-descendante uruguayenne.
Vous écouterez, tout au long de l’épisode, les morceaux entêtants d’artistes peu visibilisé·e·s mais talentueux·euses : la chanteuse engagée Isabel Lenoir et ses morceaux qui fusionnent candombe, zamba et bossa nova et célèbrent les paysages montévidéens, avec son titre « Gurí » ; le duo folklorique Cass & Guille Saporta avec son morceau « Isla de Flores » qui nous emporte dans les rues de Montevideo à la rencontre des tambours du quartier de Palermo ; et le duo de chanteurs populaires uruguayens formé par Pepe Guerra et Braulio López, Los Olimareños, et leur morceau « Adios Mi Barrio ».
Et comme toujours, à la réalisation de cet épisode, l’indispensable Mickaël Adarve.
Animation : Manon Méziat et Sylvie Argibay // Micro ouvert : Manon Méziat, Sylvie Argibay et Paloma Petrich // Reportage : Anael Michel // Chroniqueuses : Astrée Toupiol, Pauline Rossano, Manon Méziat et Sylvie Argibay // Réalisation : Mickaël Adarve
Pour le 8 mars, Semillas Latinas, La Matinale de 19 heures, et On se lève et on se casse vous proposent une émission crossover pour aborder le thème de la santé dans une perspective féministe !
Quelles conséquences ont les erreurs et les absences de diagnostic ?
Où en est la santé reproductive en 2025 ?
Comment le néolibéralisme mondialisé impacte-t-il le corps et la santé des femmes ?
On tente d'y répondre en deux heures de discussion en non-mixité, entre bénévoles et avec nos invitées spécialistes du sujet :
Lissell Quiroz est docteure en histoire et professeur des universités à Cergy Paris Université. Ses recherches portent sur l'histoire des femmes, des féminismes et de la santé dans les Amériques.
Violette Suquet est dessinatrice et co-autrice d'Endogirls, une enquête en bande-dessinée qui met en lumière le témoignage de femmes atteintes d'endométriose.
Santé les reuss, c'est votre émission remède contre le patriarcat !
Animation : Garance Roubieu // Co-animation : Sylvie Argibay & Pauline // Chroniques : Manon Meziat, Paloma Petrich, Tiphaine, Rosalie Berne & Juliette Coppo // Réalisation : Gabrielle Bayer // Habillage sonore : Electra Mannara // Coordination : Maïwenn Filio
Ce mois-ci, l’équipe de Semillas Latinas vous fait voyager dans un pays unique, singulier et façonné depuis des milliers d’années par la diversité de ses nombreux peuples autochtones : la Bolivie !
La Constitution Politique de l’État plurinational de Bolivie de 2009 reconnaît 37 langues officielles et 36 peuples indigènes. En effet, l’arrivée à la présidence en 2006 d'Evo Morales, fondateur du Mouvement vers le Socialisme (MAS) et fervent défenseur de l’indigénisme, s’est traduit par une réduction significative de la pauvreté et une progressive reconnaissance des droits des peuples autochtones.
Manon Méziat et Sylvie Argibay nous invitent quant à elles à réfléchir au concept aymara de Suma Qamaña (Vivir Bien) et à la notion de justice indigène, à travers une riche interview avec Elise Gadea, socio-anthropologue à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et autrice d’une thèse sur la justice indigène et le pluralisme juridique en Bolivie, et Jordie Blanc Ansari, maîtresse de conférence à l’Université Panthéon Sorbonne-IEDES et autrice d’une thèse portant sur les inégalités socio-environnementales en Bolivie et sur l’appropriation sociale et politique du concept du Vivir Bien.
En seconde partie d’émission, nous retrouvons le duo radiophonique incarné par Paloma et Astrée qui nous parlent des Cholitas, ces meufs super badass connues et médiatisées pour leurs exploits sportifs ! Mais les Cholitas c’est bien plus que ça puisque leurs pratiques sportives symbolisent leur lutte pour l’égalité de genre et la justice climatique. Peut-on dire alors que les Cholitas sont des figures écoféministes, ce mouvement théorique et militant qui dresse un parallèle entre l’oppression des femmes et l’exploitation de la nature ? Nos chroniqueuses ouvrent la réflexion !
Pour clôturer l’émission, Anael Michel nous parle dans sa chronique culturelle du Carnaval de Oruro, qui a eu lieu cette année du 22 février au 4 mars 2025 dans la ville de Oruro. Moins connu en France que ses homologues brésiliens, le Carnaval de Oruro a une portée culturelle, historique et artistique importante qui lui a valu d’être inscrit à la liste du patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO en 2008. Au cours de ces 50 dernières années, cette célébration religieuse en l’honneur de la Vierge du Socavón, la sainte patronne locale, a acquis une vivacité sans précédents.
Laissez-vous porter tout au long de l’émission au rythme de la musique andine, avec « Ukhamampi Munataxa » du groupe de musique folklorique Los Kjarkas et du rock bolivien avec « Hoja Verde » du groupe Atajo.
Et comme toujours, à la réalisation de cet épisode, notre cher Mickaël Adarve.
Animation : Pauline Rossano // Co-interview : Manon Méziat et Sylvie Argibay // Chroniqueuses : Astrée Toupiol, Paloma Petrich et Anael Michel // Réalisation : Mickaël Adarve
Le 10 janvier 2025, le président vénézuélien Nicolás Maduro a prêté serment pour un troisième mandat de six ans. Dirigeant d’une main de fer le Venezuela depuis la mort d'Hugo Chávez en 2013, celui-ci a alors déclaré qu’il s’agissait d’une « grande victoire pour la démocratie vénézuélienne ». Théâtre d’une crise politique sans fin, le Venezuela voit éclore de nombreuses manifestations dans tout le pays, manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre. Une crise qui peut être résumée en quelques mots : élections contestées, répression, arrestations, morts et incertitudes.
Pour mieux comprendre le positionnement politique de Nicolás Maduro, Paloma Petrich et Manon Méziat décortiquent plusieurs courants de pensée et phénomènes sociaux fondateurs de la gauche latino-américaine, comme le bolivarisme, le chavisme ou encore le caudillisme, en s’interrogeant sur leur héritage et leur instrumentalisation politique par le pouvoir vénézuélien.
Ensuite, Sylvie Argibay nous propose de revenir sur le contexte politique actuel à travers son entretien avec l’enseignant-chercheur Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine à l’Université de Rouen. Le Venezuela traverse une crise multifactorielle sans précédent. Les organisations de la société civile dénoncent une montée en puissance de l’autoritarisme, compte tenu de la fermeture progressive de l’espace politique qui s’accompagne d’une politique de militarisation massive. Dans ce contexte, comment l’opposition parvient-elle à se mobiliser ? Quelle a été la réaction de la population vénézuélienne à la suite de la réélection contestée de Nicolás Maduro ? Comment le régime chaviste a-t-il réagi face à ces mobilisations d’ampleur ? Nous évoquons toutes ces questions et bien d'autres encore concernant le futur de la vie démocratique au Venezuela.
Afin de nous éclairer sur la crise des réfugié·es que traverse le Venezuela, l'équipe de Semillas Latinas a eu pour invité spécial, Mateo Rey. Cet étudiant franco-vénézuelien nous raconte l’exil et la diaspora vénézuélienne, à partir du vécu de ses proches. Débuté sous la présidence d’Hugo Chávez et poursuivi sous celles de Nicolás Maduro, le pays est confronté à un exode massif, avec plus de 7 millions de personnes ayant quitté le pays en quête d’une vie meilleure. Cela s’explique notamment par la crise économique qui a frappé le pays à partir de 2013. Si le phénomène migratoire a d’abord concerné des professionnel·le·s hautement qualifié·e·s, des universitaires et des jeunes diplômé·es, celui-ci s’est énormément intensifié et étendu, à partir de 2015, à toutes les classes sociales.
L’exploration des réalités contemporaines se poursuit avec Manon Méziat qui nous parle de « La fonte du dernier glacier vénézuélien : chronique d’une disparition annoncée ». En ce début d'année 2025, le Venezuela est le premier pays au monde à avoir perdu la totalité de ses glaciers, qui s'étendaient il y a un siècle sur une superficie de 1000 hectares. La Corona, qui se situait dans la Sierra Nevada de Mérida, à presque 5000 mètres d’altitude, est désormais réduit à une maigre étendue de glace, vouée à disparaître dans les cinq prochaines années. À plus ou moins longue échéance, le dérèglement climatique condamne la grande majorité des glaciers tropicaux du globe. Avec la cryosphère, ce sont des écosystèmes entiers qui s'éteignent, et d'autres qui émergent, présentant leur lot d'incertitudes et de menaces.
Enfin, Pauline Rossano conclut cette émission par la présentation d'un élément incontournable de la cuisine vénézuélienne : la cassave, préparée à partir du manioc et riche d’une histoire pluriséculaire. Cette tradition culinaire, mêlant histoire, artisanats, savoir-faire et pratiques traditionnelles, a été inscrite, en décembre 2024, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l'UNESCO.
L’épisode est rythmé par un morceau de salsa, avec le titre « Llorarás » de l'artiste mythique Oscar D'León, mais aussi par de la musique électronique, avec le morceau « Agua » de la chanteuse, auteure et compositrice franco-vénézuélienne Sophie Fustec, plus connue sous le pseudo de La Chica, remixé par Uji.
Et comme toujours, à la réalisation de cet épisode, l'indispensable Mickaël Adarve.
Animation : Anael Michel // Interview : Sylvie Argibay // Chroniques : Mateo Rey, Paloma Petrich, Manon Méziat et Pauline Rossano // Réalisation : Mickaël Adarve
En décembre immergez-vous dans les cultures et mémoires argentines, riches et encore en construction, à la fois histoires fondatrices de l’identité nationale et quêtes collectives pour cet immense pays du Cône Sud.
Parmi elles, la dictature militaire, épisode sombre des années 1976-1983, où les crimes d’État perpétrés continuent d’hanter le pays. De la place de Mai avec le Collectif des Mères et Grands-mères des disparu·e·s de la dictature au Centre International de Culture Populaire de Paris en passant par le musée et lieu de mémoire de l’ex ESMA à Buenos Aires, nos reportrices Sylvie Argibay et Anael Michel ont plongé dans les luttes incessantes des militants, militantes et organisations de défense des droits humains pour réclamer mémoire, vérité et justice. Elles nous emmènent à travers les anciens centres de détention et de répression de Buenos Aires transformés en lieux de mémoire et de promotion des droits humains, qui font partie des quelques 800 sites mémoriels recensés sur le territoire argentin. Elles ont recueilli la parole de Juan Burstein, historien et coordinateur du service des visites guidées du musée de l’ESMA, et reviennent ensuite sur les procès pour crimes contre l’humanité de la dictature avec Claudia Lencina, avocate et directrice des affaires juridiques au secrétariat national des droits humains.
Se rappeler, mais aussi se rassembler et échanger font partie du processus de guérison, comme le fait le Colectivo Argentina en Lucha à Paris, créé il y a un an par un groupe d’ami·e·s qui s’insurgeaient contre l’élection de l’ultralibéral et auto proclamé “anarcho-capitaliste” Javier Milei lors de l’élection présidentielle argentine de novembre 2023. Nos chroniqueuses ont pu rencontrer Tamara Yapura, co-fondatrice du collectif, qui a raconté au micro de Semillas Latinas leurs actions menées en France pour lutter contre le négationnisme fort qui imprègne le gouvernement Milei.
Le voyage dans le temps et l’espace argentin se poursuit avec la chronique littéraire de Manon Méziat, qui nous emmène pour une odyssée queer et fantasque à travers la pampa argentine. Bienvenue au pays des gauchos, mais cette fois-ci le mythe national fondateur du gaucho Martín Fierro de José Hernández est détourné par le récit queer et féministe de l’autrice Gabriela Cabezón Camara dans Las aventuras de China Iron ! Si vous voulez faire un dernier cadeau de noël post-noël qui vous fasse oublier ces repas tumultueux, cette épopée est pour vous…
Puis Pauline Rossano et Mickaël Adarve nous emmènent dans un tango endiablé à Buenos Aires, capitale culturelle de ce style musical et de cette danse, et dont les origines sont plurielles… Immigrant·e·s européen·ne·s, candombe africain et Habanera Cubaine, suivez nos chroniqueur·euse·s et danseur·euse·s pour un temps dans les pas d'une histoire populaire, migratoire et rythmique captivante.
Et nous retrouvons Anael Michel pour une chronique peu commune : elle nous fait découvrir l’artiste argentin Tomas Saraceno, architecte de formation et génie artistique presque devenu guérisseur tant ses œuvres semblent bouleverser. Anael témoigne en effet de l’expérience immersive qu’elle a pu vivre à New York lors de l’exposition de Saraceno au centre d’art The Shed en 2022, « Libérez l’air : Comment entendre l’univers dans une araignée/toile ». Vous l’avez deviné, ce dernier utilise le symbole des araignées et de leurs toiles pour nous rappeler le lien qui unit les hommes à l’écosystème terrestre…
L’épisode sera rythmé par une zamba composée par le pianiste argentin Ariel Ramírez et l’écrivain Félix Luna, « Alfonsina y el mar », puis par « Nos siguen pegando abajo », chanson engagée sortie juste après la chute de la dictature dénonçant les violences contre les civils de Charlie Garcia. Le groupe folk du nord-ouest argentin Los Chalchaleros sera également mis à l’honneur avec leur chanson « Viva Jujuy » qui célèbre la beauté de cette région !
Cette émission a été réalisée par Mickaël Adarve, que nous remercions chaleureusement.
Chèr·e·s auditeurices, bonne écoute !
Animation : Paloma Petrich // Reportages : Anael Michel et Sylvie Argibay // Chroniques : Manon Méziat, Anael Michel, Mickaël Adarve et Pauline Rossano // Réalisation : Mickaël Adarve
Ce mois-ci, la Colombie est mise à l'honneur à travers le prisme de la construction de la paix. Cette quête, amorcée avec la signature, en 2016, de l’Accord de Paix historique entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et l’ex-guérilla des FARC-EP (Forcées Armées Révolutionnaires de la Colombie – Armée du Peuple), reste un défi majeur. Le pays est profondément marqué par le conflit armé dont l’origine remonte aux années 1960, puisant ses racines dans les inégalités structurelles du pays, et qui se poursuit encore aujourd’hui, entre l'État colombien et différents groupes armés : les guérillas subsistantes (ELN et dissidences des FARC), groupes paramilitaires, bandes criminelles de zone urbaine, soit autant de groupes parfois associés au narcotrafic.
« La Paix avec la Nature », c’est le slogan d’un événement majeur qui s’est tenu à Cali, du 21 octobre au 1er novembre 2024 : la COP16 sur la biodiversité. Comme l’expliquent nos chroniqueuses Paloma Petrich et Manon Méziat, ce slogan souligne le lien entre la préservation de la biodiversité et l'édification de la paix en Colombie. D’une part, nous analysons la responsabilité des acteurs armés dans la déforestation et l’exploitation minière illégale, tandis que, d’autre part, nous présentons les figures politiques majeures de cette COP et le rôle accordé aux peuples autochtones.
Sylvie Argibay nous invite ensuite à penser les politiques de construction de la paix en Colombie à travers une interview avec Paula Martínez Takegami et Andrea Mora, deux membres de l’association Ciudadanias por la Paz de Colombia. « Citoyennetés pour la paix de Colombie » cherche à promouvoir la construction d’un pays juste et démocratique, à travers le concept de « paix positive et complète », qui souligne la nécessité de partir du tissu territorial d’organisations sociales, notamment celles permettant la réparation des survivant·es du conflit et la réintégration dans la société colombienne des signataires de l’Accord de Paix. Astrée Toupiol et Sylvie Argibay vous emmènent ensuite à Bogota, à la découverte de la Casa de la Paz, une initiative inspirante de réincorporation et de réconciliation.
En seconde partie d’émission, Pauline Rossano nous propose de nous plonger dans d’une époque marquante du cinéma colombien, caractérisée par l'émergence d’une génération nouvelle de réalisateur·ices qui s’attachent à mettre à l’écran les problématiques sociétales.
Anael Michel analyse, enfin, la légende de l’Eldorado, qui a obsédé les colonisateurs européens, suscité des vocations chez les chasseurs de trésors et influencé de nombreuses œuvres de fiction, et ce jusqu’à aujourd’hui. Cette « cité d’or » imaginaire trouverait sa source dans les traditions fastueuses d’un peuple autochtone, les Muiscas, grands métallurgistes. La convoitise coloniale est mise en parallèle avec le trafic illicite d’objets archéologiques aujourd’hui, et ses incidences sur le marché de l’art précolombien et les pratiques muséales.
Immergez-vous tout au long de l’émission dans la musique colombienne, représentée par plusieurs styles musicaux : la salsa avec « Cali Ají », composée par le Grupo Niche ; la trova avec « La Sentada » de La Muchacha ; et la cumbia avec « Yo me llamo cumbia » de la compositrice-interprète Totó La Momposina.
Cette émission a été réalisée par notre cher réalisateur Mickaël Adarve.
Animation : Astrée Toupiol // Interview : Sylvie Argibay // Chroniques : Astrée Toupiol, Sylvie Argibay, Paloma Petrich, Manon Méziat, Anael Michel et Pauline Rossano // Réalisation : Mickaël Adarve
Plus grand pays d’Amérique latine, le Brésil se démarque par la diversité de cultures, de populations, de rythmes, d’histoires et de mémoires qu’il abrite. La société brésilienne porte également la marque de fortes inégalités économiques, sociales, raciales et de genre. Si l’élection de Lula da Silva le 30 octobre 2022 a suscité un vent d’espoir, le legs et l’ancrage du bolsonarisme représentent un frein à tout changement social profond. À la veille du second tour des élections municipales, nous revenons, dans cette émission, sur les luttes et les revendications sociales et environnementales des populations historiquement discriminées et invisibilisées.
Paloma Petrich, Sylvie Argibay, Manon Méziat, Anael Michel et Pauline Rossano nous proposent de revivre la 20ème édition du festival Brésil en Mouvements ! à travers une chronique-reportage. Organisé par l’association Autres Brésils depuis 2005, ce festival est consacré au cinéma documentaire brésilien. Cette année, le cinéma afro-brésilien ayant été mis à l’honneur pour le premier weekend du festival, Paloma Petrich et Sylvie Argibay ont choisi de parler du racisme structurel au Brésil, au cours d’une riche interview avec la cinéaste Leila Xavier.
Manon Méziat et Anael Michel nous invitent, quant à elles, à (re)découvrir le Mouvement des Sans-Terre (MST), un mouvement social d’ampleur au Brésil, formé par des paysan·nes qui luttent pour une réforme agraire populaire, et à entendre les voix de deux de leurs militantes, Amanda Samarcos et Juliane Soares Ribeiro, rencontrées au cours de la deuxième partie du festival consacrée aux conflits et aux luttes agraires. La consolidation de l’extrême droite au sein des institutions et des subjectivités au Brésil a aussi été mise en lumière à travers les films et débats qui ont marqué ce festival.
Astrée Toupiol raconte pour Semillas Latinas les initiatives agroécologiques communautaires portées par les Cariocas, les habitant·es de Rio. Dans ce reportage, nous partons à la découverte de l’initiative Redes da Favela Sustentável, un projet qui met en lumière les solutions innovantes développées au sein des favelas, qui se trouvent souvent en première ligne face au changement climatique. Nous découvrons ensuite les hortas comunitárias, ces potagers partagés mis en place par la préfecture de Rio.
En seconde partie d'émission, Pauline Rossano nous invite à écouter les voix féminines majeures de la samba et de la bossa nova au cours d’une immersion sonore, où vous découvrirez certaines idoles de la musique brésilienne, qui se sont aussi illustrées par leur engagement politique en incarnant la voix de l’opposition au régime dictatorial brésilien qui a sévi de 1964 à 1985. Au Brésil, la musique ne cesse de se réinventer grâce à des héritages multiples, un métissage unique au monde et des traditions musicales propres à chaque région.
Enfin, Anael Michel nous parle de l’Amazonie, en revenant sur le développement de la technologie du Lidar qui est à l'origine d’importantes découvertes archéologiques dans ce territoire abritant 10% de la biodiversité mondiale. Des sites époustouflants ont récemment pu être retrouvés, témoignant de civilisations complexes et balayant les idées reçues sur les cultures autochtones. Le processus d'anthropisation précoce et profond de la forêt met à mal le mythe de la « forêt vierge », relayé par nos imaginaires coloniaux et exotiques. À l’heure où l’Amazonie est en proie aux feux de forêts et à la déforestation massive, l’enjeu de la préservation du patrimoine culturel s’ajoute à l’urgence environnementale.
Vous écouterez deux morceaux représentatifs de la musique populaire brésilienne, « Chove Chuva » de Jorge Ben Jor et « Banho de Folhas » de Luedji Luna.
Que soit remercié, pour finir, notre réalisateur Mickaël Adarve, qui rend tous nos projets possibles !
Animation : Manon Méziat // Reportages : Paloma Petrich, Sylvie Argibay, Pauline Rossano, Manon Méziat, Anael Michel et Astrée Toupiol // Chroniques : Pauline Rossano et Anael Michel // Réalisation : Mickaël Adarve
Claudia Sheinbaum vient d’être élue première femme présidente dans l'histoire du Mexique, en juin 2024. Cette climatologue, ancienne membre du GIEC, est membre du parti Morena, le Mouvement de Régénération Nationale. Sheinbaum compte s'inscrire dans la lignée de son prédécesseur, Andrés Manuel López Obrador, en poursuivant ses politiques sociales, tout en entreprenant la transition écologique et en garantissant les droits des femmes au Mexique. Comment Sheinbaum va-t-elle s’y prendre pour combattre le fléau des violences de genre et des féminicides, dans un contexte particulièrement troublé, notamment en matière de crime organisé et de politiques migratoires ? Quel regard les mouvements féministes au Mexique portent-ils sur le bilan de cette ancienne cheffe du gouvernement de la ville de Mexico, de 2018 à 2023 ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous avons eu l’honneur d’interviewer la militante féministe Alexia Prado et Karine Tinat, enseignante-chercheuse au Centre d’Études Sociologiques et au sein du Programme Interdisciplinaire d’Études sur le Genre au Colegio de México. Au cours d’un riche entretien mené par Sylvie Argibay et Paloma Petrich, nous avons discuté de la législation actuelle sur le féminicide au sein des États-Unis mexicains et des politiques de lutte contre les violences de genre en vigueur. Les points de vue de nos deux invitées nous ont offert un aperçu de l’éventail de réactions qu’a suscité l’élection de Sheinbaum parmi les collectifs féministes, oscillant entre attentes fortes mais prudentes et relatif scepticisme quant à l’espoir d’une amélioration prochaine de la situation.
Afin d’élargir le regard, les chroniqueuses de Semillas Latinas se sont intéressées à des publications, des artistes, des expositions, des pratiques sociales et des initiatives politiques ayant trait à la situation des femmes au Mexique, de nos jours, mais aussi au siècle passé, ainsi qu’à des périodes fort anciennes...
Paloma Petrich et Astrée Toupiol proposent de jeter un coup d’œil sur la place des femmes et des minorités de genre dans l’espace public au Mexique. En observant les mesures mises en place ces dernières années par les pouvoirs publics, comme le dispositif Senderos Seguros et les rames de métro réservées aux femmes et aux enfants aux heures de pointe, elles questionnent leur efficacité sur la sécurité et dans la lutte pour prévenir ces violences. Au-delà des politiques publiques, les moyens et les stratégies que ces personnes développent pour exister et s'approprier l’espace public sont mis en lumière, à l'instar des travaux communautaires, des associations de quartier et des mobilisations de masse dans la rue. Dans un pays où 10 femmes sont assassinées chaque jour, il est urgent de visibiliser leur vécu et que la ville devienne le réceptacle des luttes et des forces féministes plutôt que celui des agressions.
Un narco-récit mêlant poésie, roman noir, essai et enquête journalistique haletante au cœur de l’épicentre des féminicides de masse au Mexique : c’est là que vous emmène Manon Méziat dans sa chronique littéraire consacrée à l’ouvrage Des Os dans le désert de Sergio González Rodríguez (2002). Cette enquête menée par le journaliste sur les meurtres de femmes en série perpétrés entre 1990 et 2003 à Ciudad Juárez, dans l’État du Chihuahua, frontalière d’El Paso aux États-Unis, constitue une vibrante quête de justice en même temps qu'un hommage. Plongez dans les entrailles de cette ville, véritable « twilight zone » où s’entremêlent, dans un cycle de violence implacable, haine des femmes, trafic de drogue et classe politique corrompue jusqu’à l’os – jusqu’aux os de ces femmes dans le désert.
Pauline Rossano vous invite à redécouvrir une icône de notre temps, Frida Kahlo. Embarquez pour une exploration imaginaire de la Casa Azul, la demeure emblématique des Kahlo à Coyoacán, à travers une exposition contée ! Un florilège d’œuvres, de lettres et d'objets, tels que sa collection de vêtements traditionnels indigènes, symptomatique d'un fort engagement politique de l'artiste, permettent de penser autrement sa vie, son identité et ses combats. Le parcours hors normes de Frida Kahlo a engendré un mythe puissant, parfois stéréotypé et instrumentalisé au point de trahir les convictions politiques de l'artiste et d'en tordre l’héritage, auquel nous avons souhaité rendre hommage.
Pour finir, Anael Michel vous propose de remonter le temps, 600 ans en arrière, afin d'imaginer ce qu'étaient la vie des femmes et la conception du féminin à México-Tenochtitlan. C'est un des angles-morts de l'exposition « MEXICA, des dons et des dieux au Templo Mayor », présentée au musée du quai Branly d’avril à octobre 2024. La place des femmes dans cette société théocratique, classiste et guerrière vous est révélée au fil des étapes charnières de leur existence, depuis la naissance jusqu’à la mort, en passant par les années d’éducation, le mariage, l’accouchement et parfois, le sacrifice. Une histoire intime et sociale de la civilisation mexica, aux traditions culturelles et religieuses genrées, qui a fait couler beaucoup d’encre… et pas que.
Vous écouterez, tout au long de l’épisode, les morceaux entêtants d’autrices-compositrices-interprètes mexicaines incontournables d’hier et d’aujourd’hui : « María la Curandera » de Natalia Lafourcade, « Canción sin miedo » de Vivir Quintana, et « Piensa en mí » de Chavela Vargas.
Cette émission a été réalisée par Mickaël Adarve, que nous remercions chaleureusement.
Animation : Sylvie Argibay // Co-interview : Sylvie Argibay et Paloma Petrich// Chroniques : Paloma Petrich, Astrée Toupiol, Manon Méziat, Pauline Rossano et Anael Michel // Réalisation : Mickaël Adarve
Claudia Sheinbaum vient d’être élue première femme présidente dans l'histoire du Mexique, en juin 2024. Cette climatologue, ancienne membre du GIEC, est membre du parti Morena, le Mouvement de Régénération Nationale. Sheinbaum compte s'inscrire dans la lignée de son prédécesseur, Andrés Manuel López Obrador, en poursuivant ses politiques sociales, tout en entreprenant la transition écologique et en garantissant les droits des femmes au Mexique. Comment Sheinbaum va-t-elle s’y prendre pour combattre le fléau des violences de genre et des féminicides, dans un contexte particulièrement troublé, notamment en matière de crime organisé et de politiques migratoires ? Quel regard les mouvements féministes au Mexique portent-ils sur le bilan de cette ancienne cheffe du gouvernement de la ville de Mexico, de 2018 à 2023 ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous avons eu l’honneur d’interviewer la militante féministe Alexia Prado et Karine Tinat, enseignante-chercheuse au Centre d’Études Sociologiques et au sein du Programme Interdisciplinaire d’Études sur le Genre au Colegio de México. Au cours d’un riche entretien mené par Sylvie Argibay et Paloma Petrich, nous avons discuté de la législation actuelle sur le féminicide au sein des États-Unis mexicains et des politiques de lutte contre les violences de genre en vigueur. Les points de vue de nos deux invitées nous ont offert un aperçu de l’éventail de réactions qu’a suscité l’élection de Sheinbaum parmi les collectifs féministes, oscillant entre attentes fortes mais prudentes et relatif scepticisme quant à l’espoir d’une amélioration prochaine de la situation.
Afin d’élargir le regard, les chroniqueuses de Semillas Latinas se sont intéressées à des publications, des artistes, des expositions, des pratiques sociales et des initiatives politiques ayant trait à la situation des femmes au Mexique, de nos jours, mais aussi au siècle passé, ainsi qu’à des périodes fort anciennes...
Paloma Petrich et Astrée Toupiol proposent de jeter un coup d’œil sur la place des femmes et des minorités de genre dans l’espace public au Mexique. En observant les mesures mises en place ces dernières années par les pouvoirs publics, comme le dispositif Senderos Seguros et les rames de métro réservées aux femmes et aux enfants aux heures de pointe, elles questionnent leur efficacité sur la sécurité et dans la lutte pour prévenir ces violences. Au-delà des politiques publiques, les moyens et les stratégies que ces personnes développent pour exister et s'approprier l’espace public sont mis en lumière, à l'instar des travaux communautaires, des associations de quartier et des mobilisations de masse dans la rue. Dans un pays où 10 femmes sont assassinées chaque jour, il est urgent de visibiliser leur vécu et que la ville devienne le réceptacle des luttes et des forces féministes plutôt que celui des agressions.
Un narco-récit mêlant poésie, roman noir, essai et enquête journalistique haletante au cœur de l’épicentre des féminicides de masse au Mexique : c’est là que vous emmène Manon Méziat dans sa chronique littéraire consacrée à l’ouvrage Des Os dans le désert de Sergio González Rodríguez (2002). Cette enquête menée par le journaliste sur les meurtres de femmes en série perpétrés entre 1990 et 2003 à Ciudad Juárez, dans l’État du Chihuahua, frontalière d’El Paso aux États-Unis, constitue une vibrante quête de justice en même temps qu'un hommage. Plongez dans les entrailles de cette ville, véritable « twilight zone » où s’entremêlent, dans un cycle de violence implacable, haine des femmes, trafic de drogue et classe politique corrompue jusqu’à l’os – jusqu’aux os de ces femmes dans le désert.
Pauline Rossano vous invite à redécouvrir une icône de notre temps, Frida Kahlo. Embarquez pour une exploration imaginaire de la Casa Azul, la demeure emblématique des Kahlo à Coyoacán, à travers une exposition contée ! Un florilège d’œuvres, de lettres et d'objets, tels que sa collection de vêtements traditionnels indigènes, symptomatique d'un fort engagement politique de l'artiste, permettent de penser autrement sa vie, son identité et ses combats. Le parcours hors normes de Frida Kahlo a engendré un mythe puissant, parfois stéréotypé et instrumentalisé au point de trahir les convictions politiques de l'artiste et d'en tordre l’héritage, auquel nous avons souhaité rendre hommage.
Pour finir, Anael Michel vous propose de remonter le temps, 600 ans en arrière, afin d'imaginer ce qu'étaient la vie des femmes et la conception du féminin à México-Tenochtitlan. C'est un des angles-morts de l'exposition « MEXICA, des dons et des dieux au Templo Mayor », présentée au musée du quai Branly d’avril à octobre 2024. La place des femmes dans cette société théocratique, classiste et guerrière vous est révélée au fil des étapes charnières de leur existence, depuis la naissance jusqu’à la mort, en passant par les années d’éducation, le mariage, l’accouchement et parfois, le sacrifice. Une histoire intime et sociale de la civilisation mexica, aux traditions culturelles et religieuses genrées, qui a fait couler beaucoup d’encre… et pas que.
Vous écouterez, tout au long de l’épisode, les morceaux entêtants d’autrices-compositrices-interprètes mexicaines incontournables d’hier et d’aujourd’hui : « María la Curandera » de Natalia Lafourcade, « Canción sin miedo » de Vivir Quintana, et « Piensa en mí » de Chavela Vargas.
Cette émission a été réalisée par Mickaël Adarve, que nous remercions chaleureusement.
Claudia Sheinbaum vient d’être élue première femme présidente dans l'histoire du Mexique, en juin 2024. Cette climatologue, ancienne membre du GIEC, est membre du parti Morena, le Mouvement de Régénération Nationale. Sheinbaum compte s'inscrire dans la lignée de son prédécesseur, Andrés Manuel López Obrador, en poursuivant ses politiques sociales, tout en entreprenant la transition écologique et en garantissant les droits des femmes au Mexique. Comment Sheinbaum va-t-elle s’y prendre pour combattre le fléau des violences de genre et des féminicides, dans un contexte particulièrement troublé, notamment en matière de crime organisé et de politiques migratoires ? Quel regard les mouvements féministes au Mexique portent-ils sur le bilan de cette ancienne cheffe du gouvernement de la ville de Mexico, de 2018 à 2023 ?
Pour répondre à toutes ces questions, nous avons eu l’honneur d’interviewer la militante féministe Alexia Prado et Karine Tinat, enseignante-chercheuse au Centre d’Études Sociologiques et au sein du Programme Interdisciplinaire d’Études sur le Genre au Colegio de México. Au cours d’un riche entretien mené par Sylvie Argibay et Paloma Petrich, nous avons discuté de la législation actuelle sur le féminicide au sein des États-Unis mexicains et des politiques de lutte contre les violences de genre en vigueur. Les points de vue de nos deux invitées nous ont offert un aperçu de l’éventail de réactions qu’a suscité l’élection de Sheinbaum parmi les collectifs féministes, oscillant entre attentes fortes mais prudentes et relatif scepticisme quant à l’espoir d’une amélioration prochaine de la situation.
Afin d’élargir le regard, les chroniqueuses de Semillas Latinas se sont intéressées à des publications, des artistes, des expositions, des pratiques sociales et des initiatives politiques ayant trait à la situation des femmes au Mexique, de nos jours, mais aussi au siècle passé, ainsi qu’à des périodes fort anciennes...
Paloma Petrich et Astrée Toupiol proposent de jeter un coup d’œil sur la place des femmes et des minorités de genre dans l’espace public au Mexique. En observant les mesures mises en place ces dernières années par les pouvoirs publics, comme le dispositif Senderos Seguros et les rames de métro réservées aux femmes et aux enfants aux heures de pointe, elles questionnent leur efficacité sur la sécurité et dans la lutte pour prévenir ces violences. Au-delà des politiques publiques, les moyens et les stratégies que ces personnes développent pour exister et s'approprier l’espace public sont mis en lumière, à l'instar des travaux communautaires, des associations de quartier et des mobilisations de masse dans la rue. Dans un pays où 10 femmes sont assassinées chaque jour, il est urgent de visibiliser leur vécu et que la ville devienne le réceptacle des luttes et des forces féministes plutôt que celui des agressions.
Un narco-récit mêlant poésie, roman noir, essai et enquête journalistique haletante au cœur de l’épicentre des féminicides de masse au Mexique : c’est là que vous emmène Manon Méziat dans sa chronique littéraire consacrée à l’ouvrage Des Os dans le désert de Sergio González Rodríguez (2002). Cette enquête menée par le journaliste sur les meurtres de femmes en série perpétrés entre 1990 et 2003 à Ciudad Juárez, dans l’État du Chihuahua, frontalière d’El Paso aux États-Unis, constitue une vibrante quête de justice en même temps qu'un hommage. Plongez dans les entrailles de cette ville, véritable « twilight zone » où s’entremêlent, dans un cycle de violence implacable, haine des femmes, trafic de drogue et classe politique corrompue jusqu’à l’os – jusqu’aux os de ces femmes dans le désert.
Pauline Rossano vous invite à redécouvrir une icône de notre temps, Frida Kahlo. Embarquez pour une exploration imaginaire de la Casa Azul, la demeure emblématique des Kahlo à Coyoacán, à travers une exposition contée ! Un florilège d’œuvres, de lettres et d'objets, tels que sa collection de vêtements traditionnels indigènes, symptomatique d'un fort engagement politique de l'artiste, permettent de penser autrement sa vie, son identité et ses combats. Le parcours hors normes de Frida Kahlo a engendré un mythe puissant, parfois stéréotypé et instrumentalisé au point de trahir les convictions politiques de l'artiste et d'en tordre l’héritage, auquel nous avons souhaité rendre hommage.
Pour finir, Anael Michel vous propose de remonter le temps, 600 ans en arrière, afin d'imaginer ce qu'étaient la vie des femmes et la conception du féminin à México-Tenochtitlan. C'est un des angles-morts de l'exposition « MEXICA, des dons et des dieux au Templo Mayor », présentée au musée du quai Branly d’avril à octobre 2024. La place des femmes dans cette société théocratique, classiste et guerrière vous est révélée au fil des étapes charnières de leur existence, depuis la naissance jusqu’à la mort, en passant par les années d’éducation, le mariage, l’accouchement et parfois, le sacrifice. Une histoire intime et sociale de la civilisation mexica, aux traditions culturelles et religieuses genrées, qui a fait couler beaucoup d’encre… et pas que.
Vous écouterez, tout au long de l’épisode, les morceaux entêtants d’autrices-compositrices-interprètes mexicaines incontournables d’hier et d’aujourd’hui : « María la Curandera » de Natalia Lafourcade, « Canción sin miedo » de Vivir Quintana, et « Piensa en mí » de Chavela Vargas. Le tout mis en valeur par un habillage sonore original, pour lequel nous remercions chaleureusement les talentueux.se Iñaki Modrego, Emilio Rossano et Pauline Rossano, et grâce à l’aide précieuse de Mickaël Adarve, à la réalisation.