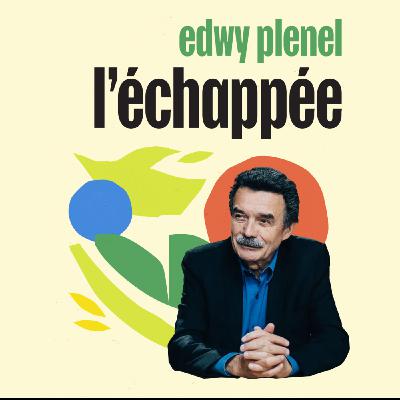Discover L’échappée
L’échappée

L’échappée
Author: Mediapart
Subscribed: 54Played: 332Subscribe
Share
© Mediapart
Description
On ne va pas se raconter d’histoire : l’époque n’est pas réjouissante tant les ombres menacent. Mais le risque de cette lucidité, c’est de se laisser abattre. Carte blanche donnée par Mediapart à Edwy Plenel, l’émission « L’échappée » entend dire non à la résignation grâce à des rencontres qui réveillent l’espérance.
Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
15 Episodes
Reverse
Alors que s’ouvre la COP30 au Brésil et dix ans après l’accord de Paris, le philosophe Pierre Charbonnier imagine une stratégie pour former une coalition majoritaire face à la « coalition fossile ».« Au XXIe siècle, toute politique est une politique climatique car l’ordre économique, géopolitique et démocratique tient à la réponse qui sera apportée à l’épuisement du modèle de développement fossile encore largement prédominant » : ainsi s’ouvre le nouveau livre de Pierre Charbonnier, La Coalition climat (Seuil).Après Abondance et liberté, histoire environnementale des idées politiques, et Vers l’écologie de guerre, histoire environnementale de la paix, tous deux aux éditions La Découverte, le philosophe s’est attaché à proposer une stratégie pragmatique et réaliste qui puisse renverser un rapport de force toujours défavorable face à ce qu’il nomme la « coalition fossile ». Une alliance qu’incarnent aussi bien Donald Trump que Vladimir Poutine.« Il manque à l’âge climatique, écrit Pierre Charbonnier, une théorie du changement suffisamment englobante ainsi qu’une désignation sociologique des moteurs de ce changement, et ce livre voudrait contribuer à sa formation. »Prolongé par quatre rebonds, aussi bien d’activistes écologistes que de hauts fonctionnaires, cet essai, ainsi soumis à la discussion collective, tente de « combler l’écart gigantesque qui persiste entre l’ampleur de l’enjeu objectif que représentent les politiques climatiques et la relative étroitesse de la niche politique dans laquelle sont confinés ces acteurs ». Cette démarche s’inscrit dans le sillage de l’œuvre pionnière de Bruno Latour (1947-2022), dont Pierre Charbonnier revendique l’héritage. Dans Où atterrir ?, paru en 2017 et sous-titré « Comment s’orienter en politique », le sociologue faisait ce constat aussi lucide qu’alarmant : « Depuis les années 1980, les classes dirigeantes ne prétendent plus diriger mais se mettre à l’abri hors du monde. De cette fuite, dont Donald Trump n’est que le symbole parmi d’autres, nous subissons tous les conséquences, rendus fous par l’absence d’un monde commun à partager. L’hypothèse est que l’on ne comprend rien aux positions politiques depuis cinquante ans, si l’on ne donne pas une place centrale à la question du climat et à sa dénégation. »Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Traducteur de l’allemand, Olivier Mannoni interroge, à partir du laboratoire nazi, la brutalisation de la langue qui accompagne les fascismes. Il nous explique comment Trump parle comme Hitler, et Poutine comme un gangster.Olivier Mannoni a vécu près de dix ans avec les mots d’Adolf Hitler, en étant chargé d’une retraduction de Mein Kampf dans le cadre d’une édition critique, Historiciser le mal, dirigée par l’historien Florent Brayard, parue en 2021. Traducteur réputé, fondateur de l’École de traduction littéraire, il n’est pas sorti indemne de cette fréquentation, alors même qu’il avait déjà souvent traduit des textes sur le IIIe Reich. C’est que ces mots d’hier, il les entendait aujourd’hui.« Nous assistons à la remontée des égouts de l’histoire. Et nous nous y accoutumons », écrit-il dans Traduire Hitler, paru en 2022, suivi en 2024 de Coulée brune, qui s’attache à montrer « comment le fascisme inonde notre langue ». « Parce qu’il permet le dialogue et la prise de décision commune, le langage est la force de la démocratie, écrit-il. Que ce langage soit perverti, et c’est la démocratie elle-même qui se distord, s’atrophie et perd sa raison d’être. »Durant cette « échappée », Olivier Mannoni nous explique ainsi comment Donald Trump et son entourage parlent comme Adolf Hitler et les propagandistes nazis. Cette « langue du même et de la racine » s’accompagne de mécanismes langagiers que partagent les médias de la haine : simplification outrancière de la réalité, petites phrases comme autant d’uppercuts, vérités alternatives dans une inversion systématique du sens.Cette brutalisation va de pair avec une transgression permanente dont le charlatanisme assumé et la grossièreté illimitée sont autant d’armes langagières pour faire taire les opposant·es, les paralyser et les stupéfier. Cette nouvelle langue des fascismes est aussi un « parler pègre » dont Vladimir Poutine est coutumier, évoqué par le récent essai de la philologue Barbara Cassin La Guerre des mots. « On prend tout ça pour de la frime, on ne prend rien au sérieux et on sera bien étonnés le jour où ce théâtre sera devenu une sanglante réalité » : cette conversation avec Olivier Mannoni actualise l’ancienne mise en garde de Victor Klemperer, célèbre auteur de LTI, la langue du IIIe Reich. Lequel ajoutait ceci : « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps, l’effet toxique se fait sentir. »Face à cette extrême droite pour laquelle les mots sont des armes, nous devons mener cette bataille du langage. Telle est l’alerte d’Olivier Mannoni, qui écrit dans Coulée brune : « Nous sommes à ce carrefour. Si nous prenons le mauvais chemin, le pire est assuré et la novlangue d’Orwell ne sera qu’une plaisanterie par rapport à ce que nous devrons subir. »Retrouvez tous les numéros de « L’échappée » sur Mediapart. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
A quoi sert l’archéologie ? Pourquoi dérange-t-elle nos politiques au point que l’actuelle ministre de la culture s’en est prise aux chantiers d’archéologie préventive ? Après Jean-Paul Demoule et Alain Schnapp, nos deux précédents invités, c’est au tour de Dominique Garcia de nous éclairer, au terme de cette série d’émissions spéciales de « L’échappée ». Historien et archéologue comme ses collègues, spécialiste de la Gaule et de l’Antiquité gréco-romaine, ce professeur à l’université d’Aix-Marseille préside depuis 2014 l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).Détaillant les avancées récentes de cette discipline avec de nombreux exemples, il montre combien, loin d’être une activité uniquement d’érudition, elle est au cœur de la vie de la cité, aussi bien économique (l’aménagement du territoire) que politique (l’histoire dont le sol témoigne). « Je ne fais pas de l’archéologie pour donner des racines. On donne des racines à des légumes. Les hommes n’ont pas besoin de racines, ils ont besoin de repères », explique Dominique Garcia, en revenant sur son propre itinéraire de jeune Languedocien aux origines espagnoles, découvrant combien le présent est tissé d’héritages multiples, imbriqués, entremêlés et connectés.Dans cet entretien, il nous fait découvrir la vitalité de recherches archéologiques qui mettent au jour une France sans cesse en mouvement, brassée par les migrations, enrichie de multiples rencontres. Les « archives du sol » que fait émerger l’archéologie, ce « laboratoire à ciel ouvert », contredisent ainsi tout récit identitaire figé, imposé et raciné. Elles sont aussi riches d’enseignements sur des défis immédiats, comme le changement climatique ou les risques pandémiques.Ouvrage sans équivalent qu’il a coordonné avec Jean-Paul Demoule et Alain Schnapp, Une histoire des civilisations (2021) est le récit de cette histoire plurielle, avec soixante-et-onze contributions de spécialistes mondiaux qui racontent « comment l’archéologie bouleverse nos connaissances ». C’est aussi le cas, à l’échelle du seul territoire national, de deux autres sommes collectives que Dominique Garcia a dirigées, nourries des plus récentes découvertes : un Atlas archéologique de la France (2023) et La Fabrique de la France (2021), qui rend compte de vingt ans d’archéologie préventive. On lui doit aussi, avec le démographe Hervé Le Bras, la coordination d’une remarquable Archéologie des migrations (2017).N’hésitez pas à prolonger par ces lectures le visionnage de cette série. Et à soutenir les archéologues dans leur défense d’une discipline attaquée par le court-termisme de politiques dont l’immédiateté est une irresponsabilité, tant leur idéologie de rentabilité économique ouvre la voie à la destruction sans retour de richesses infinies.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
« Les hommes se croient toujours les premiers alors qu’ils sont les derniers », nous dit Alain Schnapp, plaidant pour « ce qu’on pourrait appeler, au sens ancien du terme en français, un commerce avec le passé ». « Sans passé, poursuit-il, il n’y a pas de relations correctes entre les personnes et entre les siècles. Et c’est pourquoi le problème de la fouille préventive, le problème de la protection du patrimoine, c’est de faire partager le respect pour ce qui est enfoui dans le sol. »Dans ce deuxième épisode de notre série d’émissions en défense d’une archéologie en butte aux attaques des courts-termismes politiques et économiques (lire cette contribution dans le Club), Alain Schnapp en défend la « dimension éthique ». « La dimension éthique de l’archéologie préventive, explique-t-il, c’est que ce qui nous a été laissé est digne d’intérêt. Et que cet intérêt, on doit le mesurer au passage du temps. »Historien de la Grèce antique, longtemps professeur d’archéologie grecque à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cet élève et disciple du grand Pierre Vidal-Naquet aime citer ce passage de saint Augustin (354-430), l’évêque d’Hippone (aujourd’hui Annaba, en Algérie), dans La Cité de Dieu : « Quiconque n’envisage pas le commencement de son activité ne sait pas en prévoir la fin. Ainsi, à la mémoire qui se retourne vers le passé se lie nécessairement l’attention qui se porte vers l’avenir. Qui oublie ce qu’il commence saura-t-il comment il peut finir ? »Depuis ses études des années 1960 à la Sorbonne parisienne, marquées par son fort engagement en Mai 68 – il publia, en 1969, avec Vidal-Naquet un Journal de la Commune étudiante qui reste une somme incontournable –, Alain Schnapp n’a cessé de se battre, en duo avec le préhistorien Jean-Paul Demoule, invité de notre première émission, pour qu’en France, l’archéologie soit enfin reconnue, promue et protégée. Point de départ de notre série, leur ouvrage commun, Qui a peur de l’archéologie ? rend compte de ce long combat, encore fragile et inachevé, qui a conduit Alain Schnapp, au début des années 2000, à prendre la direction de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) en même temps que son complice prenait celle de l’Institut national des recherches archéologiques préventives (Inrap), tout nouvellement créé.Mais cette conversation est aussi l’occasion de visiter une œuvre aussi savante qu’originale. Pédagogue méticuleux, Alain Schnapp est notamment l’auteur d’un ouvrage formidable et monumental, paru en 2020 dans la collection du regretté Maurice Olender au Seuil : Une histoire universelle des ruines. Dans une approche à la fois érudite et sensible, il y arpente la magie des ruines, ce spectacle qui nous rappelle qu’« il en va de l’homme comme de la nature » : « Les ruines sont un instrument de compréhension du passé autant que du futur. Elles sont le moyen d’une méditation unique sur la condition humaine et le sens de l’histoire. »À le lire et à l’écouter, on comprend dès lors pourquoi l’archéologie est politiquement subversive, en ce sens qu’elle dérange un monde moderne d’immédiateté et de rentabilité qui se croit éternel parce que puissant. Et Alain Schnapp de démentir cette prétention en citant un poète, le surréaliste Benjamin Péret : « Peut-être retrouvera-t-on un jour, alors que son souvenir sera effacé de la mémoire des hommes, le gigantesque fossile d’un animal unique, la tour Eiffel… »Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
« Creuser un trou pour creuser un trou » : c’est ce que Rachida Dati, dans son langage direct, appelle « faire des fouilles pour se faire plaisir ». En avril 2024, cette sortie de la ministre de la culture contre l’archéologie préventive avait mis en émoi toute la profession, comme en avait témoigné Jean-Paul Demoule dans Mediapart.Depuis, la menace persiste, tant sur les moyens accordés aux fouilles préventives que sur la légitimité d’un dispositif mis en place par une loi de 2001 qui s’est traduite par la création de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) dont le célèbre préhistorien fut le premier président. « Le projet de loi de “simplification de la vie économique” met notre patrimoine archéologique en danger », s’est-il ainsi alarmé, avec nombre d’autres archéologues, en avril dernier.Parti pris assumé en défense de l’archéologie, cette série spéciale de trois émissions de « L’échappée » entend percer ce mystère de la tenace et lointaine défiance des élites politiques, économiques et administratives françaises vis-à-vis de l’archéologie de leur propre pays. Son symbole le plus manifeste est la relégation des splendeurs découvertes dans le sol français au musée de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), bien moins doté – et c’est peu dire –, que le musée du Louvre, joyau de la capitale et de la culture nationales où, pourtant, l’on ne voit presque aucun objet archéologique mis au jour en France, l’essentiel de ses trésors venant d’ailleurs, ramenés de Mésopotamie, d’Égypte, de Grèce, d’Italie, etc.Qui a peur de l’archéologie ? Notre questionnement s’inscrit dans le sillage du livre ainsi titré de Jean-Paul Demoule et Alain Schnapp, autre archéologue, spécialiste de la Grèce antique, paru l’an dernier aux Belles Lettres. Nous avons donc demandé à ces deux éminents savants, rejoints par l’actuel président de l’Inrap, Dominique Garcia, spécialiste, lui, de la Gaule et de l’antiquité gréco-romaine, d’éclairer ce mystère tout en nous faisant partager leurs passions historiennes.Au fil de ces trois entretiens, on découvre que la réponse ne se réduit pas aux logiques économiques de rentabilité et d’immédiateté. Si l’archéologie dérange, c’est aussi, sinon surtout, parce qu’elle met en question les fadaises identitaires et les racontars idéologiques qui mythifient une France éternelle et des civilisations immuables.Ainsi, dans cette première émission, Jean-Paul Demoule déconstruit méthodiquement « le mythe des origines » comme il l’a fait dans de nombreux ouvrages, en inlassable pédagogue. En attendant La France éternelle, une enquête archéologique, à paraître le 12 septembre à La Fabrique, on citera notamment son Homo Migrans, limpide histoire globale des migrations (Payot, 2022), et son Mais où sont passés les Indo-Européens, somme sur le mythe d’origine de l’Occident (Seuil, 2014). Il faut « fouiller le passé pour interroger le présent », explique-t-il tout au long de notre conversation. Et, en l’écoutant, on comprend mieux pourquoi l’archéologie bouscule et interpelle, notamment en nos temps de régression politique vers les pires conservatismes.« La France n’a pas d’origine », écrivait-il déjà en 2012 dans On a retrouvé l’histoire de France (Robert Laffont) : « Il faut pulvériser le mythe de l’origine, insistait-il. Il n’y a pas d’origine de la France, pas de jour où la France aurait commencé. […] Les archéologues ne sont pas seulement là pour fouiller le sol. […] Ils ont aussi la charge de dénoncer les manipulations de l’histoire. […] Nous n’avons pas besoin de mythes, nous avons besoin de savoir pourquoi nous vivons ensemble : nous avons besoin de comprendre l’histoire du sol sur lequel nous vivons et, quels que soient les lieux où ont vécu naguère nos propres ancêtres biologiques, de connaître les impasses qui ont conduit à la catastrophe certaines des sociétés passées. »Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Née soviétique en 1975 à Moscou, et arrivée en France en 1989, deux ans avant la fin de l’URSS, Anna Colin Lebedev est aujourd’hui maîtresse de conférences à l’université Paris-Nanterre et chercheuse rattachée à l’Institut des sciences sociales du politique. À rebours des héritages de l’ancienne kremlinologie, c’est-à-dire d’une approche des sociétés postsoviétiques centrée sur le pouvoir d’État, la grande originalité de son travail est de s’intéresser en priorité aux sociétés, de documenter leurs complexités et de renseigner leurs vitalités.C’est ce qu’elle fait dans son récent Ukraine : la force des faibles (Seuil, « Libelle »), qui fait suite à Jamais frères ? Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique, paru en 2022. Elle y rend compte de l’avancée de ses recherches sur un pays qu’elle connaît bien pour y avoir vécu. Ses travaux, dont elle tient le carnet de route sur son blog, mettent en évidence la dynamique de la société ukrainienne, impulsée par la révolution dite de l’Euromaïdan de 2013-2014, qui explique sa résistance à l’invasion russe de 2022, construite depuis les premières agressions de 2014. « La méfiance à l’égard de l’État a été un moteur puissant d’engagement citoyen, parce que les Ukrainiens étaient certains que leur État seul n’était pas capable de faire face à la menace russe », écrit Anna Colin Lebedev, qui raconte comment « l’engagement protestataire se transformera ensuite en engagement militaire ».« L’État, c’est nous, ce n’est pas eux », « eux » désignant les élites politiques et administratives : cette mobilisation de la société ukrainienne, qui est la première explication de la résistance de l’Ukraine à l’impérialisme russe, est ainsi résumée à Anna Colin Lebedev par Kyrylo, un chercheur en biologie engagé depuis 2014 dans un des bataillons volontaires pour combattre au front, dans l’est du pays. C’est pourquoi, au-delà du défi à la volonté de puissance grand-russe, la résistance ukrainienne est un défi à la dictature de Vladimir Poutine : « L’Ukraine est douloureuse pour la Russie parce qu’elle est une alternative », résume dans « L’échappée » la chercheuse, qui explique aussi combien « cette guerre est en train de détruire la société russe de l’intérieur ».Tout son propos est une alerte qui interpelle notre trop grande indifférence à une guerre européenne commencée il y a déjà onze années, puis devenue extrême il y a plus de trois ans et, surtout, partie pour durer encore longtemps tant, explique Anna Colin Lebedev, la guerre est « un facteur de stabilité pour le régime poutinien ». Les Ukrainien·nes « sont en train de nous défendre, ils se battent pour nous », insiste-t-elle en invitant à sortir d’une vision étatiste et campiste du monde, où seuls les pouvoirs politiques comptent, pour mieux se rapprocher des sociétés et connaître leurs peuples.Retrouvez tous les numéros de « L’échappée » sur Mediapart. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
« Pour ou contre l’immigration ? Notre débat public sera enfin adulte quand nous aurons dépassé ce stade, tant il est vrai que l’immigration est désormais une réalité permanente au même titre que le vieillissement, l’expansion urbaine ou l’accélération des communications. Qu’on le veuille ou non, c’est une composante de la France parmi d’autres, un quart de la population. Quel sens y aurait-il à approuver ou à désapprouver cet état de choses ? […] Ni pour ni contre l’immigration. Avec elle, tout simplement. »Avec l’immigration, dont ce sont les dernières lignes, est paru en 2017, l’année où François Héran fut élu par ses pairs professeur au Collège de France. Alors qu’il vient d’y donner sa leçon de clôture, en forme d’adresse du savant au politique, ce meilleur spécialiste des questions migratoires a accepté notre invitation à en reprendre la démonstration devant le public du festival de Mediapart. Une réjouissante leçon pédagogique à l’attention, entre autres, du ministre de l’intérieur actuel, Bruno Retailleau, mais aussi du président de la République, Emmanuel Macron, qui s’inscrit dans le sillage de ses deux essais – Le Temps des immigrés (2007) et Immigration : le grand déni (2023).Démographe, mais aussi anthropologue et sociologue, François Héran a enrichi, animé et impulsé les principales recherches françaises sur l’immigration des dernières décennies, en associant les travaux de l’Institut national des études démographiques (Ined), dont il a été le directeur de 1999 à 2009, aux données de l’Institut national de la statistique (Insee). Il en a résulté Trajectoires et origines, une exceptionnelle « enquête sur la diversité des populations en France », dont les résultats sont superbement ignorés par un monde politique français volontiers ignare, inculte ou malhonnête, sur les questions d’immigration, par choix idéologique ou par facilité démagogique.François Héran déploie ici, avec autant d’humour que de rigueur, ses talents de savant pédagogue, dans un propos qui fait écho aux engagements de Mediapart, résolument aux côtés de la société telle qu’elle est, telle qu’elle vit, telle qu’elle s’invente.Retrouvez tous les numéros de « L’échappée » sur Mediapart. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
« C’est en ce moment pour moi une sale époque, toutes les époques d’ailleurs sont dégueulasses dans l’état où je suis » : faisant écho à nos contemporaines inquiétudes et incertitudes, cette confidence d’Antonin Artaud (dans La Révolution surréaliste en 1925) a inspiré Laure Murat pour son nouveau manuel de résistance.Toutes les époques sont dégueulasses, qui vient de paraître chez Verdier, prolonge la démarche d’un précédent manifeste de l’écrivaine, Qui annule quoi ? paru au Seuil en 2022 : prenant à bras-le-corps les débats sur la « cancel culture » – l’annulation de symboles des oppressions – et sur la réécriture de classiques de la littérature – encombrés de racismes ou de sexisme –, elle indique la voie de révoltes qui aient l’intelligence de leurs colères. En d’autres termes, de résistances qui ne débouchent pas sur des impasses, et donc des déceptions, à force d’imiter les dominations qu’elles combattent.« Soyons “woke”, mais avec méthode ! », recommande l’autrice d’ouvrages majeurs sur les causes intersectionnelles de l’émancipation qui fédèrent tous les combats de l’égalité, sans distinction d’origine, de condition, d’apparence, de croyance, de sexe ou de genre.Notre conversation se tient dans la chambre de Marcel Proust, reconstituée au musée Carnavalet, lieu choisi par Laure Murat. Dans son formidable Proust, roman familial (prix Médicis essai 2023), elle avait raconté combien la lecture d’À la recherche du temps perdu l’avait littéralement sauvée dans son échappée personnelle d’un monde aristocratique auquel la revendication de l’homosexualité était insupportable, tant elle en défie les conservatismes et les immobilismes.Rendez-vous avait été pris il y a plusieurs mois quand l’universitaire, professeure à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA), aux États-Unis, avait annoncé son choix de quitter ce pays et, surtout, cette ville dont elle était tombée amoureuse, en raison du retour au pouvoir de Donald Trump. Expliquant pourquoi, avec ce dernier à leur tête, les États-Unis ne sont plus une démocratie, elle confie cependant avec optimisme sa conviction que #MeToo est une révolution irrépressible qui frappe en leur cœur les dominations et les oppressions.Après avoir revisité les tenaces adversités que ce mouvement de libération a dû affronter en France – de la tribune de Catherine Deneuve en défense d’une prétendue « liberté d’importuner » au soutien apporté par Emmanuel Macron à Gérard Depardieu –, Laure Murat lance un appel à une recherche collective confrontant la liberté de création à la question morale – un débat difficile que recouvre l’habituelle excuse sur la distinction « entre l’homme et l’artiste ». Elle termine enfin par un message adressé aux hommes, les invitant à vouloir, vraiment, « un avenir commun avec les femmes ».Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Le « double standard » d’un Occident qui renie et saccage les valeurs qu’il proclame à la face du monde a commencé il y a quatre-vingts ans, quand la victoire contre le nazisme en Europe fut entachée par des massacres coloniaux en Algérie, dans le Constantinois. Ce rappel de l’autre 8 mai 1945 est le point de départ de notre conversation avec l’historienne du fait colonial Malika Rahal, directrice de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP).« Il n’y a d’histoire qu’au présent », aimait dire l’historien Marc Bloch. Et c’est ce que nous confirme Malika Rahal à l’heure de la guerre d’Israël à Gaza, en appelant la France à ne pas se contenter de gestes mémoriels, notamment sur les crimes commis pendant la guerre d’Algérie, mais à se déclarer enfin, résolument, anticolonialiste. Le colonialisme, nous explique-t-elle, « n’est pas une affaire du passé mais une affaire du présent ». Dans Mille histoires diraient la mienne (Éditions EHESS), elle revient sur son itinéraire intellectuel au carrefour de trois héritages et nationalités, la France où elle est née, à Toulouse, puis a grandi, dans le Lauragais, l’Algérie de son père qui reste son pays de cœur, les États-Unis de sa mère, ceux des grandes plaines du Nebraska. Un cheminement multiculturel et internationaliste dont l’Algérie, avec sa révolution anticolonialiste, est le fil d’Ariane, jusqu’aux espérances du Hirak de 2019 qui reprenait le mot d’ordre de la libération de 1962 : « Un seul héros, le peuple ».Autrice d’un remarquable Algérie 1962 (La Découverte), histoire populaire de l’indépendance algérienne, elle mène, avec son collègue Fabrice Riceputi, des recherches entêtées sur les disparus de la mal nommée « bataille d’Alger » en 1957, dont témoigne le site 1000autres.org et cette enquête pour Mediapart. De fait, « disparition » pourrait être le synonyme de colonisation, aujourd’hui comme hier : effacer un peuple, détruire sa culture, le déplacer, l’expulser, le massacrer… Réalités criminelles non seulement d’hier mais hélas d’aujourd’hui auxquelles, dans notre émission, Malika Rahal objecte, tout simplement : « Ce n’est pas bien… »Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard est engagée pour les droits humains depuis vingt-huit ans. Alors qu’elle en témoigne dans « Une enquêtrice à l’ONU », elle s’élève contre l’indifférence face au sort des Palestiniens à Gaza.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
« L’art est une façon de tenir tête à ce que l’on nomme le réel », écrit Lola Lafon dont toute l’œuvre, déjà abondante, est un précis de résistance à l’air du temps, aux résignations et aux compromissions.Dans Une fièvre impossible à négocier, son premier livre paru en 2003, on trouve cette notation : « On ne discute pas avec le cancer, on fait une chimiothérapie… Le fascisme, c’est pareil : on l’élimine ou on en crève. » Lola Lafon, qui se revendique volontiers anarchiste féministe (ou féministe anarchiste) depuis ses jeunes années passées chez les autonomes et dans les squats, raconte dans ce numéro de « L’échappée » comment elle a mûri ses convictions, revendiquant aujourd’hui un humanisme radical.Leur fil conducteur est le combat des femmes non seulement contre les violences que leur font les hommes – elle fut victime d’un viol dont le souvenir habite son œuvre, notamment Chavirer (2020) – mais surtout contre l’imaginaire masculiniste dans lequel s’ancre leur domination, cette passion du pouvoir, cet amour de la verticalité, ce vertige de la puissance. Son propos est d’une actualité criante face à ce qu’incarne le duo Trump-Poutine.Dans Quand tu écouteras cette chanson (2022), intense réflexion née d’une nuit passée au musée Anne-Frank d’Amsterdam, elle fait l’éloge des « irrévérentes » à son image d’indocile et de rétive. « On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. Mais on pourra dire qu’on ne savait pas quoi faire de ce qu’on savait », écrit-elle dans Il n’a jamais été trop tard (2025), recueil de chroniques sur le temps présent. Mais c’est, ensuite, pour mieux secouer nos renoncements avec cette citation d’Ernst Bloch : « Ce dont il faut se souvenir, c’est avant tout ce qu’il reste à faire. »Un entretien revigorant, au plus près de nos doutes et de nos inquiétudes. Une parole qui, dans ses précautions et ses nuances, (re)donne espoir dans le souci sans frontières des êtres, corps et âmes mêlées. Un voyage aussi où l’on croise la danse, le chant, la Roumanie, le passé communiste et l’histoire juive – et, par-dessus tout, la littérature.Retrouvez tous les numéros de « L’échappée » sur Mediapart. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
L'indigence« L’indigence que créent les dominations est d’abord une disparition de la Beauté », écrit Patrick Chamoiseau dans le « Libelle » qu’il vient de publier aux éditions du Seuil, Que peut Littérature quand elle ne peut ? « Dans le capitalisme extrême, on a un renforcement de la bêtise et de l’obscurantisme. Nous sommes en face du surgissement de l’inconcevable », prolonge-t-il dans cet entretien pour Mediapart, quatrième numéro de notre émission « L’échappée ».De retour d’une tournée universitaire aux États-Unis d’Amérique, où il a été témoin de l’élection de Donald Trump, l’écrivain martiniquais invite à ne pas se dérober face au défi que l’avènement de cet inconcevable lance aux principes d’humanité et d’égalité. « Pour imaginer le monde qui nous manque, la pensée a besoin de l’impossible », explique-t-il, en appelant à l’affirmation d’un « imaginaire de la Relation », dans le sillage de ses compatriotes Aimé Césaire et Édouard Glissant.Le poète René Char, l’écrivain Milan Kundera, le philosophe Gilles Deleuze, le sociologue Edgar Morin ou encore le chanteur Bernard Lavilliers sont aussi embarqués dans cette conversation au long cours avec l’auteur de Solibo Magnifique, de Texaco et, plus récemment, de Frères migrants. Patrick Chamoiseau y interpelle notamment la persistance française de l’imaginaire colonial : « En outre-mer, on nie l’existence de peuples singuliers. Ce qu’il faut, c’est libérer ces peuples. »Contre la désespérance qui nous saisit face à la catastrophe en cours, l’écrivain appelle à cultiver la « puissance imaginative » de la littérature, ouverture à d’autres possibles dans la confrontation à l’impensable. Ce qui suppose, affirme-t-il, d’échapper à tous ces « grands récits » qui verrouillent la réalité, dans la négation de sa complexité, de ses pluralités et de ses diversités. « Le réel est inépuisable », recélant les alternatives au monde des Trump et Poutine, insiste Patrick Chamoiseau, en quête de « l’en commun qui nous manque », ce lieu à venir où nous saurons « construire des “nous” à partir des plénitudes individuelles ».Retrouvez tous les numéros de « L’échappée » sur Mediapart. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
« Construire ensemble un monde meilleur » : c’est par ces mots que se concluait, le 14 février 2003, le discours de Dominique de Villepin prononcé dans l’enceinte du Conseil de sécurité des Nations unies. Avec l’espoir de faire barrage à l’aventure militaire nord-américaine en Irak.Vingt-deux ans après, alors que cette perspective semble plus éloignée que jamais à l’heure du retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis d’Amérique, l’ancien ministre des affaires étrangères de Jacques Chirac a accepté de se confier longuement, pour cette troisième édition de « L’échappée ».Pour Dominique de Villepin, « l’enjeu du monde d’aujourd’hui, c’est : est-ce que l’homme universel existe ? Est-ce que l’autre existe ? C’est une certaine conception de l’homme, de l’autre, de l’altérité, de l’humanité commune, qui aujourd’hui est en cause. Comme il s’agissait hier de se battre contre une puissance américaine débridée, aveugle aux réalités du Proche et du Moyen-Orient, aujourd’hui il faut faire face à une Amérique qui ne comprend pas le monde, ne connaît pas le monde, mais pire que ça, se moque du monde ».Des défis de la situation internationale aux enjeux de la crise française, celui qui, de 1995 à 2007, fut successivement secrétaire général de l’Élysée, ministre des affaires étrangères, ministre de l’intérieur puis premier ministre, assume explicitement dans cet entretien sa volonté de revenir dans le jeu politique national et en détaille les raisons.« Nous sommes confrontés à un choc historique. Ce combat, je ne peux pas ne pas y participer. Je ne peux pas ne pas être aux avant-postes », dit-il en réponse à une question sur son ambition présidentielle, avant de s’expliquer sur les parts d’ombre que lui prêtent ses détracteurs.« Aujourd’hui la démocratie se fait sans les citoyens et se fait même contre les citoyens. Le drame d’Emmanuel Macron, c’est qu’il a cru pouvoir gouverner contre les Français », explique Dominique de Villepin à propos de ce qu’il nomme « le malheur français ». « Nous sommes au pied du mur », insiste-t-il pour justifier son retour dans l’arène politique, en prolongement de son expression sur les questions internationales, et notamment de son plaidoyer pour une « intransigeance sur l’essentiel » : « Nous ne pouvons pas transiger sur le droit international. Il y va de notre identité culturelle, diplomatique, humaine. »Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
« Chaque jour d’indulgence pour la guerre est un jour de trop pour la survie de tous », a écrit Dominique Eddé le 26 septembre 2024, dans une tribune intitulée « Benyamin Nétanyahou a pris le temps en otage ». Depuis Beyrouth, où elle vit, la romancière et essayiste libanaise n’a cessé, notamment par des tribunes dans Le Monde, de jeter des bouteilles d’alarme dans une mer d’indifférence face au sort tragique de Gaza, tandis que la guerre génocidaire d’Israël contre la Palestine allait s’étendre à des crimes de guerre contre des civils au Liban.« Pourquoi il fait si sombre ? » C’est donc à l’enseigne de ce titre de l’un de ses romans, paru au Seuil en 1999, que rendez-vous fut pris pour ce deuxième numéro de « L’échappée » avec cette voix singulière, aussi libre qu’indocile, attachée à la quête d’un universel qui ne soit pas l’annihilation des différences, des nuances et des pluralités. Il s’agissait d’évoquer aussi bien la Palestine que le Liban, le monde arabe que le monde tout court. Entre désespoir et, malgré tout, espoir…Car, une semaine avant la date du 15 décembre fixée pour l’enregistrement dans les murs de l’Institut du monde arabe à Paris, quand un fragile cessez-le-feu au Liban rouvrit l’espace aérien et permit des vols vers la France, l’heureuse surprise syrienne est intervenue, cette chute d’un des pires régimes de la région, la dictature des Assad, dont le Liban fut aussi la proie. À la fin de l’entretien, Dominique Eddé raconte la joie, à l’annonce de cette nouvelle, des réfugiées syriennes qu’elle soutient dans un atelier de tissage beyrouthin. Mais elle-même reste prudente, hantée depuis tant d’années par « la cohabitation de la beauté et de l’horreur ».« La joie de comprendre vous maintient en vie. Elle est plus puissante que celle d’avoir raison » : tout au long de cet entretien, Dominique Eddé illustre cette conviction qui l’anime depuis toujours, aussi bien dans ses engagements constants pour l’émancipation des populations du monde arabe que dans son œuvre littéraire où alternent romans et essais. Il s’agit, dit-elle encore, de toujours chercher à « établir des ponts par-dessus les pouvoirs ».« L’Europe s’est très mal comportée », confie-t-elle aussi, soulignant sobrement combien « la Palestine a été abandonnée de tous ». À la fin de son roman Kamal Jann (Albin Michel, 2012), dont la dictature syrienne est le théâtre dans une métaphore des monstruosités que peut engendrer notre espèce, Dominique Eddé rappelle que notre mot « mascarade » vient de l’arabe. Et c’est alors qu’elle fait dire à l’un de ses personnages : « L’Occident, n’est-ce pas la mascarade moins la conscience que c’en est une ? » Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Deux citations introduisent Universaliser (Albin Michel), le nouvel essai de Souleymane Bachir Diagne. L’une de Léopold Sédar Senghor : « Mesurer l’orgueil d’être différent au bonheur d’être ensemble » ; l’autre de Jean Jaurès : « Vers ce grand but d’humanité, c’est par des moyens d’humanité aussi que va le socialisme. »Tourné au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris, ce premier numéro de « L’échappée », la nouvelle émission de Mediapart présentée par Edwy Plenel, revisite le parcours de ce philosophe singulier, né le 1er novembre 1955 à Saint-Louis (Sénégal), devenu aujourd’hui l’une des voix africaines contemporaines les plus respectées. Son dernier livre synthétise la réflexion qui l’a conduit à élaborer le concept d’un universel « latéral ou horizontal » qui soit « à même d’embrasser le pluriel du monde », ce pluriel du monde nié par le colonialisme, qui « vise à ramener l’ensemble du monde au même ».L’originalité de cette pensée est qu’elle invite au décentrement en s’appuyant sur les philosophies africaines et islamiques. Souleymane Bachir Diagne revendique en effet un islam rationaliste ancré dans la tradition soufie. Il a raconté son itinéraire de vie dans Le Fagot de ma mémoire (Philippe Rey) et, plus récemment, dans Ubuntu (éditions EHESS).Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.