Discover Bookmakers : le making-of de la littérature
Bookmakers : le making-of de la littérature
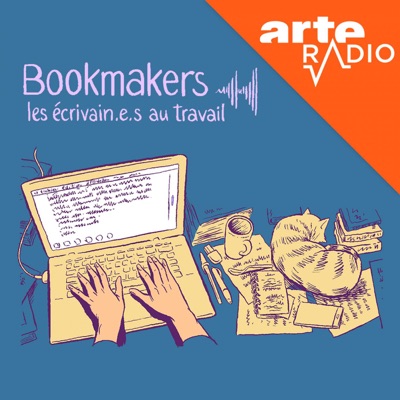
Bookmakers : le making-of de la littérature
Author: ARTE Radio
Subscribed: 1,711Played: 45,981Subscribe
Share
Description
Lecture, écriture, style : Bookmakers est un podcast littéraire qui propose d’écouter les écrivains et les écrivaines détailler leurs secrets d’écriture. C’est le récit d’un récit, les coulisses de fabrication d’un livre majeur dans la carrière d’un auteur ou d’une autrice, qui dévoile sa discipline, son rythme et ses méthodes de travail. C’est quoi, le style ? Comment construit-on une intrigue, un personnage ? Où faut-il couper ? Tous les deux mois, Bookmakers écoute les plus grands écrivains et écrivaines d’aujourd’hui raconter, hors de toute promotion, l’étincelle initiale, les recherches, la discipline, les obstacles, le découragement, les coups de collier, la solitude, la première phrase, les relectures… mais aussi le rôle de l'éditeur, de l’argent, la réception critique et publique, le regard sur le texte des années plus tard. Animé par Richard Gaitet, écrivain et homme de radio, le podcast Bookmakers détruit le mythe d’une inspiration divine qui saisirait les auteurs au petit matin. Il rappelle que l'écriture est aussi un métier, un artisanat, un beau travail. Bookmakers c’est le podcast d’un lecteur affamé de romans, d’essais, de contes, de poèmes, de pièces de théâtre, de bandes dessinées, de romans policiers, de nouvelles, de scénarios, de chansons, de sketchs, de traduction et qui dévore tous les genres avec gourmandise : fantasy, science-fiction, anticipation, polar, thrillers, aventures, récits de voyage, romans de gare, littérature érotique, épopées, odyssées, best-seller, page turners, chick lit, littérature expérimentale, histoire, roman épistolaire, philosophie, mangas, blogs, drame, autofiction, littérature documentaire, roman naturaliste, littérature jeunesse, fables, romans gothiques, romans d’aventures, roman noir, littérature d’espionnage, journaux intimes, biographies, mémoires, littérature du réel, journalisme gonzo, pamphlets ou littérature de contrainte. Il maitrise aussi l’art de l’interview, du silence, du tempo, de la question que personne n’a vu venir, de celle qu’on n’oserait pas poser, de l’hésitation fructueuse, de la remarque de dernière minute, de l’inspiration, de l’écoute, de la répartie, de l’envolée et du triple saut périlleux, mais toujours avec le sourire. Après avoir écouté Bookmakers, non seulement vous aurez une furieuse envie d’écriture, au point de vous mettre derrière votre clavier, voire de vous acheter un stylo neuf et une ramette de papier, mais vous ferez aussi la fortune de la librairie la plus proche de chez vous et la joie des bibliothécaires du voisinage car vous serez pris d’une irrépressible envie de lecture et vous constituerez chez vous des piles de livres à lire pour plus tard. Avec Bookmakers, Richard Gaitet fera de vous un lecteur ou une lectrice insatiable, un critique littéraire aux arguments aiguisés, un spécialiste capable de repérer les alexandrins cachés dans les paragraphes de prose, un athlète du verbe, un as de la note en bas de page, un corneur de page ou un adepte du marque page, un détenteur d’ex libris, un prescripteur ou une prescriptrice capable d’offrir ou de prêter le livre idéal pour chaque circonstance, un adepte de la citation automatique, un lecteur ou une lectrice qui saura naviguer de Daniel Pennac à Mona Cholet en passant par Chloé Delaume, Alice Zeniter, Justine Niogret, Mohamed Mbougar Sarr, Laura Vazquez, Natacha Appanah, Philippe Jaenada, Constance Debré, Bertrand Belin, Wouajdi Mouawad, Pierre Michon, Nancy Huston, Claude Ponti, Céline Minard, Jakuta Alikavazovic, Andre Markowicz, Laurent Chalumeau, Pierre Christin, Maria Pourchet, Alain Damasio, Nicolas Mathieu, Lola lafon, Dany Laferrière, ou Tristan Garcia. Bref, lecteur et non lecteur, lectrice et non lectrice, écrivain en devenir, autrice en germe, libraire dans l’âme, éditeur ou éditrice en devenir, bibliothécaire ou bibliophile, ce podcast est pour vous, un podcast qui vous chuchote la littérature directement dans vos petites oreilles.
117 Episodes
Reverse
Philippe et ses trophées de bowling : un écrivain au travail
Il se rêvait pilote d’avion, mais l’existence en a décidé autrement, à la faveur d’une très étrange idée : s’enfermer seul, pendant un an, dans son appartement. « Pour ne pas devenir fou », le jeune Jaenada commence à écrire des histoires saugrenues influencées par sa découverte des romans de l’Américain Richard Brautigan, notamment Willard et ses trophées de bowling (1975). S’en suivra une expérience historique (« J’ai été la première animatrice de minitel rose du monde ! »), un premier roman « ridicule », dit-il, écrit sur demande du patron légendaire des éditions de Minuit… et son interprétation très personnelle, à renforts de parenthèses, de la célèbre phrase de Deleuze : « Un grand écrivain, c’est un étranger dans sa propre langue. » Le podcast Bookmakers C’est quoi, le style ? Comment construit-on une intrigue, un personnage ? Où faut-il couper ? Chaque mois, Bookmakers propose aux plus grand.e.s écrivain.e.s d’aujourd’hui de raconter, hors de toute promotion, l’étincelle initiale, les recherches, la discipline, les obstacles, le découragement, les coups de collier, la solitude, la première phrase, les relectures… mais aussi le rôle de l'éditeur, de l’argent, la réception critique et publique, le regard sur le texte des années plus tard. Animé par Richard Gaitet, écrivain et homme de radio, le podcast Bookmakers détruit le mythe d’une inspiration divine qui saisirait les auteurs au petit matin. Il rappelle que l'écriture est aussi un métier, un artisanat, un beau travail. En partenariat avec Babelio L'écrivain du mois : Philippe Jaenada Fils spirituel de Bukowski et de Jacques le fataliste, féru de courses hippiques ou de whisky écossais, allergique au voyage mais ne se déplaçant jamais sans son sac matelot, Philippe Jaenada, 55 ans, est peut-être l’écrivain le plus drôle de France. Toujours vêtu de noir, il surgit en 1997 avec Le Chameau sauvage, ou les galères d’un curieux célibataire, sacré d’un prix de Flore, adapté au cinéma et premier volet d’une série de sept romans autobiographiques sur lui, sa femme, leur fiston ou leurs vacances incendiaires en Italie. Suivra un second cycle, en cours depuis 2013, composé d’enquêtes sur des affaires criminelles écrites à la première personne, riches en digressions improbables, tout en étant comme possédées par l’obsession de la vérité – fidèle à sa méthode dite du « tapir enragé ». Bingo : La Serpe, en 2017, se voit couronné du prix Femina et se vend à plus de 400 000 exemplaires. Mais ce succès fut préparé par la maestria déployée dans le livre précédent, La Petite femelle (éditions Julliard, 2015), portrait d’une jeune meurtrière de l’immédiate après-guerre haïe par ses juges et plus généralement par le patriarcat parce qu’elle refusait de marcher dans les clous d’une existence toute tracée de femme au foyer. Fidèle à sa verve truculente, Philippe Jaenada détaille les conditions de fabrication de cette true crime story de 700 pages, mais également des circonstances étranges qui l’ont amené à devenir écrivain. La Petite Femelle (Julliard, 2015) C’est l’histoire de Pauline Dubuisson, condamnée en 1953 pour le meurtre de son ex-petit ami, mais traînée dans la boue par les journaux pour avoir couché, jeune femme, avec l’occupant allemand, tout en refusant après-guerre un destin de femme au foyer pour devenir médecin. Après sept livres autobiographiques ayant fait de lui une sorte de Bukowski français (alcool, amour, humour, tiercé), c’est le livre qui a tout changé pour Philippe Jaenada. Extrêmement précis (selon sa méthode dite du « tapir enragé », vérifiant toutes les pièces du dossier jusqu’aux frontières de la folie), tout en cassant les codes de la chronique judiciaire par une avalanche d’apartés personnels particulièrement comiques.
Enregistrement janvier 20 Entretiens et découpage Richard Gaitet Prises de son Sara Monimart Montage Antoine Larcher Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Remerciements Nanou Harry & Aurélien Manya Lecture Laure Giappiconi Production ARTE Radio
La méthode du tapir enragé : un écrivain au travail (2/3)
Dans cette deuxième partie, Jaenada décortique l’origine et la documentation nécessaire à l’élaboration de La Petite femelle. Après sept livres autobiographiques ayant fait de lui une sorte de Bukowski français (alcool, amour, humour, tiercé) et une première enquête sur le braqueur Bruno Sulak, c’est l’ouvrage qui a tout changé pour lui, extrêmement précis (selon sa méthode dite du « tapir enragé », vérifiant toutes les pièces du dossier jusqu’aux frontières de la folie), tout en cassant les codes de la chronique judiciaire par une avalanche d’anecdotes personnelles particulièrement comiques. Le podcast Bookmakers C’est quoi, le style ? Comment construit-on une intrigue, un personnage ? Où faut-il couper ? Chaque mois, Bookmakers propose aux plus grand.e.s écrivain.e.s d’aujourd’hui de raconter, hors de toute promotion, l’étincelle initiale, les recherches, la discipline, les obstacles, le découragement, les coups de collier, la solitude, la première phrase, les relectures… mais aussi le rôle de l'éditeur, de l’argent, la réception critique et publique, le regard sur le texte des années plus tard. Animé par Richard Gaitet, écrivain et homme de radio, le podcast Bookmakers détruit le mythe d’une inspiration divine qui saisirait les auteurs au petit matin. Il rappelle que l'écriture est aussi un métier, un artisanat, un beau travail. En partenariat avec Babelio L'écrivain du mois : Philippe Jaenada Fils spirituel de Bukowski et de Jacques le fataliste, féru de courses hippiques ou de whisky écossais, allergique au voyage mais ne se déplaçant jamais sans son sac matelot, Philippe Jaenada, 55 ans, est peut-être l’écrivain le plus drôle de France. Toujours vêtu de noir, il surgit en 1997 avec Le Chameau sauvage, ou les galères d’un curieux célibataire, sacré d’un prix de Flore, adapté au cinéma et premier volet d’une série de sept romans autobiographiques sur lui, sa femme, leur fiston ou leurs vacances incendiaires en Italie. Suivra un second cycle, en cours depuis 2013, composé d’enquêtes sur des affaires criminelles écrites à la première personne, riches en digressions improbables, tout en étant comme possédées par l’obsession de la vérité – fidèle à sa méthode dite du « tapir enragé ». Bingo : La Serpe, en 2017, se voit couronné du prix Femina et se vend à plus de 400 000 exemplaires. Mais ce succès fut préparé par la maestria déployée dans le livre précédent, La Petite femelle (éditions Julliard, 2015), portrait d’une jeune meurtrière de l’immédiate après-guerre haïe par ses juges et plus généralement par le patriarcat parce qu’elle refusait de marcher dans les clous d’une existence toute tracée de femme au foyer. Fidèle à sa verve truculente, Philippe Jaenada détaille les conditions de fabrication de cette true crime story de 700 pages, mais également des circonstances étranges qui l’ont amené à devenir écrivain. La Petite Femelle (Julliard, 2015) C’est l’histoire de Pauline Dubuisson, condamnée en 1953 pour le meurtre de son ex-petit ami, mais traînée dans la boue par les journaux pour avoir couché, jeune femme, avec l’occupant allemand, tout en refusant après-guerre un destin de femme au foyer pour devenir médecin.
Enregistrement janvier 20 Entretiens et découpage Richard Gaitet Prises de son Sara Monimart Montage Antoine Larcher Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Lectures Laure Giappiconi Remerciements Nanou Harry & Aurélien Manya Lecture Laure Giappiconi Production ARTE Radio
Mais comment ça bosse, un chameau sauvage ? Un écrivain au travail (3/3)
Enfermé chez lui depuis des mois pour écrire son nouveau livre-enquête de possiblement mille pages, à paraître en 2021, à propos d'un étrangleur d'enfant, l’ours Jaenada sort de sa grotte et commente, dans cette troisième et dernière partie, son travail sur la phrase, son noble combat contre les expressions toutes faites (type : « c’est la goutte qui fait déborder le vase ») ou la place de l'argent dans sa vie d'écrivain. Le podcast Bookmakers C’est quoi, le style ? Comment construit-on une intrigue, un personnage ? Où faut-il couper ? Chaque mois, Bookmakers propose aux plus grand.e.s écrivain.e.s d’aujourd’hui de raconter, hors de toute promotion, l’étincelle initiale, les recherches, la discipline, les obstacles, le découragement, les coups de collier, la solitude, la première phrase, les relectures… mais aussi le rôle de l'éditeur, de l’argent, la réception critique et publique, le regard sur le texte des années plus tard. Animé par Richard Gaitet, écrivain et homme de radio, le podcast Bookmakers détruit le mythe d’une inspiration divine qui saisirait les auteurs au petit matin. Il rappelle que l'écriture est aussi un métier, un artisanat, un beau travail. En partenariat avec Babelio L'écrivain du mois : Philippe Jaenada Fils spirituel de Bukowski et de Jacques le fataliste, féru de courses hippiques ou de whisky écossais, allergique au voyage mais ne se déplaçant jamais sans son sac matelot, Philippe Jaenada, 55 ans, est peut-être l’écrivain le plus drôle de France. Toujours vêtu de noir, il surgit en 1997 avec Le Chameau sauvage, ou les galères d’un curieux célibataire, sacré d’un prix de Flore, adapté au cinéma et premier volet d’une série de sept romans autobiographiques sur lui, sa femme, leur fiston ou leurs vacances incendiaires en Italie. Suivra un second cycle, en cours depuis 2013, composé d’enquêtes sur des affaires criminelles écrites à la première personne, riches en digressions improbables, tout en étant comme possédées par l’obsession de la vérité – fidèle à sa méthode dite du « tapir enragé ». Bingo : La Serpe, en 2017, se voit couronné du prix Femina et se vend à plus de 400 000 exemplaires. Mais ce succès fut préparé par la maestria déployée dans le livre précédent, La Petite femelle (éditions Julliard, 2015), portrait d’une jeune meurtrière de l’immédiate après-guerre haïe par ses juges et plus généralement par le patriarcat parce qu’elle refusait de marcher dans les clous d’une existence toute tracée de femme au foyer. Fidèle à sa verve truculente, Philippe Jaenada détaille les conditions de fabrication de cette true crime story de 700 pages, mais également des circonstances étranges qui l’ont amené à devenir écrivain. La Petite Femelle (Julliard, 2015) C’est l’histoire de Pauline Dubuisson, condamnée en 1953 pour le meurtre de son ex-petit ami, mais traînée dans la boue par les journaux pour avoir couché, jeune femme, avec l’occupant allemand, tout en refusant après-guerre un destin de femme au foyer pour devenir médecin.
Enregistrement janvier 20 Entretiens et découpage Richard Gaitet Prises de son Sara Monimart Montage Antoine Larcher Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Lectures Laure Giappiconi Remerciements Nanou Harry & Aurélien Manya Lecture Laure Giappiconi Production ARTE Radio
Au pays des merveilles : une écrivaine au travail
Dans son panthéon : Tolkien, Zola, Faulkner ou Apollinaire, tous découverts durant l’enfance par cette lectrice et autrice précoce pour qui l’écriture a toujours été « le plus drôle de tous les jeux ». Sa rencontre à l’école primaire avec la romancière et dramaturge Géva Caban la conforte dans son désir d’explorer l’art du récit, en se posant les questions élémentaires. Peut-on chiper des idées à Stephen King ? Lui-même, n’aurait-il pas barboté quelques trucs et astuces à ses illustres prédécesseurs ? À qui envoyer sa prose, quand on a terminé ? Car c’est la règle, pour Alice : « Il faut d’abord apprendre à finir un texte. » Passée l’évocation de cette jeunesse normande, ce premier épisode s’attarde sur la « danse de l’hésitation » qui précéda la conception de son cinquième roman, « L’Art de perdre », lié à son histoire familiale, ses deux voyages nécessaires en Algérie, le choc ressenti devant le film « La Bataille d’Alger » (Gillo Pontecorvo, 1966) et ses recherches « totalement bordéliques ». En partenariat avec Babelio L’écrivaine du mois : Alice Zeniter Romancière, dramaturge, metteuse en scène, traductrice et scénariste, Alice Zeniter, 33 ans, est l’un des voix les plus énergiques de la littérature francophone. Née d’un père algérien et d’un mère française, diplômée de l’École Normale Supérieure, elle publie un premier roman confidentiel à 16 ans puis signe à 23 chez Albin Michel pour le second, « Jusque dans nos bras » (2010), dans lequel elle aborde la question du mariage blanc avec un héros malien menacé d'expulsion. Elle s’installe ensuite pendant trois ans à Budapest où elle enseigne le français, étudie le théâtre et « flâne ». Viendra « Sombre dimanche » (2013), roman d’une famille hongroise sur trois générations, puis « Juste avant l’oubli » (2015), à propos du suicide étrange d’un maître du polar sur une île brumeuse des Hébrides. Tout s’accélère deux ans plus tard avec « L’Art de perdre », prix Goncourt des lycéens, dont nous parlerons ici de A jusqu’à Z. « L’Art de perdre » (Flammarion, 2017) « Ai-je oublié d’où je viens ? », se demande Naïma, trentenaire parisienne en sévère gueule de bois. « Ma détresse n’aurait-elle pas la taille d’un pays manquant, d’une religion perdue ? » Par sa voix, L’Art de perdre suit le destin d’une famille kabyle sur trois générations – des années 40 à nos jours, sur 500 pages, en trois parties. Il y a d’abord Ali, le grand-père, harki, c’est-à-dire « supplétif indigène au service de l’armée française » comme dit le dico, contraint de fuir ses montagnes avec femme et enfants face au FLN et ses « règlements de compte au milieu de la nuit », à l’heure de l’indépendance de 1962. La deuxième partie se focalise sur Hamid, le père, qui n’oubliera jamais leur installation dans « la France froide », dans ces camps d’accueil insalubres et surpeuplés des Bouches-du-Rhône, entourés de barbelés, dans le silence de ceux qui attendent, humiliés, parqués « dans le royaume de la boue », « comme des bêtes nuisibles » ; Hamid, qui se politisera et s’en sortira grâce à ses études, et qui épousera une Française. Il y a enfin Naïma, la petite-fille, qui cherche sa place dans cet héritage. Sacré du Goncourt des lycéens et du prix du journal Le Monde, « L’Art de perdre » a beaucoup gagné : le roman se vend à plus de 580 000 exemplaires et décroche des récompenses en Espagne, en Suisse ou en Pologne, tandis que Barbet Schroeder obtient les droits d’adaptation au cinéma. Le succès critique n’a d’égal que sa reconnaissance publique, voire intime, lorsqu’au premier rang de certains festivals où Alice Zeniter est invitée, d’anciens harkis s’assoient parfois, en uniforme, la poitrine chargée de médailles, comme jadis son propre grand-père. Mais comment s’est-elle jetée dans cette fresque romanesque à haute teneur documentaire ? Parions que la réponse est dans Bookmakers. Le podcast Bookmakers devient une collection de livres ! Nicolas Mathieu, Alice Zeniter et Maria Pourchet nous dévoilent les coulisses de la fabrication de leurs œuvres. Comment travaillent-ils leur plume ? Ils nous détaillent leurs secrets d'écriture, de leur discipline, à leur rythme de travail. Une coédition ARTE Éditions / Points.
Enregistrements janvier-mars 2020 Entretien, découpage et lectures Richard Gaitet Prises de son Sara Monimart Montage Antoine Larcher Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Vers les vers blancs : une écrivaine au travail
Après l’origine de sa vocation, ses voyages en Algérie et sa documentation somme toute assez anarchique, Alice Zeniter revient en détails sur la structure de son best-seller, la naissance des personnages, l’intérêt – ou non – de puiser dans sa mythologie familiale, le juste dosage du style, voire sa maîtrise secrète du vers classique français, cachée (du bon pied) sous les phrases de son roman « L’Art de perdre ». En partenariat avec Babelio L’écrivaine du mois : Alice Zeniter Romancière, dramaturge, metteuse en scène, traductrice et scénariste, Alice Zeniter, 33 ans, est l’un des voix les plus énergiques de la littérature francophone. Née d’un père algérien et d’un mère française, diplômée de l’École Normale Supérieure, elle publie un premier roman confidentiel à 16 ans puis signe à 23 chez Albin Michel pour le second, « Jusque dans nos bras » (2010), dans lequel elle aborde la question du mariage blanc avec un héros malien menacé d'expulsion. Elle s’installe ensuite pendant trois ans à Budapest où elle enseigne le français, étudie le théâtre et « flâne ». Viendra « Sombre dimanche » (2013), roman d’une famille hongroise sur trois générations, puis « Juste avant l’oubli » (2015), à propos du suicide étrange d’un maître du polar sur une île brumeuse des Hébrides. Tout s’accélère deux ans plus tard avec « L’Art de perdre », prix Goncourt des lycéens, dont nous parlerons ici de A jusqu’à Z. « L’Art de perdre » (Flammarion, 2017) « Ai-je oublié d’où je viens ? », se demande Naïma, trentenaire parisienne en sévère gueule de bois. « Ma détresse n’aurait-elle pas la taille d’un pays manquant, d’une religion perdue ? » Par sa voix, L’Art de perdre suit le destin d’une famille kabyle sur trois générations – des années 40 à nos jours, sur 500 pages, en trois parties. Il y a d’abord Ali, le grand-père, harki, c’est-à-dire « supplétif indigène au service de l’armée française » comme dit le dico, contraint de fuir ses montagnes avec femme et enfants face au FLN et ses « règlements de compte au milieu de la nuit », à l’heure de l’indépendance de 1962. La deuxième partie se focalise sur Hamid, le père, qui n’oubliera jamais leur installation dans « la France froide », dans ces camps d’accueil insalubres et surpeuplés des Bouches-du-Rhône, entourés de barbelés, dans le silence de ceux qui attendent, humiliés, parqués « dans le royaume de la boue », « comme des bêtes nuisibles » ; Hamid, qui se politisera et s’en sortira grâce à ses études, et qui épousera une Française. Il y a enfin Naïma, la petite-fille, qui cherche sa place dans cet héritage. Sacré du Goncourt des lycéens et du prix du journal Le Monde, « L’Art de perdre » a beaucoup gagné : le roman se vend à plus de 580 000 exemplaires et décroche des récompenses en Espagne, en Suisse ou en Pologne, tandis que Barbet Schroeder obtient les droits d’adaptation au cinéma. Le succès critique n’a d’égal que sa reconnaissance publique, voire intime, lorsqu’au premier rang de certains festivals où Alice Zeniter est invitée, d’anciens harkis s’assoient parfois, en uniforme, la poitrine chargée de médailles, comme jadis son propre grand-père. Mais comment s’est-elle jetée dans cette fresque romanesque à haute teneur documentaire ? Parions que la réponse est dans Bookmakers. Le podcast Bookmakers devient une collection de livres ! Nicolas Mathieu, Alice Zeniter et Maria Pourchet nous dévoilent les coulisses de la fabrication de leurs œuvres. Comment travaillent-ils leur plume ? Ils nous détaillent leurs secrets d'écriture, de leur discipline, à leur rythme de travail. Une coédition ARTE Éditions / Points.
Enregistrements janvier-mars 2020 Entretien, découpage et lectures Richard Gaitet Prises de son Sara Monimart Montage Antoine Larcher Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
La stratégie de la semoule : une écrivaine au travail
Dans cette dernière partie de ce contrôle technique sur l’art littéraire d’Alice Zeniter, la romancière développe, toujours à propos de « L’Art de perdre », quels ont été les conseils de son éditrice, sa lecture commentée à voix haute du manuscrit entier à son compagnon, sa discipline quotidienne dans sa maison bretonne (repoussant très loin les limites de la semoule), l’accompagnement musical d’Idir ou de Dr. Dre, sa passion naturelle pour l’humour animalier, sa vision « fantasmée » du texte deux ans plus tard, son rapport à l’argent, ou encore sa décision de ne pas avoir d’enfant, liée, elle aussi, à l’écriture. En partenariat avec Babelio L’écrivaine du mois : Alice Zeniter Romancière, dramaturge, metteuse en scène, traductrice et scénariste, Alice Zeniter, 33 ans, est l’un des voix les plus énergiques de la littérature francophone. Née d’un père algérien et d’un mère française, diplômée de l’École Normale Supérieure, elle publie un premier roman confidentiel à 16 ans puis signe à 23 chez Albin Michel pour le second, « Jusque dans nos bras » (2010), dans lequel elle aborde la question du mariage blanc avec un héros malien menacé d'expulsion. Elle s’installe ensuite pendant trois ans à Budapest où elle enseigne le français, étudie le théâtre et « flâne ». Viendra « Sombre dimanche » (2013), roman d’une famille hongroise sur trois générations, puis « Juste avant l’oubli » (2015), à propos du suicide étrange d’un maître du polar sur une île brumeuse des Hébrides. Tout s’accélère deux ans plus tard avec « L’Art de perdre », prix Goncourt des lycéens, dont nous parlerons ici de A jusqu’à Z. « L’Art de perdre » (Flammarion, 2017) « Ai-je oublié d’où je viens ? », se demande Naïma, trentenaire parisienne en sévère gueule de bois. « Ma détresse n’aurait-elle pas la taille d’un pays manquant, d’une religion perdue ? » Par sa voix, L’Art de perdre suit le destin d’une famille kabyle sur trois générations – des années 40 à nos jours, sur 500 pages, en trois parties. Il y a d’abord Ali, le grand-père, harki, c’est-à-dire « supplétif indigène au service de l’armée française » comme dit le dico, contraint de fuir ses montagnes avec femme et enfants face au FLN et ses « règlements de compte au milieu de la nuit », à l’heure de l’indépendance de 1962. La deuxième partie se focalise sur Hamid, le père, qui n’oubliera jamais leur installation dans « la France froide », dans ces camps d’accueil insalubres et surpeuplés des Bouches-du-Rhône, entourés de barbelés, dans le silence de ceux qui attendent, humiliés, parqués « dans le royaume de la boue », « comme des bêtes nuisibles » ; Hamid, qui se politisera et s’en sortira grâce à ses études, et qui épousera une Française. Il y a enfin Naïma, la petite-fille, qui cherche sa place dans cet héritage. Sacré du Goncourt des lycéens et du prix du journal Le Monde, « L’Art de perdre » a beaucoup gagné : le roman se vend à plus de 580 000 exemplaires et décroche des récompenses en Espagne, en Suisse ou en Pologne, tandis que Barbet Schroeder obtient les droits d’adaptation au cinéma. Le succès critique n’a d’égal que sa reconnaissance publique, voire intime, lorsqu’au premier rang de certains festivals où Alice Zeniter est invitée, d’anciens harkis s’assoient parfois, en uniforme, la poitrine chargée de médailles, comme jadis son propre grand-père. Mais comment s’est-elle jetée dans cette fresque romanesque à haute teneur documentaire ? Parions que la réponse est dans Bookmakers. Le podcast Bookmakers devient une collection de livres ! Nicolas Mathieu, Alice Zeniter et Maria Pourchet nous dévoilent les coulisses de la fabrication de leurs œuvres. Comment travaillent-ils leur plume ? Ils nous détaillent leurs secrets d'écriture, de leur discipline, à leur rythme de travail. Une coédition ARTE Éditions / Points.
Enregistrements janvier-mars 2020 Entretien, découpage et lectures Richard Gaitet Prises de son Sara Monimart Montage Antoine Larcher Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Osez, osez Delphine : la naissance de l'écriture
Bookmakers #3 - L’écrivaine du mois : Delphine de Vigan Elle a vendu plus d’un million d’exemplaires de « Rien ne s’oppose à la nuit », son « No et moi » est déjà un classique, Delphine de Vigan est la troisième invitée du podcast Bookmakers sur les écrivain.e.s au travail. Comment s’autoriser soi-même à écrire puis à rendre public des secrets familiaux ? Où se situe la frontière entre la vérité et la fiction ? Loin d’une banale causerie-promo en plateau, une émission fouillée, alerte et précise sur les livres et le métier d’écrire. En partenariat avec Babelio (1/3) Osez, osez Delphine Ses romans sont longtemps nés la nuit, quand les enfants sont couchés, quand plus rien ne s’y oppose : « Les jolis garçons » puis « Un soir de décembre », sortis en 2005, narrent tous deux les désordres amoureux de cadres urbains bon chic bon genre. Le succès surgit par surprise deux ans plus tard via « No et moi », belle histoire d’amitié entre une ado surdouée et une clocharde de dix-huit ans, qui reçoit le prix des libraires avant de connaître une trentaine de traductions et une adaptation à l’écran par Zabou Breitman, l’emportant à long terme sur les cimes du million d’exemplaires vendus puisque nos enfants l’étudient désormais à l’école. Son sens de l’observation sociale s’épaissit dans « Les Heures souterraines » (2009), roman tendu du burn out, du harcèlement moral et des solitudes qui se croisent sans jamais se rencontrer, lui valant sa première nomination pour le Goncourt. Mais d’où vient cette grande blonde à bottines, littérairement parlant ? Quelle fut la place de ce journal intime tenu pendant dix-sept ans et qui sommeille encore dans une cave ? Est-il vrai que cette conversation contient un bref extrait de son premier-premier roman, humoristique et jamais publié ? Ce sont quelques-uns des attraits de cette conversation avec Delphine de Vigan, héritière d’Annie Ernaux et de James Salter, entre introspection ciselée et drames existentiels, qui ouvrit un jour l’un de ses livres avec ce fragment de Roland Barthes : « Savoir que l’écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas – c'est le commencement de l'écriture. » « Rien ne s’oppose à la nuit » (éditions JC Lattès, 2011) C’est avec ce roman-portrait sur « l’origine de la souffrance » de sa mère bipolaire, écrit dans « l’état de choc » imposé par le suicide de celle-ci, que Delphine de Vigan s’impose en librairies ; en lice pour le Goncourt, l’ouvrage remporte le prix du roman Fnac, celui des lectrices du magazine Elle et lui ouvre la voie d’une littérature à la fois populaire et exigeante, touchant au cœur à nouveau un million de personnes par sa vulnérabilité à ciel ouvert et l’extrême délicatesse de cette enquête familiale qui intègre les « errances narratives » de l’autrice, au plus près des émotions, avec pudeur et précision. Le triomphe du livre suivant, vraie-fausse autofiction « pour se jouer du lecteur » parue sous le titre ironique « D’après une histoire vraie » (750 000 exemplaires vendus, prix Renaudot et Goncourt des lycéens 2015, adapté au cinéma par Roman Polanski) à propos d’une romancière à succès vampirisée par une admiratrice, consolide pour de bon l’aura de ses récits tourmentés.
Enregistrements juin 20 Entretien, découpage Richard Gaitet Montage Sara Monimart Lectures Ariane Brousse, Richard Gaitet Réalisation, prise de son, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Rien qu’une humble vérité
Bookmakers #3 - L’écrivaine du mois : Delphine de Vigan Elle a vendu plus d’un million d’exemplaires de « Rien ne s’oppose à la nuit », son « No et moi » est déjà un classique, Delphine de Vigan est la troisième invitée du podcast Bookmakers sur les écrivain.e.s au travail. Comment s’autoriser soi-même à écrire puis à rendre public des secrets familiaux ? Où se situe la frontière entre la vérité et la fiction ? Loin d’une banale causerie-promo en plateau, une émission fouillée, alerte et précise sur les livres et le métier d’écrire. En partenariat avec Babelio (2/3) Rien qu’une humble vérité « Si j’ai écrit ce livre, c’est aussi parce que durant toute mon enfance, j’ai entendu des gens dirent : il faudra écrire sur cette famille. » En 2010, Delphine de Vigan s’engage toute entière dans l’écriture – qui ne dura que neuf mois – d’un roman prenant pour cadre et personnages sa tribu « joyeuse et dévastée ». Le temps d’offrir, plus précisément, un « cercueil de papier » à sa mère bipolaire, qu’elle rebaptise Lucile. « Rien ne s’oppose à la nuit » s’ouvre sur la découverte du corps de celle-ci, quelques jours après son suicide, par Delphine elle-même. La romancière interroge longuement ses oncles et ses tantes, enclenche le processus mais très vite, « l’élan » se brise. Quelle énergie faut-il pour faire naître un roman de deuil ? Comment s’autoriser soi-même à écrire puis à rendre public des secrets familiaux ? Comment « rapiécer les trous » de la mémoire ? Où se situe la frontière entre la vérité et la fiction ? Est-ce un soulagement d’écrire tout ça, vraiment ? Les réponses se trouvent dans cette deuxième partie de Bookmakers, pour laquelle Delphine de Vigan a, pour la première fois, relu à voix haute certains passages parmi les plus durs de son livre.
Enregistrements juin 2020 Entretien, découpage Richard Gaitet Montage Sara Monimart Lectures Ariane Brousse, Richard Gaitet Réalisation, prise de son, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Mes heures souterraines
Bookmakers #3 - L’écrivaine du mois : Delphine de Vigan Elle a vendu plus d’un million d’exemplaires de « Rien ne s’oppose à la nuit », son « No et moi » est déjà un classique, Delphine de Vigan est la troisième invitée du podcast Bookmakers sur les écrivain.e.s au travail. Comment s’autoriser soi-même à écrire puis à rendre public des secrets familiaux ? Où se situe la frontière entre la vérité et la fiction ? Loin d’une banale causerie-promo en plateau, une émission fouillée, alerte et précise sur les livres et le métier d’écrire. En partenariat avec Babelio (3/3) Mes heures souterraines « Le succès, confie Delphine de Vigan à propos du million d’exemplaires vendus de "Rien ne s’oppose à la nuit", je l’ai vécu comme une peur. C’est vertigineux. Comme un tourbillon malgré tout joyeux. Je le souhaite à n’importe quel auteur. En même temps, il y a quelque chose de dangereux. Si j’avais connu un succès pareil plus tôt, je n’aurais probablement pas pu réécrire derrière. » En pleine élaboration de son prochain roman (policier), celle qui se décrit comme « une hypersensible en voie d’apaisement, une hyperactive en voie de ralentissement, une hyper-susceptible en quête d’auto-dérision » revient ici, dans cette troisième et dernière partie, sur sa vie d’autrice avant et après les triomphes éditoriaux, sur son style « fluide » porté par « une grande économie de moyens », sur l’imprévisible aide à l’écriture de son lave-linge et de son lave-vaisselle, voire sur une étrange affaire… de radio fantôme. Le tout, naturellement, d’après une histoire vraie.
Enregistrements juin 2020 Entretien, découpage Richard Gaitet Montage Sara Monimart Lectures Ariane Brousse, Richard Gaitet Réalisation, prise de son, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Jungles en mémoire
Bookmakers #4 - L’écrivain du mois : Tristan Garcia À l’aube de ses 40 ans, Tristan Garcia est déjà l’auteur de quinze ouvrages, dont la puissance d’imagination, la rigueur conceptuelle et la variété laissent pantois. Originaire de Toulouse, ce romancier et professeur de philosophie installé à Lyon se fait connaître à 27 ans avec « La meilleure part des hommes », un « conte moral » sur les ravages du sida dans le Paris des années 90, distingué du prix de Flore et traduit en quatre langues. Dans ses romans, ce fan de science-fiction et de littérature de genre écrit sur nos futurs, l’ultragauche, les sports oubliés ou un singe surdoué, sans oublier ses essais théoriques sur le droit des animaux, l'intensité, le sens du collectif ou la série « Six Feet Under ». En 2015, son recueil magistral de sept histoires fantastiques, paru sous le titre « 7 », reçoit le prix du Livre Inter et s’écoule à 60 000 exemplaires. En partenariat avec Babelio (1/4) Jungles en mémoire C’est un homme à la voix juvénile et d’une extrême pudeur, qui surgit en 2008 avec un premier roman très cru aiguisé pour être « une machine de guerre contre l’autofiction ». Quand Tristan Garcia publie à 27 ans « La meilleure part des hommes », un « conte moral » sur les débats, les ébats et les ravages du sida dans le Paris des années 90, ce normalien timide originaire de Toulouse, qui rêve de continents perdus, de dimensions parallèles, de transmigration des âmes et d’amour éternel, part à l’attaque de la littérature de l’intime. Il se « contrefiche de lui-même » et n’a pas « le moindre désir » de reconstituer la « petite prison de ses perceptions », ou de se créer un double de papier qui « boucherait son horizon ». Douze ans plus tard, le paysage est vaste. À l’aube de ses 40 ans, Tristan Garcia est déjà l’auteur de quinze ouvrages, dont la puissance d’imagination, la rigueur conceptuelle et la variété laissent pantois. Dans le désordre : un essai sur la série « Six Feet Under » (« Nos vies sans destin ») ; un recueil magistral de sept histoires fantastiques toutes liées entre elles, paru sous le titre « 7 », un roman sur un activiste d’ultragauche surdoué qui se prend pour le diable (« Faber, le destructeur »), un recueil de nouvelles sur des sports oubliés (« En l’absence de classement final »), une fiction de S.-F. sur un astronaute capable d’arrêter le temps (« Les Cordelettes de Browser »), un roman d’aventures scientifiques en partie rédigé par un singe qui essaie d’écrire en français (« Mémoires de la jungle »), quand il ne s’abîme pas dans « Âmes », sa gigantesque trilogie en cours sur la souffrance à tous les âges du vivant, sans oublier tous les livres théoriques de ce prof’ de philo désormais lyonnais, sur le droit des animaux, l’intensité, le sens du collectif… Mais comment tout a démarré ? Quelle est l’origin story de ce fan encyclopédique de bande dessinée ? De cet ogre de lecture à la mémoire photographique sidérante ? Lui qui créa un héros « dont l’intelligence sans sol ni plafond est une malédiction » ? Quels souvenirs demeurent de son enfance en Algérie ? Parmi tous ses nombreux romans « morts-nés » rédigés à l’adolescence, est-il vrai que l’un met en scène… le kidnapping de Beyoncé ?
Enregistrements juillet 20 Entretien, découpage et lectures Richard Gaitet Prise de son Arnaud Forest Montage Sara Monimart Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
La part des choses
Bookmakers #4 - L’écrivain du mois : Tristan Garcia À l’aube de ses 40 ans, Tristan Garcia est déjà l’auteur de quinze ouvrages, dont la puissance d’imagination, la rigueur conceptuelle et la variété laissent pantois. Originaire de Toulouse, ce romancier et professeur de philosophie installé à Lyon se fait connaître à 27 ans avec « La meilleure part des hommes », un « conte moral » sur les ravages du sida dans le Paris des années 90, distingué du prix de Flore et traduit en quatre langues. Dans ses romans, ce fan de science-fiction et de littérature de genre écrit sur nos futurs, l’ultragauche, les sports oubliés ou un singe surdoué, sans oublier ses essais théoriques sur le droit des animaux, l'intensité, le sens du collectif ou la série « Six Feet Under ». En 2015, son recueil magistral de sept histoires fantastiques, paru sous le titre « 7 », reçoit le prix du Livre Inter et s’écoule à 60 000 exemplaires. En partenariat avec Babelio (2/4) La part des choses « Le pic de l’autofiction parisienne m’énervait. Je me suis dit : tente le contre-pied radical, très loin de toi, sur une expérience non-vécue. » Quand Tristan Garcia s’attelle en 2006, à 25 ans, à l’écriture de « La meilleure part des hommes », qui sera son premier roman publié deux ans plus tard aux éditions Gallimard, ce Toulousain straight, pudique et poli, qui ne connaît de Paris que « trois stations de métro », s’efforce d’adopter « une autre manière d’aimer, de parler, de penser ». Et choisit d’entrecroiser, « avec vitesse et impureté », dans les années 90 contaminées par le sida, les langues et les destins d’un écrivain gay toxicomane adepte de l’amour sans capote (fortement inspiré de Guillaume Dustan), d’une figure du militantisme de prévention (on pense vite à Didier Lestrade, fondateur d’Act-Up), d’un philosophe de gauche qui vire réactionnaire (beaucoup y ont vu le parcours d’Alain Finkielkraut) et d’une journaliste de Libé – caricaturale et, de son propre aveu, « ratée » –, qui fait le lien entre les trois. Distingué du très branché prix de Flore et vendu à 50 000 exemplaires, traduit en quatre langues et monté au théâtre, « La meilleure part des hommes » vaudra à Tristan Garcia énormément d’embarras et de malentendus. S’il ne s’agit pas de la meilleure part de son œuvre, cette entrée en littérature riche en enseignements va nous permettre, dans ce deuxième épisode, de réfléchir à des questions capitales pour notre époque : comment se projeter dans un autre genre que le sien ? Et l’usage du mot « pédé » quand on est hétéro, c’est OK ou pas ?
Enregistrements juillet 20 Entretien, découpage et lectures Richard Gaitet Prise de son Arnaud Forest Montage Sara Monimart Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Un chiffre et des lettres
Bookmakers #4 - L’écrivain du mois : Tristan Garcia À l’aube de ses 40 ans, Tristan Garcia est déjà l’auteur de quinze ouvrages, dont la puissance d’imagination, la rigueur conceptuelle et la variété laissent pantois. Originaire de Toulouse, ce romancier et professeur de philosophie installé à Lyon se fait connaître à 27 ans avec « La meilleure part des hommes », un « conte moral » sur les ravages du sida dans le Paris des années 90, distingué du prix de Flore et traduit en quatre langues. Dans ses romans, ce fan de science-fiction et de littérature de genre écrit sur nos futurs, l’ultragauche, les sports oubliés ou un singe surdoué, sans oublier ses essais théoriques sur le droit des animaux, l'intensité, le sens du collectif ou la série « Six Feet Under ». En 2015, son recueil magistral de sept histoires fantastiques, paru sous le titre « 7 », reçoit le prix du Livre Inter et s’écoule à 60 000 exemplaires. En partenariat avec Babelio (3/4) Un chiffre et des lettres « La grande forme du roman se déploie quand on essaie d’outrepasser les bornes de son existence, quand on s’extrait de soi, quand on tente d’envelopper plusieurs vies, réelles ou imaginaires. » Dans l’univers multiple des livres de Tristan Garcia, ouvrons maintenant la porte d’entrée la plus claire. Le titre de ce roman, publié en 2015 chez Gallimard, est un chiffre : « 7 », comme le nombre d’histoires qui composent cette suite de « romans miniatures » lisibles de manière indépendante mais qui finissent par laisser apparaître l’architecture d’un grand roman d’imagination, rare et généreux, semblable à sept épisodes de « La Quatrième Dimension ». Sacré du prix du Livre Inter, écoulé à plus de 60 000 exemplaires, il y est question d’une drogue qui permet de se reconnecter à des états antérieurs de conscience, de rouleaux de bois à l’origine de toutes les révolutions musicales du vingtième siècle, d’une mannequin riche et célèbre qui ne doit sa beauté qu’à un jeune homme défiguré, d’une France fantomatique où la révolution prolétarienne a eu lieu, d’extraterrestres, d’hémisphères sous cloches où les gens ne se regroupent plus que par affinités ethniques ou socio-culturelles, ou d’un garçon qui revivra sept fois sa vie du début à la fin… Comment tout ceci s’est-il construit ? Comment fonctionnent les mécanismes de son imagination, jusqu’au passage à la phrase elle-même, chez cet écrivain pour qui la sacro-sainte question du style est toujours secondaire ? Dans ce troisième épisode, Tristan Garcia nous ouvre sa boîte à outils.
Enregistrements juillet 20 Entretien, découpage et lectures Richard Gaitet Prise de son Arnaud Forest Montage Sara Monimart Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Tristan, le constructeur
Bookmakers #4 - L’écrivain du mois : Tristan Garcia À l’aube de ses 40 ans, Tristan Garcia est déjà l’auteur de quinze ouvrages, dont la puissance d’imagination, la rigueur conceptuelle et la variété laissent pantois. Originaire de Toulouse, ce romancier et professeur de philosophie installé à Lyon se fait connaître à 27 ans avec « La meilleure part des hommes », un « conte moral » sur les ravages du sida dans le Paris des années 90, distingué du prix de Flore et traduit en quatre langues. Dans ses romans, ce fan de science-fiction et de littérature de genre écrit sur nos futurs, l’ultragauche, les sports oubliés ou un singe surdoué, sans oublier ses essais théoriques sur le droit des animaux, l'intensité, le sens du collectif ou la série « Six Feet Under ». En 2015, son recueil magistral de sept histoires fantastiques, paru sous le titre « 7 », reçoit le prix du Livre Inter et s’écoule à 60 000 exemplaires. En partenariat avec Babelio (4/4) Tristan, le constructeur Des romans, des nouvelles et des pavés de métaphysique. Au total : quinze bouquins publiés en l’espace de douze ans, sans oublier des préfaces, des conférences et des articles à la pelle que l’on compile déjà en recueil. À 39 ans, Tristan Garcia dit souvent que l’écriture de tous ses ouvrages – qui auraient grandi « comme un toit de tuile », les uns sous les autres – fut « assez anarchique ». Il dit parfois aussi qu’il lui aura fallu « dans chaque roman, rater quelque chose pour en retirer un savoir-faire ». Mais comment fait-il, sérieusement, pour écrire autant ? Dans ce quatrième et dernier épisode, ce professeur de philosophie lyonnais, qui refuse farouchement de se professionnaliser en tant qu’auteur, ce mélomane et cinéphile compulsif, qui vit sans téléphone et ne s’exprime jamais sur les réseaux, détaille sa relation complexe au milieu littéraire, à l’argent ou à son propre corps, frappé de névralgie faciale en écrivant sept cents pages… sur « l’histoire de la souffrance ». Tristan Garcia imagine enfin l’écrivain qu’il sera en 2040, convoqué par « le tribunal de sa propre jeunesse ».
Enregistrements juillet 20 Entretien, découpage et lectures Richard Gaitet Prise de son Arnaud Forest Montage Sara Monimart Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Illustrations Sylvain Cabot Production ARTE Radio
L’écume des jours premiers
Bookmakers #5 - L’écrivaine du mois : Chloé Delaume Référence de l'autofiction en France, laborantine exigeante de l'écriture, Chloé Delaume, l'autrice du "Cri du sablier", des "Sorcières de la République", de "Mes bien chères sœurs " et du tout récent "Le Coeur synthétique", est la cinquième invitée du podcast Bookmakers. En partenariat avec Babelio (1/3) L’écume des jours premiers Elle le dit souvent, sans détour : « J’écris pour exister. Le réel, j’ai du mal. » Chloé Delaume n’est pas seulement cette autrice parisienne, féministe majuscule férue de sorcellerie comme de cold wave, d’humour noir comme de magie noire, grande prêtresse de la sororité qui fête cette année deux décennies de publications noir corbeau : romans, essais, pièces, poèmes, performances, scénarios, chansons ou fan-fiction, des « Mouflettes d’Atropos » (2000) au tout récent « Le Cœur synthétique » (2020). Car celle qui se dépeint parfois comme « la cousine germaine de Morticia Addams », ex-gothique ayant mué dame de Pique en « robe noire stricte de chez Dévastée et talons aiguilles vifs sanglants », est aussi le personnage principal de la plupart de ses ouvrages, alter ego de papier minutieusement construit en réaction aux déflagrations d’une enfance malheureuse, meurtrie par un drame familial extrêmement brutal. Pour survivre, l’adolescente éprise de Racine et de Rimbaud se choisit deux pères de substitution, Boris Vian et Antonin Artaud, qui lui montrent que la langue française est un palais à entretenir de « préoccupations esthétiques ». Choc. Puis c’est dans l’autofiction et les revues de littérature expérimentale assez confidentielles que Chloé Delaume trouve « une force politique, une discipline existentielle » et mille manières d’exploser les codes de la narration, via d’ingénieux dispositifs à contraintes. Dans ce premier épisode, elle nous raconte l’accouchement douloureux d’un brillant et sidérant monstre de fiction : elle-même.
Enregistrements septembre 20 Entretien, découpage Richard Gaitet Prise de son, montage Sara Monimart Lectures Jennifer Anyoh, Stella Defeyder, Richard Gaitet, Sara Monimart Réalisation, mixage Charlie Marcelet Musiques originales Samuel Hirsch Illustration Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Où le sang nous entraîne
Bookmakers #5 - L’écrivaine du mois : Chloé Delaume Référence de l'autofiction en France, laborantine exigeante de l'écriture, Chloé Delaume, l'autrice du "Cri du sablier", des "Sorcières de la République", de "Mes bien chères sœurs " et du tout récent "Le Coeur synthétique", est la cinquième invitée du podcast Bookmakers. En partenariat avec Babelio (2/3) Où le sang nous entraîne Quand Chloé Delaume publie à 28 ans « Le Cri du sablier », sa deuxième autofiction aux éditions Farrago, elle réussit l’autopsie de ce « sale crime » de juin 1983, quand elle avait 9 ans : son père qui tua sa mère sous ses yeux, et ce qui suivit, quand, écrit-elle, « Papa s’est nagasakié le crâne ». Avec un courage fou, doublé d’un ahurissant travail sur la langue, elle ausculte ce « lien du sang bien touillé folie en héritage », en « prenant les paragraphes grumeleux à pleines mains », pour « s’amputer du père » tout en « foutant le feu au jardin ». Auréolé du prestigieux prix Décembre et vendu à plus de dix mille exemplaires, cet acte de résilience incroyable, cette enquête introspective assez brève, narrée dans une prose très exigeante (mots rares, vers blancs, syntaxe bousculée), dont les premières pages sont « volontairement au bord de l’illisible » afin de « faire le tri » entre les lecteurs et les « voyeurs », mérite de regarder de près l’écoulement de chaque grain de sable. Comment fait-elle jaillir, comme ça, tous ces alexandrins ? Quel est le rôle des blagues, oui, de son humour « sordide », dans un paysage si funèbre ? Et à quel rythme travaille-t-elle ? Est-il vrai que Madame écrit de nuit, jusqu’à « tomber d’épuisement » sur le clavier, pendant parfois soixante-douze d’affilée ? Et si c’était ça, aussi, le cri du sablier ?
Enregistrements septembre 20 Entretien, découpage Richard Gaitet Prise de son, montage Sara Monimart Lectures Jennifer Anyoh, Stella Defeyder, Richard Gaitet, Sara Monimart Réalisation, mixage Charlie Marcelet Musiques originales Samuel Hirsch Illustration Sylvain Cabot Production ARTE Radio
La Sorcière de la Stylistique
Bookmakers #5 - L’écrivaine du mois : Chloé Delaume Référence de l'autofiction en France, laborantine exigeante de l'écriture, Chloé Delaume, l'autrice du "Cri du sablier", des "Sorcières de la République", de "Mes bien chères sœurs " et du tout récent "Le Coeur synthétique", est la cinquième invitée du podcast Bookmakers. En partenariat avec Babelio (3/3) La Sorcière de la Stylistique Longtemps cantonnée aux tubes à essai de ses livres dits « de laboratoire », Chloé Delaume décide, au mitan des années 2010, d’opérer sa mue : elle souhaite désormais « parler aux copines » et leur donner « des armes, des outils » à travers ce geste qu’elle a longtemps « vomi » : celui de raconter des histoires. Il y aura d’abord « Les Sorcières de la République », son premier véritable roman, paru en 2016 aux éditions du Seuil, sur le bref accès au pouvoir, en France, d’une secte féministe magique, dont les sortilèges s’écoulent à dix mille exemplaires. La démarche s’accompagnera trois ans plus tard d’un essai puissant, « Mes bien chères sœurs », manifeste pour une sororité de combat, qui consigne « l’Apocalypse d’après Weinstein (…), les porcs balancés dans un étang de feu » (…), tout en remixant « Le Chant des partisans » version pétroleuse, un schlass à la main. C’est un succès : vingt mille exemplaires vendus, qui l’encouragent à poursuivre dans cette voie. En témoigne aujourd’hui « Le Cœur synthétique », son livre le plus accessible, comédie noire du célibat passé 45 ans, grave et légère à la fois, publiée à la rentrée dernière. Qu’il semble loin, le temps où cette héritière de l’Oulipo et des pataphysiciens déclarait : « On peut faire des romans d’aventures avec des moyens plus contemporains qu’un voyage en Egypte. » En 2003, son livre « Corpus Simsi » était composé à partir de captures d’écran de son avatar immergé dans le jeu vidéo « Les Sims » ; en 2004, « Certainement pas » adoptait la structure du Cluedo dans l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, « fidèle au peuple des pyjamas bleus » ; en 2006, pour « J’habite dans la télévision », Chloé Delaume resta vingt-deux mois devant son petit écran, du lever au coucher, ingurgitant le maximum de publicités et de programmes de téléréalité, pour en ramener « des infos du réel » et une vraie mutation : deux kystes à l’œil, sept kilos supplémentaires et « plus de pensée propre » ; en 2007, elle signait une fan-fiction en hommage à la série « Buffy contre les vampires », inspirée des fameux « livres dont vous êtes le héros », ces romans-jeux interactifs à choix multiples. D’où cette question ludique, qui guide ce troisième et dernier épisode : en quoi ces contraintes l’ont-elles aidées à délier sa langue et libérer son imagination ? Et comment sortir du labo, pour aller sans se renier vers une littérature populaire de qualité ?
Enregistrements septembre 20 Entretien, découpage Richard Gaitet Prise de son, montage Sara Monimart Lectures Jennifer Anyoh, Stella Defeyder, Richard Gaitet, Sara Monimart Réalisation, mixage Charlie Marcelet Musiques originales Samuel Hirsch Illustration Sylvain Cabot Production ARTE Radio
L’énigme de l’arrivée
Bookmakers #6 - L’écrivain du mois : Dany Laferrière Né en 1953 à Port-au-Prince (Haïti), élu en 2013 à l'Académie Française, Dany Laferrière est l'auteur savoureux d'un vaste cycle autobiographique de trente-deux ouvrages, parmi lesquels « Comment faire avec l'amour avec un Nègre sans se fatiguer » (1985), « Vers le Sud » (2006) ou « L'Enigme du retour » (2009), complété aujourd'hui par des ouvrages entièrement écrits et dessinés à la main, dont le titre du dernier, publié cette année, dit beaucoup sur sa vie : « L'Exil vaut le voyage ». En partenariat avec Babelio (1/3) L’énigme de l’arrivée C’est l’histoire d’un marmot des Caraïbes aux genoux maigres et « pointus » qui, par la seule force de ses mots malicieux, réussit peu à peu à « faire disparaître l’argent », à voyager et à manger sans débourser un seul centime, à « traverser le monde en sifflotant ». D’un jeune Haïtien qui, fuyant la dictature de François « Papa Doc » Duvalier et les balles des tontons macoutes, débarque sans papiers à Montréal en 1976 et, près de quarante plus tard, accède au statut d’Immortel en devenant le second écrivain noir à rejoindre le cénacle de l’Académie Française. Entre ici, Dany Laferrière ! Dans ce premier épisode, ce romancier savoureux de la paresse et de la sensualité, auteur-conteur-dessinateur d’une vaste autobiographie en trente-deux volumes ayant démarré en 1985 par un succès intitulé « Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer », revient à 67 ans sur l’éveil de sa vocation. Via ses premières lectures, ses premières histoires, ses premières lectrices, ses corrections spontanées du quotidien de son île sur la table de la cuisine familiale qui lui ouvrent les portes du journalisme, ou encore sur son exil obligé après une nuit dramatique « dans l’œil du cyclone », qui marque le début de sa « vie en zigzag », catapulté dans une ville où l’hiver rigoureux du Canada lui imposera de s’enfermer dans une chambre « crasseuse et lumineuse » pour écrire, non pas un, mais deux premiers romans.
Enregistrement octobre 2020 Entretien, découpage Richard Gaitet Prise de son, montage Sara Monimart Lectures Arnaud Forest, Richard Gaitet, Samuel Hirsch, Annabelle Martella, Emilie Mendy Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Trompette Vincent Défossé Illustration Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Peindre ou faire l’amour
Bookmakers #6 - L’écrivain du mois : Dany Laferrière Né en 1953 à Port-au-Prince (Haïti), élu en 2013 à l'Académie Française, Dany Laferrière est l'auteur savoureux d'un vaste cycle autobiographique de trente-deux ouvrages, parmi lesquels « Comment faire avec l'amour avec un Nègre sans se fatiguer » (1985), « Vers le Sud » (2006) ou « L'Enigme du retour » (2009), complété aujourd'hui par des ouvrages entièrement écrits et dessinés à la main, dont le titre du dernier, publié cette année, dit beaucoup sur sa vie : « L'Exil vaut le voyage ». En partenariat avec Babelio (2/3) Peindre ou faire l'amour « Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer. » En 1985, une jeune maison d’édition québécoise, VLB, publie le premier roman au titre provocateur d’un écrivain haïtien de 32 ans, qui enchaîne depuis près d’une décennie les boulots crevants d’ouvrier en usine (occupé, parfois, à « décapiter des vaches »), quand il ne nettoie pas les toilettes de l’aéroport de Montréal. Mais le soir, ce disciple fasciné de fantaisies sexuelles autofictionnelles signées Henry Miller ou Charles Bukowski s’invente une existence qu’il tape « avec frénésie » sur sa Remington 22. « J’ai mis dans mon livre tout ce qui me manquait dans la réalité : du vin, des copains, des filles riantes, des conversations animées. » Succès d’édition dont il semble impossible, aujourd’hui, de connaître le nombre d’exemplaires écoulés, ce roman « au grand rire jazz », réédité cet automne chez Zulma, dans lequel deux jeunes Noirs fauchés, un été, « philosophent à perdre haleine à propos de la Beauté » tout en recevant dans leurs lits « des éclopées, des soulardes, des poétesses », où les sourates du Coran côtoient Charlie Parker et des séances de « baise carnivore » dans leur taudis, « allume un incendie » sur le chemin de Dany Laferrière. Des associations antiracistes américaines, qui n’ont évidemment pas lu ce livre bardé d’ironie subtile où le mot « nègre » revient parfois sept fois par page, en exigent la censure – faisant par ricochet de son auteur « une célébrité mondiale ». Des lecteurs sénégalais ou ivoiriens lui témoignent de l’admiration et la télévision québécoise l’embauche pour… présenter la météo ; soudain, dit-il, « un Noir annonce les blancheurs neigeuses, avec humour », notoriété qui l’emportera par la suite sur les ondes de Radio-Canada. Ce roman « récréation », célébration joyeuse de l’instant présent et hommage assumé à ses mentors américains qui ne contient pas la moindre trace de ses origines haïtiennes, devient même un film, en 1989, qu’il co-écrit, avec une BO de Manu Dibango. Dans ce deuxième épisode, écoutons l’artificier Laferrière raconter la genèse et faire parler la poudre de sa « petite bombe » de 185 pages.
Enregistrement octobre 2020 Entretien, découpage Richard Gaitet Prise de son, montage Sara Monimart Lectures Arnaud Forest, Richard Gaitet, Samuel Hirsch, Annabelle Martella, Emilie Mendy Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Trompette Vincent Défossé Illustration Sylvain Cabot Production ARTE Radio
Revers de Sud
Bookmakers #6 - L’écrivain du mois : Dany Laferrière Né en 1953 à Port-au-Prince (Haïti), élu en 2013 à l'Académie Française, Dany Laferrière est l'auteur savoureux d'un vaste cycle autobiographique de trente-deux ouvrages, parmi lesquels « Comment faire avec l'amour avec un Nègre sans se fatiguer » (1985), « Vers le Sud » (2006) ou « L'Enigme du retour » (2009), complété aujourd'hui par des ouvrages entièrement écrits et dessinés à la main, dont le titre du dernier, publié cette année, dit beaucoup sur sa vie : « L'Exil vaut le voyage ». En partenariat avec Babelio (3/3) Revers de Sud « J’écris dans mon lit, je lis dans mon bain : je suis un homme horizontal. » Mais ce « spécialiste mondial de la sieste », comme dit parfois Dany Laferrière en parlant de lui-même, travaille tout de même beaucoup. En 1990, cinq ans après la sortie de son sulfureux premier ouvrage, l’écrivain quitte Montréal pour Miami, en famille. Aux Etats-Unis, il écrit dix romans en douze ans, dont le fameux cycle haïtien, l’ossature de son œuvre : « L’Odeur du café » (1991), « Le Goût des jeunes filles » (1992), « Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit ? » (1993), « Pays sans chapeau » (1996), « La Chair du maître (1997), « Le Charme des après-midi sans fin » (1997), « Le Cri des oiseaux fous » (2000)… Puis Dany Laferrière est saisi d’une sorte de « fatigue », qui l’empêche d’envisager de nouveaux récits. C’est là qu’il accomplit un geste extrêmement rare, désarçonnant les critiques et les universitaires : il réécrit six de ses romans, augmentés parfois de 150 pages, aménageant des passerelles entre les livres pour découvrir qu’il s’agit en fait d’un seul et même bouquin : son « autobiographie américaine » qui lie le cycle nord-américain et le cycle haïtien. « J’ajoute, j’élimine, je touche au style, aucun scrupule. » En 2009, pourtant, l’inspiration lui revient de la plus bouleversante des manières. Son livre « L’Enigme du retour » s’ouvre sur l’annonce de la mort de son père, contraint à l’exil depuis près d’un demi-siècle du fait de son opposition au régime de Papa Doc. Dany rentre donc au pays pour annoncer à son tour cette nouvelle à sa mère. Dans le carnet noir qui ne le quitte jamais, il note alors « tout ce qui bouge », scène de marché, sommeil d’homme ou mouvement d'insecte, en traversant son île « à la recherche d’une sérénité ». Publié aux éditions Grasset, traduit dans huit langues, ce magnifique roman de deuil et de transmission sous « crépuscule rose », au rythme poétique inouï, d’une simplicité de vieux maître dont « la mémoire se dégèle », s’écoule à 70 000 exemplaires et décroche le prestigieux prix Médicis. Ce retour en grâce l’encourage à s’installer à Paris et, plus tard, à postuler à l’Académie Française. L’audace est payante : en janvier 2013, le petit rêveur de Petit-Goâve devient le « collègue de Voltaire et de Montesquieu » et l’auteur de « Vers le Sud » entre sous la Coupole avec une divinité vaudou sculptée sur son épée, Legba, « celui qui ouvre la barrière pour passer du monde visible au monde invisible. En somme, le dieu des écrivains ».
Enregistrement octobre 2020 Entretien, découpage Richard Gaitet Prise de son, montage Sara Monimart Lectures Arnaud Forest, Richard Gaitet, Samuel Hirsch, Annabelle Martella, Emilie Mendy Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Trompette Vincent Défossé Illustration Sylvain Cabot Production ARTE Radio
La tempête qui s’annonce
Bookmakers #7 - L’écrivaine du mois : Lola Lafon Née en 1974, Lola Lafon est l’autrice de six romans qui mettent en scène des trajectoires féminines singulières, en interrogeant la violence et les mensonges de la société à leur égard : « Une fièvre impossible à négocier » (2003), « De ça je me console » (2007), « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce » (2011), « La Petite Communiste qui ne souriait jamais » (2014), « Mercy, Mary, Patty » (2016) et « Chavirer » (2020), prix du roman des étudiants France Culture – Télérama. En partenariat avec Babelio (1/3) La tempête qui s’annonce Six livres, deux albums de chansons et des spectacles, armés de convictions chevillées au corps. « Je suis féministe et ça ne me dérange pas qu'on le dise. Je préfère même anarcho-féministe, ça englobe tout ! », affirme avec joie l’autrice de « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce ». Loin de la « pauvreté du tract », ses écrits n’oublient pas d’offrir à ses lecteurs et lectrices, de plus en plus nombreux, le lyrisme du romanesque pour raconter les violences faites aux femmes, les poisons du capitalisme, le conformisme de la bourgeoisie et les luttes radicales que tout ceci impose. Il lui arrive de dédier ses romans « aux voleurs, aux étranger(e)s à tout, aux poètes roumains, aux pères inoubliables, aux mères sans passé couvertes de roses, aux enfants des morts sur les trottoirs, aux évadées, aux inrésumables, aux proclamés coupables, aux chiens affairés, aux femmes qui s’assoient en tailleur par terre même quand il y a des chaises ». Depuis la sortie en 2003 de son premier roman très énervé, toutes les « fièvres » de Lola Lafon, 46 ans, demeurent « impossibles à négocier ». Mais quelle a été l’école de cette fille de deux professeur.e.s de lettres, qui aime aussi « les plantes, les vestes de survèt’ et les paillettes », le chant bouleversant de Jeff Buckley autant que les révoltes mexicaines du sous-commandant Marcos ? Que reste-t-il, dans son regard sur le monde, de son enfance roumaine ? Quelles leçons a-t-elle tiré, pour écrire, de son apprentissage rigoureux de la danse ? De tout ceci nous parlons, dans ce premier épisode, le temps d’un pas de deux.
Enregistrements novembre 20 Entretien, découpage Richard Gaitet Prise de son, montage Sara Monimart Lectures Judith Margolin Réalisation, musique originale et mixage Samuel Hirsch Flûte basse Emma Broughton Illustration Sylvain Cabot Production ARTE Radio


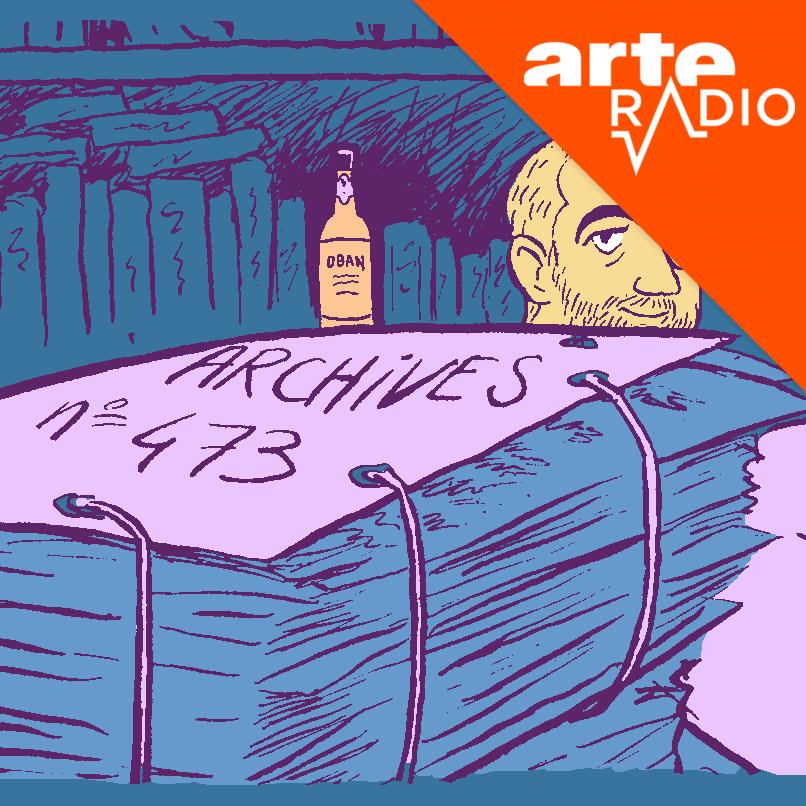
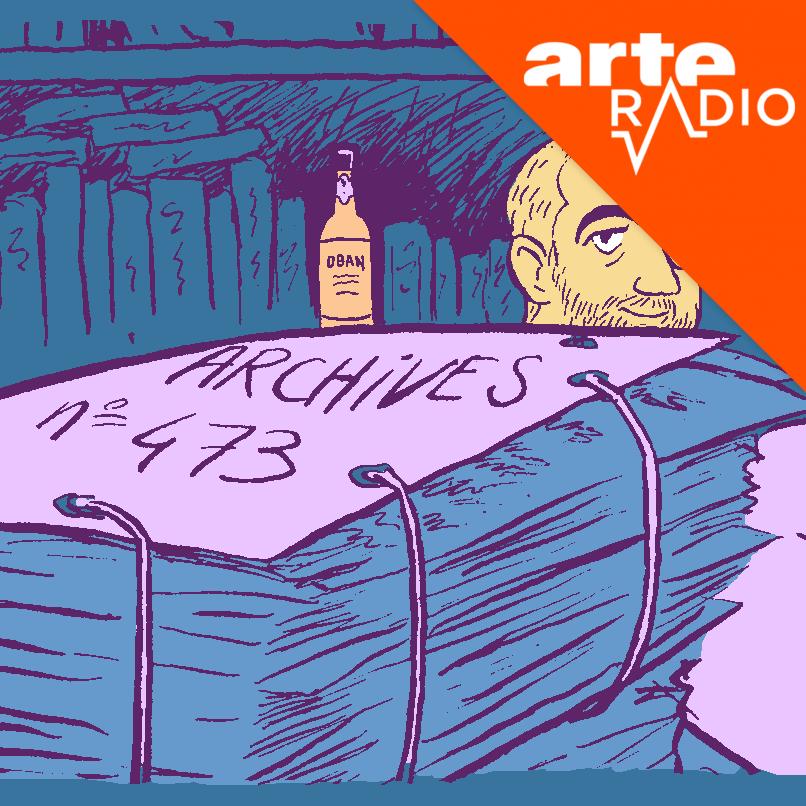
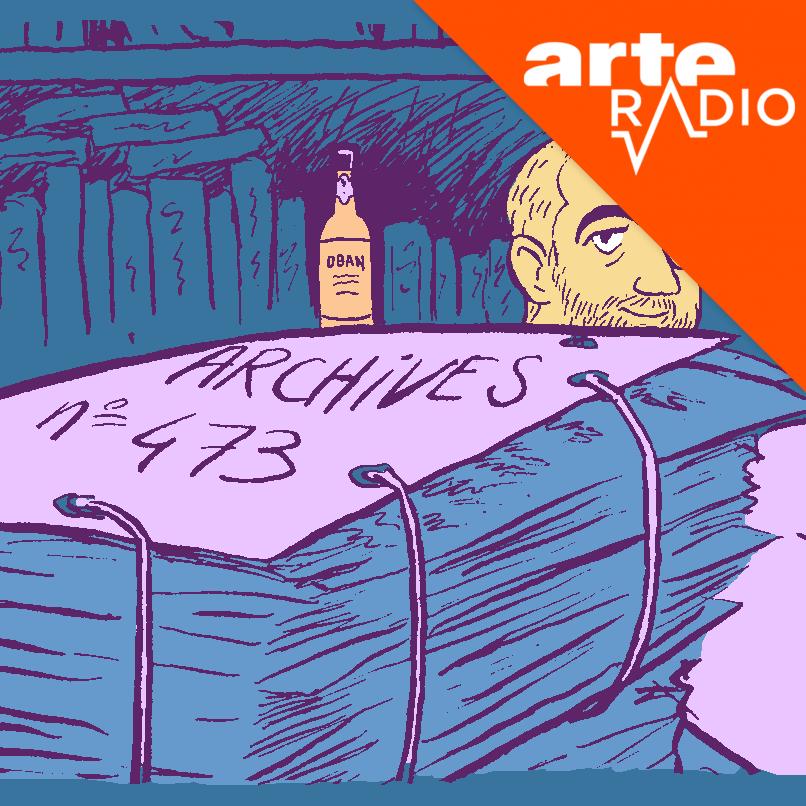












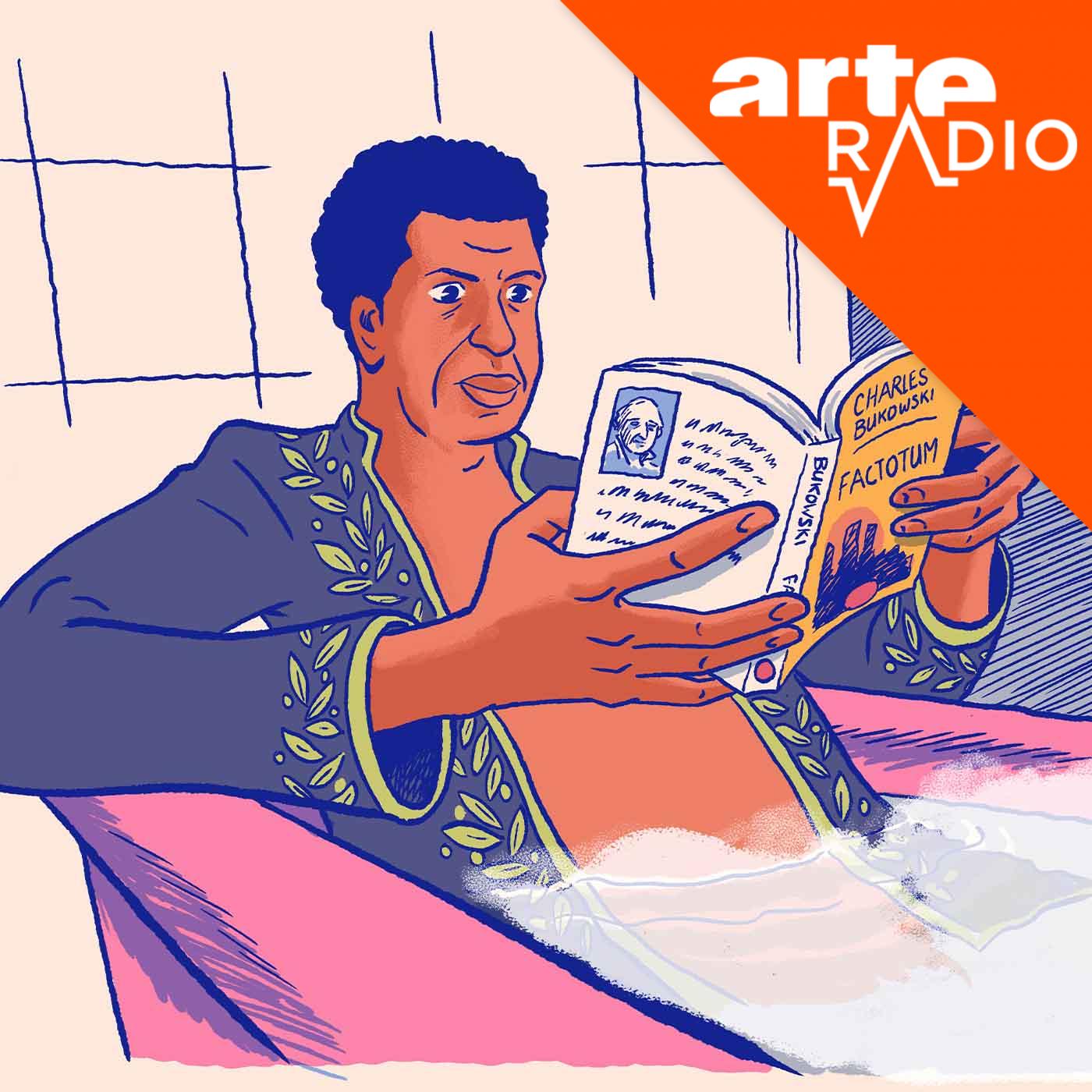





MERCIIIII pour votre travail ! un des meilleurs podcast tt genre confondu. bravo et continuer comme ça
passionnant cet interview de Le Tellier. À tout point de vue : son rapport à la littérature, à son rôle d'écrivain, à son parcours, à sa manière d'écrire. J'ai beaucoup aimé, et du coup il m'a donné envíe den lire plus (lettre à un président par exemple). Mais j'ai une petite question qui me travaille, ridicule et hors sujet par rapport à l'œuvre de cet ecrivain: il mentionne, tout à la fin de l'émission, que la rosée serait responsable des 3/4 ou 2/3 des debits des rivières. Je m'interroge , et vous et lui également, sur les sources, si je puis dire, de cette assertion. Si vous avez la réponse, je suis preneur ! En tout cas, bravo pour votre émission, je vais passer à Damasio ! Amicalement François Delclaux
Interview extraordinaire, merci!!
Absolument passionnant ! Merci d'avoir invité Tristan Garcia! Bravo pour cette interview fine et patiente, qui laisse beaucoup de temps à la réflexion.