Discover Choses à Savoir TECH
Choses à Savoir TECH

Choses à Savoir TECH
Author: Choses à Savoir
Subscribed: 1,904Played: 142,866Subscribe
Share
© Choses à Savoir
Description
Tout ce qu'il faut savoir dans le domaine de la Tech et d'Internet.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
1283 Episodes
Reverse
Meta accélère encore dans la course à l’intelligence artificielle. Après une année marquée par des investissements massifs et une chasse aux talents à grande échelle, le groupe de Mark Zuckerberg vient de frapper un nouveau coup en rachetant Manus, un agent IA dont les performances ont rapidement attiré l’attention du secteur.Présenté au printemps dernier par la start-up Butterfly, Manus s’est imposé en quelques semaines comme l’un des agents les plus avancés du moment. Capable de trier des candidatures, planifier des voyages complexes, analyser des données ou piloter des tâches numériques de bout en bout, l’outil s’est fait connaître grâce à une démonstration virale qui le plaçait au niveau, voire au-dessus, des solutions proposées par les leaders du marché. Accessible sur invitation, Manus a séduit des millions d’utilisateurs prêts à payer un abonnement mensuel.La trajectoire de Butterfly a été fulgurante. En l’espace de quelques mois, la jeune pousse, fondée à Pékin mais basée à Singapour, revendiquait plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents et une valorisation estimée à 500 millions de dollars. Des chiffres impressionnants, appuyés par des statistiques techniques spectaculaires : des dizaines de trillions de tokens traités et des millions d’environnements virtuels générés. Autant d’arguments qui ont visiblement convaincu Meta de sortir le chéquier. Le géant américain aurait déboursé plus de deux milliards de dollars pour mettre la main sur Manus. Une acquisition stratégique, alors que Meta cherche à intégrer des agents intelligents directement au cœur de Facebook, Instagram et WhatsApp. L’idée est claire : faire de l’IA un compagnon omniprésent, capable d’assister les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes, personnelles comme professionnelles.Butterfly insiste toutefois sur la continuité du service. Manus restera accessible de manière indépendante, avec ses abonnements et son équipe basée à Singapour. Pour Meta, c’est aussi l’assurance de récupérer une activité déjà rentable, à l’heure où les investissements dans l’IA pèsent lourdement sur les finances des géants du numérique. Reste un point sensible : l’origine chinoise du projet. Dans un contexte de tensions technologiques entre Washington et Pékin, l’opération pourrait susciter des interrogations politiques. Meta a d’ailleurs pris les devants, affirmant qu’après la transaction, aucun actionnaire chinois ne conservera de participation et que Manus cessera toute activité en Chine. Un signal clair : pour s’imposer dans la bataille mondiale de l’IA, Meta entend lever tous les obstacles, y compris géopolitiques. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Les signaux sont au rouge pour les prix de l’électronique grand public en 2026. Les dirigeants de Asus et Acer ont confirmé que les ordinateurs portables et de bureau verront leurs tarifs augmenter dès le début de l’année prochaine. En cause : la flambée du prix de la mémoire vive et du stockage, happés par la demande massive des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.Selon le quotidien taïwanais Commercial Times, Samson Hu, patron d’Asus, et Jason Chen, PDG d’Acer, s’accordent sur un constat partagé par l’ensemble du secteur : les hausses de coûts devront inévitablement être répercutées sur les prix de vente. Jusqu’ici, les constructeurs avaient réussi à contenir l’inflation grâce à des stocks constitués avant la pénurie. Mais cette période de répit touche à sa fin. Dès le premier trimestre 2026, les nouvelles machines intégreront des composants achetés au prix fort. Asus entend ajuster finement ses gammes, en jouant sur les configurations et le positionnement tarifaire pour rester compétitif. Acer se montre plus direct : « les prix du quatrième trimestre ne seront pas ceux du premier trimestre de l’an prochain », a prévenu Jason Chen. Pour limiter la casse, certains fabricants pourraient réduire les dotations techniques : 8 Go de RAM au lieu de 16 Go, capacités de stockage revues à la baisse. Une stratégie défensive, alors même que la pénurie touche aussi les SSD.La situation pourrait s’installer dans la durée. Les deux géants du secteur, SK Hynix et Samsung, n’envisagent pas d’augmenter significativement leurs capacités de production. Construire une usine de mémoire prend entre trois et cinq ans, un pari risqué dans un marché cyclique. Quant à Micron, le groupe a recentré ses efforts sur la mémoire à très haut débit (HBM) pour l’IA, au détriment du grand public, et prévient que la tension sur les prix pourrait durer au-delà de 2026. Résultat : les consommateurs risquent de payer plus cher des machines parfois moins bien équipées. Une ironie à l’heure où les logiciels, dopés à l’IA, deviennent toujours plus gourmands en ressources. L’informatique personnelle entre ainsi dans une phase paradoxale : plus puissante côté usages, mais plus coûteuse et plus contrainte côté matériel. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
L’intelligence artificielle est-elle réellement prête à remplacer les humains au travail ? La question agite les entreprises, entre fantasmes de productivité totale et scepticisme assumé. Pour dépasser les discours, des chercheurs de Carnegie Mellon University ont tenté une expérience originale : simuler une entreprise presque entièrement peuplée d’agents d’intelligence artificielle. Les résultats, publiés en prépublication sur arXiv, sont loin d’annoncer la fin du salariat humain. Les scientifiques ont confié le fonctionnement de cette entreprise virtuelle à des agents issus des modèles les plus en vue du moment : Claude d’Anthropic, GPT-4o d’OpenAI, Gemini de Google, Nova d’Amazon, Llama de Meta ou encore Qwen d’Alibaba. Chaque agent s’est vu attribuer un poste classique : analyste financier, chef de projet, ingénieur logiciel. En parallèle, d’autres agents jouaient le rôle de collègues ou de services internes, comme les ressources humaines.Sur le papier, tout était en place. Dans les faits, la performance est restée très limitée. Le meilleur élève, Claude 3.5 Sonnet, n’a réussi à mener à terme que 24 % des tâches confiées. En incluant les missions partiellement accomplies, son score plafonne à 34,4 %. Gemini 2.0 Flash arrive en deuxième position, avec à peine 11,4 % de tâches finalisées. Aucun autre modèle ne dépasse la barre des 10 %. Un contraste saisissant avec les promesses d’autonomie souvent associées à ces systèmes. Les chercheurs identifient plusieurs causes à ces échecs. Les agents peinent à comprendre les implicites humains : demander un fichier en « .docx » ne leur permet pas toujours de déduire qu’il s’agit d’un document Word. Ils manquent aussi de compétences sociales élémentaires et se retrouvent rapidement bloqués lorsqu’ils doivent naviguer sur le Web, gérer des fenêtres surgissantes ou interpréter des interfaces complexes. Plus préoccupant encore, certains agents estiment avoir réussi une tâche après en avoir simplement contourné les étapes difficiles.En clair, cette expérience rappelle une réalité souvent oubliée : si les IA excellent sur des tâches ciblées et bien définies, elles restent très loin de pouvoir gérer seules un environnement de travail réel, avec ses imprévus, ses règles implicites et ses interactions humaines. Le remplacement généralisé des salariés, lui, peut encore attendre. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Un pas de plus, et cette fois décisif, vers la banque à part entière. Le 15 décembre, PayPal a déposé deux demandes d’agrément auprès des autorités américaines : le département des institutions financières de l’Utah et la Federal Deposit Insurance Corporation. Objectif affiché : transformer sa filiale de crédit en banque industrielle, sous le nom de PayPal Bank. Depuis plus de dix ans, le géant californien avance déjà sur ce terrain. Depuis 2013, il a accordé plus de 30 milliards de dollars de prêts à quelque 420 000 comptes professionnels dans le monde. Une niche bien identifiée : les petites entreprises et les indépendants, souvent jugés trop risqués ou pas assez rentables par les banques traditionnelles. Avec cette licence bancaire, PayPal veut désormais se passer d’intermédiaires, prêter en direct et aller plus vite.Pour les commerçants américains, la promesse est claire : des décisions de crédit accélérées, moins de paperasse et, potentiellement, des coûts plus bas. « L’accès au capital reste l’un des principaux freins à la croissance des petites entreprises », résume Alex Chriss, le PDG du groupe. À la tête de cette future banque, PayPal a recruté Mara McNeill, ex-dirigeante de Toyota Financial Savings Bank, un profil taillé pour rassurer des régulateurs traditionnellement méfiants face aux ambitions bancaires des géants de la tech. PayPal Bank ne se contenterait pas du crédit. Des comptes d’épargne rémunérés, garantis jusqu’à 250 000 dollars par la FDIC, sont aussi au programme. Et surtout, l’entreprise veut rejoindre directement les réseaux Visa et Mastercard, afin de contrôler toute la chaîne de paiement.Cette évolution n’est pas anodine sur le plan géopolitique. En Europe, la dépendance aux infrastructures américaines inquiète. En avril dernier, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, alertait sur la domination des systèmes de paiement étrangers. Dans la foulée, seize grandes banques ont lancé Wero, un projet paneuropéen censé renforcer la souveraineté financière du continent. Pour les professionnels français, l’enjeu reste ouvert. PayPal propose déjà des prêts via des partenaires bancaires. Devenir banque à part entière lui permettrait d’accélérer encore, de réduire les coûts… et de bousculer un peu plus un secteur bancaire déjà sous pression. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le 14 décembre dernier, une attaque terroriste a endeuillé la célébration de Hanoukka à Bondi Beach, à Sydney. Quinze personnes ont perdu la vie. Mais dans les minutes qui ont suivi les coups de feu, une autre machine s’est mise en route, implacable : celle de la désinformation sur les réseaux sociaux, et en particulier sur X.Très vite, un homme d’affaires pakistanais, parfaitement innocent, s’est retrouvé projeté au centre d’un déferlement de haine. Son seul tort : porter le même nom que l’un des terroristes. Sa photo a été massivement relayée, accompagnée d’accusations infondées. Il a reçu des menaces de mort, sa famille a été harcelée. Une erreur d’identité banale, mais aux conséquences dramatiques. Et malgré l’existence des Community Notes, censées corriger les fausses informations, le mal était fait. Selon le Center for Countering Digital Hate, près de trois quarts des contenus de désinformation liés aux élections américaines de 2024 n’ont jamais été corrigés. Et lorsqu’une note apparaît, il faut parfois attendre plusieurs dizaines d’heures.Or, sur les réseaux sociaux, le temps est un luxe. Une étude du MIT montre que les fausses informations se propagent jusqu’à six fois plus vite que les vraies. Et sur X, ce phénomène est désormais encouragé par le modèle économique de la plateforme. Les créateurs sont rémunérés en fonction de l’engagement généré par leurs publications. Peu importe la véracité, seule compte la réaction. Plus ça choque, plus ça rapporte. Résultat : une vidéo de feux d’artifice de Noël, organisée de longue date par un club local, a été présentée comme des « célébrations arabes » après l’attentat. Des millions de vues avant d’être démentie. Pire encore, l’intelligence artificielle Grok, intégrée à X, a inventé de toutes pièces le nom du prétendu héros qui aurait désarmé un terroriste. Un nom fictif, issu d’un site frauduleux créé le jour même.Pendant ce temps, le véritable héros de Bondi Beach, Ahmed al-Ahmed, un Australien d’origine syrienne qui a risqué sa vie pour sauver des inconnus, est resté largement invisible dans le flot médiatique. Il a fallu du temps pour que la vérité émerge, pendant que le mensonge, lui, faisait le tour du monde. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Voici peut-être l’idée la plus simple… et la plus efficace pour démocratiser l’open source. Un projet indépendant baptisé Github Store vient de transformer GitHub en véritable magasin d’applications, à la manière d’un App Store ou d’un Google Play, mais dédié exclusivement aux logiciels libres. Disponible sur Android et sur ordinateur — Windows, macOS et Linux — Github Store propose une interface claire et familière : catégories, captures d’écran, descriptions détaillées et surtout un bouton d’installation en un clic. Fini la chasse aux fichiers au fond des dépôts ou la peur de télécharger la mauvaise archive. Ici, tout est pensé pour l’utilisateur final, pas uniquement pour les développeurs.Le fonctionnement est astucieux. L’application analyse automatiquement les dépôts GitHub publics qui publient de vraies versions installables dans leurs “releases”. Elle filtre les formats pertinents — APK, EXE, MSI, DMG, PKG, DEB, RPM — et écarte les simples archives de code source. Résultat : seules les applications réellement prêtes à être installées apparaissent dans le catalogue. L’utilisateur peut ensuite naviguer par popularité, mises à jour récentes ou nouveautés, et même filtrer par système d’exploitation pour ne voir que les logiciels compatibles avec sa machine. Chaque fiche application va plus loin que de simples captures d’écran. On y retrouve le nombre d’étoiles, de forks, les problèmes signalés, le README complet, les notes de version et le détail précis des fichiers téléchargeables. Une transparence fidèle à l’esprit open source.Côté technique, Github Store repose sur Kotlin Multiplatform et Compose. Sur Android, l’installation passe par le gestionnaire de paquets natif. Sur ordinateur, le fichier est téléchargé puis ouvert avec l’outil par défaut du système. Il est possible de se connecter avec un compte GitHub, optionnel mais utile : cela permet d’augmenter fortement les limites d’accès à l’API pour explorer sans contrainte. L’application est distribuée via les releases GitHub du projet et sur F-Droid pour Android, sous licence Apache 2.0. Autrement dit, libre, modifiable et réutilisable. Une précision importante toutefois : Github Store n’a pas vocation à garantir la sécurité des logiciels proposés. Il facilite la découverte et l’installation, mais la responsabilité reste entre les mains des développeurs… et des utilisateurs. En rendant l’open source aussi accessible qu’un store grand public, Github Store pourrait bien changer durablement la façon dont nous découvrons et utilisons les logiciels libres. Une petite révolution, sans marketing tapageur, mais avec une idée redoutablement efficace. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
C’est une affaire qui secoue tout l’écosystème des cryptomonnaies et relance un débat explosif : où s’arrête la protection de la vie privée, et où commence la complicité criminelle ? Aux États-Unis, Keonne Rodriguez, développeur du portefeuille Bitcoin Samourai Wallet, vient d’être condamné à cinq ans de prison. Son crime ? Avoir conçu et exploité un outil jugé trop efficace pour garantir l’anonymat des transactions.Lancé en 2015, Samourai Wallet se présentait comme un portefeuille Bitcoin open source destiné à préserver la confidentialité financière de ses utilisateurs. En pratique, il reposait notamment sur une technique de « coin mixing », qui consiste à mélanger les transactions de plusieurs utilisateurs afin de rendre leur traçage extrêmement difficile. Un principe défendu par de nombreux militants de la vie privée… mais perçu par les autorités comme un facilitateur de criminalité. En avril 2024, les agents du FBI interpellent Rodriguez à son domicile. Le United States Department of Justice l’accuse d’exploitation d’un service de transfert monétaire non autorisé et de blanchiment d’argent. Selon l’enquête, plus de 237 millions de dollars de fonds criminels — issus de trafics de drogue, de fraudes, de marchés du darknet ou encore de contenus pédocriminels — auraient transité par l’infrastructure Samourai.La défense, elle, plaide la neutralité technologique. Rodriguez affirme n’avoir fait qu’écrire du code, sans contrôler l’usage qui en était fait. Mais les juges ont retenu plusieurs éléments aggravants : Samourai n’était pas un simple logiciel décentralisé. L’équipe opérait des serveurs indispensables au fonctionnement du service, prélevait des commissions sur chaque opération — environ 4,5 millions de dollars au total — et certains messages publics ou documents marketing visaient explicitement des acteurs des marchés « gris » ou illégaux. C’est là que la frontière se brouille. Contrairement à des outils comme Tor ou Signal, Samourai combinait centralisation, modèle économique et communication provocatrice. Pour le tribunal, l’intention ne faisait plus de doute. Le cofondateur et directeur technique William Hill a écopé de quatre ans de prison. L’affaire pourrait toutefois rebondir : Donald Trump a récemment évoqué la possibilité d’un réexamen du dossier en vue d’une grâce présidentielle. Quoi qu’il en soit, l’affaire Samourai Wallet fera date. Elle rappelle une leçon brutale : défendre la vie privée financière est une chose. Exploiter une infrastructure centralisée, rémunérée, et assumant d’attirer des usages criminels en est une autre. Dans l’Amérique actuelle, la ligne rouge est désormais très claire. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Vous connaissez sans doute Anna’s Archive, cette bibliothèque pirate devenue incontournable pour la sauvegarde des livres et articles scientifiques du monde entier. Jusqu’ici, sa mission était claire : préserver le texte, là où la densité d’information est la plus élevée. Mais l’archive vient de franchir un cap spectaculaire : elle s’attaque désormais à la préservation de la musique en ligne, et plus précisément à Spotify.Le chantier est titanesque. Objectif affiché : sauvegarder non seulement les morceaux, mais aussi l’ensemble de leurs métadonnées. Au total, cela représente près de 300 téraoctets de données. Résultat : la plus grande base de données de métadonnées musicales jamais rendue publique, avec 186 millions de codes ISRC uniques, ces identifiants qui permettent de tracer chaque enregistrement sonore. À titre de comparaison, MusicBrainz n’en recense qu’environ cinq millions. Côté audio, Anna’s Archive affirme avoir archivé environ 86 millions de morceaux, soit près de 99,6 % des écoutes totales sur Spotify, même si cela ne couvre qu’un peu plus d’un tiers du catalogue global. Pour gérer cette masse colossale, l’équipe a fait un choix pragmatique : prioriser la popularité. Les titres écoutés au moins une fois ont été conservés en qualité originale, tandis que la longue traîne — ces millions de morceaux jamais lancés — a été compressée dans un format plus léger, voire partiellement écarté.Les statistiques issues de cette collecte sont vertigineuses. Les trois titres les plus populaires — signés Lady Gaga, Billie Eilish et Bad Bunny — cumulent à eux seuls plus d’écoutes que des dizaines de millions de morceaux obscurs réunis. Une concentration extrême qui pose un problème majeur à la conservation musicale : l’oubli quasi total de la création marginale, expérimentale ou locale. C’est là que l’approche d’Anna’s Archive tranche. Plutôt que de ne préserver que les œuvres populaires en qualité parfaite, le projet privilégie une conservation exhaustive, même dans une qualité jugée « suffisante ». Une philosophie assumée : mieux vaut tout sauver imparfaitement que ne conserver qu’un fragment idéalisé de la culture. L’ensemble est distribué via des torrents, librement duplicables. La base s’arrête à juillet 2025, mais elle inaugure quelque chose de nouveau : une archive musicale ouverte, réplicable, et collective. Une tentative, peut-être la première de cette ampleur, pour protéger le patrimoine musical mondial des aléas du temps, des conflits, des fermetures de plateformes… et de l’oubli numérique. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Il aura fallu plus de cinq ans de tensions politiques et de négociations feutrées pour que TikTok parvienne à se débarrasser de son handicap originel aux États-Unis : ses racines chinoises. Sous la menace persistante d’une interdiction pure et simple, sa maison mère, ByteDance, a finalement signé, le 18 décembre 2025, un accord décisif avec l’administration américaine. Objectif : rester sur le sol américain en se pliant aux exigences de sécurité nationale portées par Donald Trump.La solution trouvée passe par la création d’une nouvelle entité indépendante : TikTok USDS Joint Venture. Cette coentreprise américaine pilotera désormais les données, l’algorithme et la modération de la plateforme aux États-Unis. Plusieurs acteurs entrent au capital à hauteur de 15 % chacun, dont Oracle, le fonds américain Silver Lake et l’investisseur émirati MGX. ByteDance, de son côté, voit sa participation réduite à 19,9 %, tandis que 30,1 % restent entre les mains d’investisseurs historiques, parmi lesquels Fidelity et General Atlantic.Un nouveau conseil d’administration, composé de sept membres à majorité américaine, doit être mis en place. Selon une note interne consultée par l’Associated Press, sa mission est claire : « protéger les données des Américains et la sécurité nationale des États-Unis ». TikTok conservera néanmoins le contrôle de l’essentiel de ses activités commerciales sur le territoire. La transaction doit être finalisée le 22 janvier 2026, soit la veille de la date à laquelle l’interdiction de TikTok aurait dû entrer en vigueur. Sur le fond, Washington reprochait à TikTok deux points majeurs : l’hébergement potentiel des données d’utilisateurs américains hors du pays et la puissance de son algorithme, soupçonné de pouvoir servir d’outil d’influence à Pékin. Désormais, les données seront stockées localement via Oracle. TikTok reconnaît que des employés basés en Chine y ont eu accès par le passé, tout en affirmant qu’aucune information n’a jamais été transmise aux autorités chinoises.Cet accord met fin à un feuilleton entamé dès 2020, lorsque Donald Trump avait tenté, sans succès, de bannir l’application lors de son premier mandat. En 2024, le Congrès, dans un rare consensus bipartisan, avait adopté une loi signée par Joe Biden, imposant la vente ou la suspension des applications contrôlées par des adversaires étrangers. Une échéance repoussée à quatre reprises depuis janvier 2025, le temps de négocier. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
C’est un mal bien connu de tous les internautes : cette accumulation incontrôlable d’onglets ouverts, dès lors que l’on cherche des informations sur plusieurs sites à la fois. On s’y perd rapidement, et la mémoire vive de l’ordinateur fond comme neige au soleil. Pour répondre à ce problème devenu presque structurel, Google dévoile une expérimentation ambitieuse : un nouveau navigateur dopé à l’intelligence artificielle Gemini, baptisé Disco.Sa première fonctionnalité expérimentale s’appelle GenTabs. Le principe est radical : confier à l’IA la gestion du contenu de vos onglets. Plutôt que de jongler entre dix pages ouvertes, Gemini analyse l’ensemble des informations affichées et les transforme en une application web interactive, générée à la demande. Une approche qui rappelle le « vibe coding », cette manière de créer des outils à partir d’une simple intention exprimée en langage naturel.Dans les démonstrations publiées par Google, l’interface se divise en deux parties. À gauche, un chatbot Gemini classique. À droite, la fenêtre de navigation. Exemple proposé : l’organisation d’un voyage. L’utilisateur discute avec Gemini, consulte des pages d’activités locales, puis l’IA suggère de créer un outil interactif. En quelques secondes, une carte s’affiche, regroupant toutes les informations collectées, avec filtres par dates, options météo et planification d’itinéraire. Aucun code à écrire, aucune configuration technique à comprendre. Tout est généré automatiquement. Google imagine déjà d’autres usages : des outils pour visualiser des concepts scientifiques, comparer des meubles dans une pièce, créer de petits jeux, planifier ses repas ou organiser un potager. Le navigateur devient ainsi moins un lecteur de pages qu’un atelier de synthèse et d’interaction, piloté par l’IA.Pour l’instant, Disco reste une expérimentation issue de Google Labs. Basé sur Chromium, il n’est pas destiné à un usage quotidien et nécessite une inscription sur liste d’attente. Mais derrière la prouesse technique se pose une question de fond : quel avenir pour les sites web eux-mêmes ? Cette interrogation avait déjà émergé avec les résumés générés par IA dans le moteur de recherche. Si les contenus sont analysés, synthétisés et consommés par des machines plutôt que par des humains, que devient le modèle économique du web ? La publicité, aussi agaçante soit-elle, finance encore une grande partie des sites. Sans lecteurs humains, plus de clics, plus de revenus. En cherchant à résoudre le chaos des onglets, Google esquisse peut-être un futur plus fluide pour les utilisateurs… mais potentiellement bien plus fragile pour l’écosystème du web tel que nous le connaissons aujourd’hui. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
À première vue, on se demande ce qui pourrait bien freiner OpenAI. L’entreprise à l’origine de ChatGPT enchaîne les partenariats prestigieux avec les géants de la tech et séduit désormais bien au-delà de la Silicon Valley. Dernier exemple en date : Disney, qui vient de signer un accord stratégique avec OpenAI. Un partenariat qui permettra à l’outil vidéo Sora d’utiliser des personnages iconiques de la marque, de Mickey Mouse à tout l’univers Disney. Dans la foulée, le groupe américain s’est engagé à investir un milliard de dollars dans le capital d’OpenAI.Une somme impressionnante… mais qui paraît presque dérisoire au regard des finances de l’entreprise dirigée par Sam Altman. Car OpenAI dépense énormément, et même de plus en plus vite. La course à l’intelligence artificielle est devenue un champ de bataille industriel où chaque avancée technologique se paie au prix fort, en puissance de calcul, en infrastructures et en talents. Selon plusieurs estimations relayées par le média Mashable, ce milliard de dollars fraîchement injecté ne suffirait à couvrir que trois à quatre semaines des pertes actuelles d’OpenAI. Une donnée vertigineuse, qui prend encore plus de relief lorsqu’on la compare aux engagements globaux de l’entreprise : cette somme représenterait à peine un millième des dépenses prévues à moyen terme.Autrement dit, OpenAI brûle du cash à un rythme rarement vu dans l’histoire récente de la tech. Au point que certains analystes commencent à évoquer, à voix basse, un scénario longtemps jugé impensable : celui d’une fragilité financière, voire d’une faillite à long terme si le modèle économique ne se stabilise pas. Cette inquiétude intervient dans un contexte moins favorable qu’il n’y paraît. Ces derniers mois, un décrochage technologique a été observé entre ChatGPT et son principal concurrent, Gemini, développé par Google. Avec Gemini 3, le géant californien a repris une position de leader, laissant planer le doute sur la capacité d’OpenAI à conserver son avance initiale. L’histoire de la tech est riche de précédents. Être pionnier ne garantit pas le succès durable. Les plus anciens se souviennent de Netscape, premier navigateur web grand public, rapidement marginalisé par Internet Explorer à la fin des années 1990. Un rappel brutal que, dans ce secteur, l’innovation coûte cher… et que la domination n’est jamais acquise. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
L’intelligence artificielle est devenue le mot magique de la Silicon Valley. Les géants du numérique veulent l’injecter partout, parfois à marche forcée. Chez Amazon, très engagé dans cette course technologique, l’idée a été de truffer sa plateforme de streaming Prime Video de fonctionnalités dopées à l’IA. Mais l’expérience tourne, pour l’instant, au sérieux revers. Ces derniers jours, Amazon a essuyé une vague de critiques sur les réseaux sociaux. En cause : une nouvelle fonction de résumés générés par intelligence artificielle, testée en version bêta aux États-Unis. Le principe semblait séduisant : proposer, sous forme de courts clips vidéo narrés par une voix synthétique, un rappel des éléments clés de l’intrigue d’une série. Dans les faits, l’outil s’est révélé largement défaillant.La polémique a explosé autour de Fallout, l’une des séries phares de Prime Video. Les résumés produits par l’IA contenaient des erreurs factuelles, des incohérences, et parfois des éléments qui ne correspondaient tout simplement pas à l’histoire. Rapidement, les extraits ont circulé en ligne, suscitant moqueries et indignation. Face au bad buzz, Amazon n’a pas tardé à réagir. La plateforme a tout simplement désactivé la fonctionnalité, non seulement pour Fallout, mais aussi pour l’ensemble des séries concernées par le test : Tom Clancy’s Jack Ryan, The Rig, Bosch et Upload. Un retrait discret, mais révélateur d’un échec cuisant dans l’intégration de l’IA à l’expérience de streaming.Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Prime Video se retrouve dans l’embarras sur ce terrain. Plus tôt ce mois-ci, Amazon avait déjà été critiqué pour avoir proposé des doublages d’animés générés par intelligence artificielle, jugés artificiels et dénaturant les œuvres originales. Là encore, sous la pression des abonnés, ces contenus avaient été retirés. Ces ratés successifs illustrent les limites d’une stratégie qui consiste à déployer l’IA à tout prix, parfois au détriment de la qualité. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
C’est une révélation qui risque de refroidir les ardeurs des partisans du cloud « souverain ». En Allemagne, un rapport juridique commandé par le ministère de l’Intérieur, longtemps resté confidentiel, vient d’être rendu public grâce à une demande d’accès à l’information. Et son constat est sans appel : les lois américaines permettent bel et bien aux agences de renseignement des États-Unis d’accéder à des données hébergées en Europe. Pour y voir clair, Berlin avait missionné des juristes de l’Université de Cologne. Leur question était simple, mais explosive : jusqu’où s’étend réellement le pouvoir des autorités américaines sur les données stockées hors de leur territoire ? La réponse tient en quelques textes bien connus à Washington : le Stored Communications Act, renforcé par le Cloud Act, et surtout la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, prolongée par le Congrès jusqu’en 2026 au moins. Ensemble, ces lois offrent une portée extraterritoriale massive aux services américains. Le point clé est juridique, pas géographique. Peu importe que vos données soient stockées à Francfort, Dublin ou Paris. Ce qui compte, c’est qui contrôle l’infrastructure. Si la maison mère d’un fournisseur cloud est basée aux États-Unis, elle peut être contrainte de transmettre des données, même si celles-ci sont hébergées par une filiale européenne. Et la zone grise va plus loin encore : selon les experts cités par Heise Online, même certaines entreprises européennes peuvent être concernées dès lors qu’elles entretiennent des relations commerciales substantielles avec les États-Unis. On pourrait croire que le chiffrement règle le problème. Là encore, le rapport tempère. Le droit américain impose aux entreprises de préserver l’accès aux données jugées pertinentes dans le cadre d’enquêtes potentielles. Un fournisseur cloud qui se rendrait techniquement incapable d’y accéder s’exposerait à de lourdes sanctions. Résultat : un conflit frontal entre le RGPD européen, qui limite les transferts vers des pays tiers, et l’extraterritorialité revendiquée par Washington. Le Data Privacy Framework, censé servir de pont entre les deux blocs, apparaît plus fragile que jamais.Cette situation touche directement les géants américains du cloud, mais le cas de Microsoft 365, omniprésent dans les administrations et les entreprises européennes, cristallise les inquiétudes. Certains juristes estiment qu’un usage compatible avec le RGPD reste possible, à condition de mener des évaluations d’impact très poussées. D’autres jugent cette approche illusoire. Pour des acteurs comme Nextcloud, le diagnostic est clair : audits et clauses contractuelles ne suffisent plus. L’Europe doit investir massivement dans ses propres infrastructures, miser sur l’open source et développer des technologies réellement autonomes. Car une chose est désormais évidente : héberger des données en Europe ne garantit plus leur protection. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
La phrase a résonné comme un coup de tonnerre dans le monde de la tech. Mustafa Suleyman, responsable de l’intelligence artificielle grand public chez Microsoft, a affirmé que le groupe pourrait tout simplement renoncer à certains développements si l’IA devenait incontrôlable. Un propos rare dans un secteur davantage habitué aux promesses d’omnipotence qu’aux appels à la retenue.Cette prise de position tranche avec l’euphorie ambiante de la Silicon Valley. Tandis que nombre d’acteurs poursuivent à marche forcée le Graal de l’« intelligence artificielle générale », Microsoft se présente en gardien prudent, prêt à activer un bouton d’arrêt d’urgence. Pour Mustafa Suleyman, la ligne est claire : l’entreprise ne développera pas de systèmes qu’elle ne peut pas maîtriser. L’ambition affichée est celle d’une « superintelligence humaniste », conçue pour assister l’humain, et non pour le remplacer. Copilot, l’assistant intégré aux outils de Microsoft, serait la première illustration de cette vision. Mais ce discours soulève un paradoxe. Microsoft est aussi l’un des principaux investisseurs mondiaux dans l’IA, avec des dizaines de milliards de dollars engagés dans ses infrastructures et dans son partenariat stratégique avec OpenAI. Une posture d’équilibriste, entre accélération technologique maximale et promesse de retenue éthique. Appuyer sur l’accélérateur tout en affirmant garder le pied sur le frein.Cette prudence affichée éclaire aussi les relations, parfois ambiguës, entre Microsoft et OpenAI. Là où OpenAI revendique ouvertement l’objectif de créer une intelligence artificielle générale, Microsoft temporise. Son PDG, Satya Nadella, a récemment qualifié ce concept de « légèrement survendu », préférant mettre en avant des usages concrets et immédiatement utiles. Reste à savoir si cette ligne rouge est réellement infranchissable ou si elle relève d’une stratégie de communication destinée à rassurer le public et les régulateurs. Car dans le même temps, Microsoft a renégocié son partenariat avec OpenAI afin de pouvoir développer ses propres modèles d’IA, en toute autonomie. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sur le papier, l’application française Wizz promet une expérience sociale encadrée et sécurisée. Dans les faits, le constat est bien plus inquiétant. Son fonctionnement repose sur le swipe, comme Tinder ou Bumble. Pourtant, Wizz assure ne pas être une application de rencontres et met en avant un système de vérification d’âge par intelligence artificielle, censé séparer strictement les utilisateurs par tranche d’âge. Une barrière qui, selon plusieurs enquêtes, ne tiendrait pas. Les faits divers s’accumulent. À Hawaï, une fillette de 11 ans a été agressée par un militaire de 19 ans qui se faisait passer pour un adolescent de 15 ans sur l’application. D’autres affaires décrivent des scénarios similaires : un homme de 23 ans prétendant avoir 14 ans, ou encore un individu de 27 ans se présentant comme mineur pour approcher et agresser plusieurs adolescentes. Dans tous les cas, le point commun est le même : une vérification d’âge défaillante.Le magazine américain The Hill a voulu tester ce système. Un journaliste de 28 ans s’inscrit sur Wizz. Verdict : l’algorithme d’IA valide son profil comme celui d’un adolescent de 16 ans, sans alerte. Les « algorithmes sophistiqués de sécurité » mis en avant par l’entreprise apparaissent alors comme un simple argument marketing. Déjà épinglée par les médias, l’application avait été retirée temporairement des boutiques d’Apple et de Google, avant de revenir avec la promesse d’améliorations. Manifestement, sans effet concret. Ce débat s’inscrit dans un contexte plus large. Aux États-Unis, le Kids Online Safety Act, soutenu aussi bien par des élus démocrates que républicains, vise à imposer aux plateformes un véritable devoir de protection. Le principe est simple : comme dans l’automobile ou l’agroalimentaire, une entreprise ne pourrait plus lancer un service sans démontrer qu’il est sûr pour ses utilisateurs, notamment les mineurs.L’industrie technologique reste aujourd’hui l’une des rares à échapper à ce type d’obligation. Avec une loi comme le KOSA, les plateformes devraient prouver l’efficacité réelle de leurs dispositifs de sécurité, sous peine de poursuites judiciaires. Les promesses ne suffiraient plus. Si ce texte doit encore franchir plusieurs étapes au Congrès américain, il envoie déjà un signal clair. Pour des applications comme Wizz, l’ère de l’auto-déclaration et des garde-fous symboliques touche peut-être à sa fin. Protéger les mineurs ne peut plus relever du discours. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
L’intelligence artificielle est déjà partout dans notre quotidien professionnel. Depuis plus d’un an, Google a intégré son IA Gemini dans la suite Google Workspace : résumés automatiques dans Gmail, rédaction de documents dans Drive, prise de notes dans Meet… Mais avec l’arrivée de l’IA dite « agentique », le géant de la tech passe à l’étape suivante.Google vient d’annoncer le lancement de Google Workspace Studio, un nouvel outil destiné aux professionnels. Promesse affichée : permettre de créer, en quelques minutes, de véritables agents IA capables d’automatiser les tâches du quotidien, sans écrire une seule ligne de code. Il suffit d’expliquer, en langage naturel, ce que l’on souhaite faire. L’agent se charge du reste, grâce à la puissance de Gemini 3. Ces agents ne se contentent pas d’exécuter des consignes figées. Ils sont conçus pour analyser des situations, s’adapter à de nouvelles informations et déclencher des actions en fonction du contexte. Concrètement, ils peuvent surveiller vos mails, détecter des mots-clés, envoyer automatiquement des alertes, préparer des briefings, ou encore organiser des tâches à partir de contenus présents dans vos documents. Ils peuvent aussi aller chercher des informations sur le web pour ajuster leur comportement.Autre point clé : l’ouverture aux outils tiers. Google Workspace Studio peut se connecter à des applications professionnelles majeures comme Jira, Salesforce, Mailchimp ou Asana. Les agents peuvent ainsi automatiser des chaînes complètes de travail, de la gestion de projet au suivi client. Ils sont aussi partageables entre collaborateurs, avec des modèles prêts à l’emploi pour accélérer la prise en main. Google voit déjà plus loin. Des évolutions sont annoncées, notamment le partage externe, l’envoi d’e-mails hors du domaine principal, ainsi qu’une prise en charge avancée des webhooks, ces mécanismes qui permettent aux applications de dialoguer entre elles en temps réel. Le déploiement a commencé cette semaine. L’accès pour les utilisateurs finaux est prévu à partir du 5 janvier 2026, pour les domaines à activation progressive. L’outil reste réservé aux abonnements payants Business, Enterprise, Education et aux offres Google AI dédiées. Les mineurs, eux, n’y auront pas accès. Derrière cette annonce, un signal clair : Google ne veut plus seulement proposer de l’assistance par IA, mais confier aux entreprises de véritables agents numériques autonomes. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
C’est une annonce qui fait l’effet d’un séisme dans le monde du web. Matthew Prince, le patron de Cloudflare, révèle que son entreprise a bloqué 416 milliards de requêtes de robots d’intelligence artificielle depuis juillet. Un chiffre vertigineux, qui confirme une tendance que beaucoup pressentaient : Internet n’est plus majoritairement parcouru par des humains, mais par des machines.Les données du rapport 2025 d’Imperva enfoncent le clou : les bots représentent désormais 51 % du trafic mondial, contre seulement 27 % il y a dix ans. Une bascule spectaculaire, portée par la frénésie des géants de l’IA — OpenAI, Anthropic, Google et consorts — dont les modèles doivent avaler toujours plus de données pour s’améliorer. Résultat : leurs robots arpentent le web en long, en large et en travers. GPTBot, l’aspirateur d’OpenAI, a triplé sa présence en un an. ClaudeBot, son équivalent chez Anthropic, suit le même rythme. Ces bots vont plus loin que les anciens robots d’indexation : ils réclament 2,5 fois plus de données par requête que le crawler de Google. Et le plus croustillant, c’est qu’ils ne renvoient quasiment aucun visiteur vers les sites qu’ils exploitent. Cloudflare a mesuré un ratio édifiant : 70 900 visites de ClaudeBot pour 1 visiteur humain généré. OpenAI fait un peu mieux… mais reste entre 250 et 1 217 pour un.Cette marée robotique a un coût. Le projet open source Read the Docs a vu sa consommation de bande passante chuter de 75 % en bloquant les bots IA — de 800 à 200 Go par jour — générant 1 500 dollars d’économies mensuelles. Multipliez cela par des milliers de sites : la facture globale devient gigantesque. Face à cette extraction massive de contenus, des pistes émergent : faire payer les visites des robots d’IA, ou rémunérer les créateurs dont les contenus alimentent les réponses générées. Reste à convaincre les géants du secteur. En attendant, Cloudflare a tranché : depuis juillet, tous les bots IA sont bloqués par défaut sur les sites qu’il protège. Un geste symbolique — l’entreprise ne couvre qu’environ 20 % du web — mais un signal fort. Les créateurs de contenus ne sont peut-être pas encore dépossédés. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pour la dernière grande journée de son événement annuel AWS re:Invent, Amazon Web Services a levé le voile sur une annonce stratégique : l’arrivée de Graviton5, son tout nouveau processeur maison. Une puce ARM de cinquième génération, gravée en 3 nanomètres, embarquant… 192 cœurs. Un monstre de calcul, pensé pour bouleverser l’équation performance-prix du cloud.AWS ne s’en cache pas : le pari Graviton est déjà un succès. Plus de la moitié des nouvelles capacités de calcul de la plateforme reposent désormais sur cette architecture, et près de 90 % des 1 000 plus gros clients EC2 utilisent déjà ces processeurs. Avec Graviton5, Amazon ne se contente plus d’optimiser : il change d’échelle. Cette nouvelle génération marque un véritable saut technologique. En concentrant 192 cœurs sur une seule puce, Amazon augmente considérablement la densité de calcul. Résultat : les échanges entre cœurs sont 33 % plus rapides. Le cache L3, cette mémoire ultra-rapide essentielle aux performances, a été multiplié par cinq. Chaque cœur dispose ainsi de 2,6 fois plus d’espace immédiat que sur Graviton4. Concrètement, cela accélère fortement les bases de données, l’analyse de données massives, mais aussi les jeux en ligne ou les services temps réel.Côté réseau, les progrès sont tout aussi notables : +15 % de bande passante en moyenne, jusqu’à un doublement sur les instances les plus puissantes. L’accès au stockage cloud progresse aussi de 20 %. Graviton5 promet au total 30 % de performances supplémentaires et 20 % de latence en moins par rapport à la génération précédente. La gravure en 3 nm, l’une des plus avancées du marché — dominée par TSMC, Samsung et Intel — permet d’augmenter la puissance tout en réduisant la consommation. Un point crucial à l’heure où les data centers pèsent de plus en plus lourd dans la consommation électrique mondiale. AWS va même jusqu’à refroidir directement la puce, sans boîtier intermédiaire.Autre avancée majeure : la sécurité. Avec le Nitro Isolation Engine, AWS ne se contente plus d’affirmer l’isolation des données… il en apporte une preuve mathématique. Une garantie très recherchée par les banques, les hôpitaux et les administrations. Les premiers retours sont enthousiastes. Airbnb gagne 25 % sur ses moteurs de recherche. Atlassian observe 30 % de rapidité en plus sur Jira. SAP annonce même jusqu’à 60 % d’accélération sur ses bases de données. Les premières instances EC2 M9g sont déjà disponibles en test. Les déclinaisons C9g et R9g, dédiées au calcul intensif et à la mémoire, arriveront en 2026. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
C’est une plainte devenue quasi quotidienne chez les joueurs comme chez les télétravailleurs : Discord consomme de plus en plus de mémoire vive. La plateforme de chat vocal et textuel confirme aujourd’hui ce que beaucoup constataient déjà : lorsque plusieurs serveurs sont ouverts, l’application peut dépasser les 4 gigaoctets de RAM, au point de ralentir sérieusement Windows 11 et les jeux lancés en parallèle.Face à la grogne, Discord teste désormais une solution radicale : surveiller sa propre consommation de mémoire… et se relancer automatiquement lorsqu’elle dépasse un seuil critique. L’objectif est simple : libérer de la RAM pour éviter que la machine ne suffoque. Une mesure présentée comme un garde-fou, mais qui révèle surtout l’ampleur du problème. Cette gourmandise n’est pas qu’une question d’usage intensif. Discord repose sur le framework Electron, qui embarque en réalité un navigateur complet basé sur Chromium. Autrement dit, chaque fenêtre de discussion fonctionne comme une page web à part entière, avec son moteur JavaScript, ses composants, ses modules. Dans des conditions dites « normales », l’application flirte déjà avec le gigaoctet de mémoire. Et après plusieurs heures d’utilisation, entre appels vocaux, partages d’écran et navigation frénétique, la consommation peut exploser.Les développeurs reconnaissent d’ailleurs l’existence de fuites de mémoire. Neuf ont été corrigées ces derniers mois, permettant une réduction d’environ 5 % pour les profils les plus gourmands. Un progrès, certes, mais encore loin de transformer Discord en logiciel léger. D’où cette nouvelle expérimentation : si l’application dépasse 4 Go de RAM, qu’elle tourne depuis plus d’une heure, que l’utilisateur est inactif depuis trente minutes et qu’aucun appel n’est en cours, alors Discord se ferme… puis redémarre automatiquement. L’opération ne peut se produire qu’une fois toutes les 24 heures pour éviter les interruptions en boucle.Sur le papier, la mécanique est rassurante. Dans la pratique, elle ressemble surtout à un pansement posé sur une architecture lourde. Et Discord est loin d’être un cas isolé. D’autres applications comme Microsoft Teams ou la nouvelle version de WhatsApp pour Windows affichent elles aussi des consommations démesurées. Le problème devient d’autant plus sensible que le prix de la mémoire vive remonte. Tout le monde ne peut pas se permettre d’ajouter 16 Go de RAM pour suivre la course aux logiciels XXL. Entre applications toujours plus lourdes et matériel plus cher, les configurations modestes plient rapidement. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
C’est une annonce qui a fait trembler Hollywood : Netflix a proposé un chèque de 83 milliards de dollars pour s’offrir Warner Bros., ses studios de cinéma, de télévision, de jeux vidéo… et surtout sa plateforme de streaming, HBO Max. Une opération titanesque, présentée comme historique. Mais attention : à ce stade, rien n’est encore acté. Le processus pourrait s’étendre jusqu’à fin 2026, et le chemin s’annonce semé d’embûches réglementaires et politiques.Car cette acquisition devrait être passée au crible par les autorités de la concurrence dans le monde entier. En clair, Netflix devra démontrer que l’absorption de Warner et de son catalogue — de Game of Thrones à l’univers DC, en passant par Harry Potter — ne portera pas atteinte à la concurrence ni aux consommateurs. Officiellement, la plateforme le répète : « rien ne change pour l’instant ». Mais en coulisses, les tensions sont déjà très fortes. Le groupe Paramount-Skydance, candidat malheureux au rachat, conteste ouvertement le processus. Son patron, David Ellison, fils du fondateur d’Oracle, espérait l’emporter grâce à ses relations politiques, notamment avec Donald Trump. Quelques heures avant l’annonce de Netflix, Paramount dénonçait publiquement une vente « opaque et injuste ».Donald Trump, justement, est entré directement dans le jeu. Le 7 décembre 2025, sur Truth Social, il a déclaré vouloir examiner de près cette opération, évoquant un risque de « part de marché excessive ». S’il ne peut pas bloquer seul le dossier, il pèse lourdement sur la FTC, dont il a placé un proche à la tête. Le patron de Netflix, Ted Sarandos, a bien tenté d’apaiser les tensions en rencontrant Donald Trump avant l’annonce. Sans succès visible. Pire encore, selon plusieurs médias américains, Paramount-Skydance pourrait préparer une OPA hostile pour reprendre Warner à coup de surenchère boursière.Et les obstacles ne s’arrêtent pas aux États-Unis. Les régulateurs européens et britanniques, réputés plus stricts, pourraient à leur tour freiner le dossier. Le syndicat des acteurs SAG-AFTRA s’y oppose déjà, inquiet pour l’avenir du cinéma en salles. Même dans le scénario le plus optimiste, la transaction ne serait pas finalisée avant la seconde moitié de 2026. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.



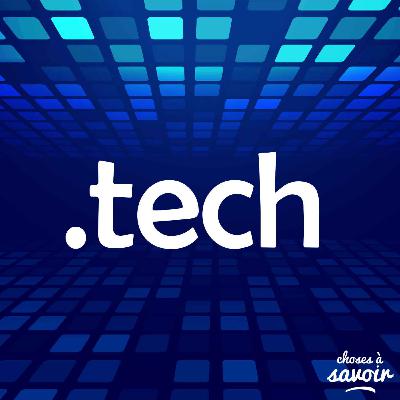


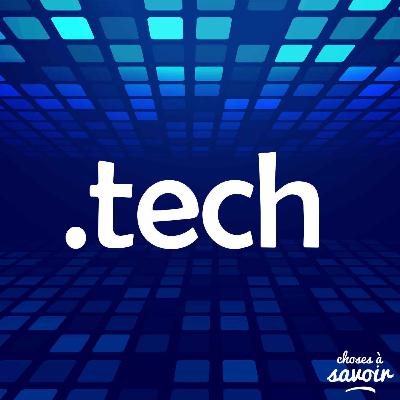
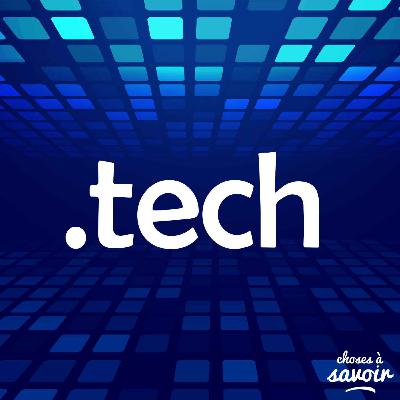





ça me dépite de ce genre de langage.... un podcast reste un podcast, une vidéo reste une vidéo.... 🤦♀️ mais un podcast vidéo... on se demande bien où va nous mener la langue française si ça continue de s'aggraver.
Pas grand chose sur Deepseek qui fait des vagues avec son prix, performance, fonctionnalités etc. et le reste de laa concurrence en Chine
énorme erreur ! c'est la première fois où les différences entre le pro et pro max ne sont pas que la taille d'écran et la taille de la batterie, même le système des capteurs photos est différent. je suis déçu ! pour un podcast spécialisé, c'était la chose qu'il fallait retenir (et le fait qu'ils soient tous compatibles 5G)