Discover Collège de France - Sélection
Collège de France - Sélection
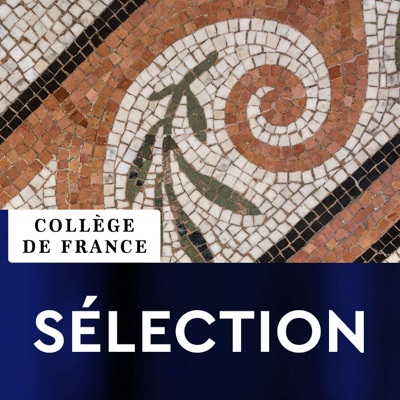
509 Episodes
Reverse
Pascale SenellartChaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt (2025-2026)Collège de FranceAnnée 2025-2026Leçon inaugurale - Pascale Senellart : Les débuts d'une seconde révolution quantiqueRésuméLa mécanique quantique a été le moteur des grandes révolutions technologiques de la seconde moitié du XXe siècle, au cœur, entre autres du transistor, du laser ou des systèmes de navigation. Ces innovations n'ont pourtant pas exploité les concepts les plus subtils, ceux qui ont tant fait débat parmi les fondateurs de la mécanique quantique : la superposition quantique et l'intrication. Ces concepts, qui contrarient encore aujourd'hui nos intuitions, ouvrent la voie à de nouvelles façons d'encoder et de manipuler l'information. Les observer et les exploiter requiert toutefois un degré de contrôle inédit des systèmes physiques.Les dernières décennies de recherche en physique quantique, appliquées à des systèmes très variés, allant de la lumière aux composants semi-conducteurs et supraconducteurs, en passant par les atomes, ont progressivement permis de manipuler des systèmes quantiques élémentaires très « purs », et de mettre en évidence, puis de maîtriser la superposition quantique et l'intrication. Il est aujourd'hui possible de générer la lumière photon par photon, de synthétiser de la matière artificielle atome par atome, de sculpter des atomes artificiels avec les outils de la microélectronique, d'intriquer photons et atomes naturels ou artificiels.Ces avancées scientifiques permettent aujourd'hui de développer les premières applications exploitant l'intrication et la superposition. Il s'agit notamment de développer des processeurs quantiques permettant de réaliser des calculs inaccessibles aux supercalculateurs actuels, de mettre en œuvre des protocoles de communication sécurisés par les lois fondamentales de la mécanique quantique ou encore de développer des capteurs de sensibilité ultime, facilitant par exemple la détection d'ondes gravitationnelles. Les applications sont nombreuses, couvrent des domaines liés à la souveraineté numérique, mais promettent également de nouvelles découvertes scientifiques.Nous nous efforcerons de décrire les débuts de cette aventure, où recherche fondamentale et développements technologiques avancent résolument de concert. C'est un domaine en plein essor au niveau international, où une certaine poésie et esthétique se mêlent au quotidien à des ambitions scientifiques extrêmes et à une concurrence intense, à la mesure des enjeux.Les enseignements de Pascale Senellart ont lieu dans le cadre de l'Année internationale des sciences et technologies quantiques qui marque, en 2025, les 100 ans de la découverte de la physique quantique.
Maria MelchiorSanté Publique (2025-2026)Collège de FranceAnnée 2025-2026Leçon inaugurale - Maria Melchior : Santé mentale et addictions : de l'intime au populationnelRésuméLa santé mentale et les addictions sont des concepts larges qui recouvrent des symptômes et expériences hétérogènes, plus ou moins sévères et durables, dont les facteurs de risque et de protection sont multiples et les conséquences sur divers chapitres de la vie des personnes – études, travail, vie familiale – possiblement importantes. Chaque situation est spécifique et subjective, comme c'est aussi le cas dans le domaine de la santé physique, la particularité de la santé mentale étant peut-être l'absence de mesures biologiques permettant d'identifier de manière objective des variations d'humeur, des niveaux de dépendance à un produit ou à un comportement, ou encore le degré de souffrance psychique. La recherche, se basant nécessairement sur la parole du sujet, est donc confrontée à la difficulté d'harmoniser et de standardiser des ressentis intimes. Quels enjeux de la recherche sur la santé mentale dans une population ? La définition de l'objet étudié est bien sûr une étape essentielle et préalable au questionnement sur les facteurs qui y sont associés, et la première question abordée sera celle des classifications des troubles psychiques et des addictions utilisées aujourd'hui. Que nous disent-elles, en creux, de ce que l'on considère comme un comportement « normal » ? Ensuite, le cours abordera différents types de facteurs qui, à l'échelle d'un collectif, prédisent la survenue, la sévérité, la persistance des problèmes de santé mentale et des addictions tout au long de la vie : antécédents familiaux de troubles psychiques et d'addiction, vécu de situations de violences – intimes ou collectives, ruptures et exils – voulus ou non, conditions d'existence et liens aux autres. L'ensemble des enseignements aborderont les inégalités sociales face à la santé mentale, ainsi que la question de la prévention des troubles psychiques et des addictions à l'échelle sociétale.
Grand événement - Musique ! La Philharmonie au Collège de FranceCycle de rencontres en partenariat avec la Cité de la musique – Philharmonie de ParisCollège de FranceAnnée 2025-2026Composer aujourd'huiThierry EscaichOrganiste et compositeurChloë CambrelingJournalisteMasterclasse de Thierry Escaich, organiste et compositeur.Modératrice : Chloë CambrelingRésuméLe compositeur Thierry Escaich, cotitulaire de l'orgue de Notre-Dame de Paris, est chargé de composer le Te Deum créé en juin 2025. Ses œuvres sont régulièrement jouées, parfois créées, à la Philharmonie de Paris, où il se produit également en tant qu'organiste. Cette conférence-masterclasse au piano présentera les enjeux contemporains du travail de composition : la création d'œuvres nouvelles aux formats divers étant l'une des missions de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris.
Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-2026David NesvornýConférence - David Nesvorný : Formation of Equal-Size Binaries in the Kuiper BeltDavid NesvornýSouthwest Research Institute, USARésuméA critical step in the emergence of planets within a protoplanetary disk is the accretion of planetesimals - bodies ranging from 1 to 1,000 kilometers in size - formed from smaller solid constituents. However, this process remains poorly understood, largely due to limited observational constraints on the complex physical mechanisms involved in planetesimal formation. In the outer Solar System, the best place to look for clues is the Kuiper belt, where a population of icy planetesimals survived to this day. We present evidence that Kuiper Belt planetesimals formed via the streaming instability, a process in which aerodynamically concentrated clumps of pebbles undergo gravitational collapse to form 100-kilometer-class bodies. This mechanism explains the high prevalence of equal-sized binaries observed in the Kuiper Belt. The model predicts a broad inclination distribution and a predominance of prograde binary orbits, consistent with observations of trans-Neptunian binaries. Given its robustness across a wide range of protoplanetary disk conditions, the streaming instability is likely to have played a central role in seeding planetesimal formation throughout the Solar System and in other planetary systems as well.
Hugues de ThéCollège de FranceOncologie cellulaire et moléculaireAnnée 2025-2026Hematopoietic Stem Cell Aging and Adaptation to StressConférence - Emmanuelle Passegué : Adaptive and Maladaptive Myeloid Cell ProductionEmmanuelle PasseguéDirectrice de la Columbia Stem Cell Initiative et professeure émérite de génétique et de développement à l'université ColumbiaRésuméAlthough young adult HSCs employ finely tuned mechanisms to balance pro-survival and stress responses, these maintenance strategies provoke vulnerabilities that manifest with continued age, leading to a decline in function. We will examine HSC biology through the lens of antagonistic pleiotropy, whereby the same mechanisms that are important for reproductive fitness form the basis for functional decline during aging. We will particularly highlight the central role of cell cycle regulation, niche cell reliance, inflammatory responses, cellular memory, and distinct metabolic regulation in driving HSC aging features, including expansion of the HSC pool, decreased self-renewal ability, myeloid-biased differentiation, and genomic instability leading to clonal hematopoiesis (CH) and leukemic transformation.
Hugues de ThéCollège de FranceOncologie cellulaire et moléculaireAnnée 2025-2026Hematopoietic Stem Cell through the Ages: A Lifetime of Adaptation to Organismal DemandsConférence - Emmanuelle Passegué : Adaptive and Maladaptive Myeloid Cell ProductionEmmanuelle PasseguéDirectrice de la Columbia Stem Cell Initiative et professeure émérite de génétique et de développement à l'université ColumbiaRésuméAlthough highly regulated to maintain stable output of blood cells in health, the hematopoietic system is capable of extensive remodeling in response to external challenges, prioritizing production of certain blood cell types at the expense of others. We will consider how acute insults, such as infections and myeloablation, cause molecular, cellular, and metabolic changes in hematopoietic stem and progenitor cells at multiple levels of the hematopoietic hierarchy to drive accelerated production of mature myeloid cells needed to resolve the initiating insult. Moreover, we will discuss how dysregulation or subversion of these emergency myelopoiesis mechanisms contributes to the progression of chronic inflammatory diseases and solid cancer.
Hugues de ThéCollège de FranceOncologie cellulaire et moléculaireAnnée 2025-2026Hematopoietic Stem Cell through the Ages: A Lifetime of Adaptation to Organismal DemandsConférence - Emmanuelle Passegué : Environmental Crosstalk and Bone Marrow Niche RegulationEmmanuelle PasseguéDirectrice de la Columbia Stem Cell Initiative et professeure émérite de génétique et de développement à l'université ColumbiaRésuméIn adult mammals, HSCs reside in the bone marrow (BM) cavity near diverse groups of stromal cells, which maintain the structural integrity of both bone and marrow microenvironments. Interactions among stromal cells and hematopoietic stem and progenitor cells modulate many of the critical functions of the hematopoietic system, including production of specific blood lineages and responses to infection and inflammation. Our understanding of these interactions has grown considerably with application of new technologies that have uncovered how cell populations associate in situ and exchange molecular signals. We will describe important architectural features of the BM cavity and its cellular composition and explore the central role of mesenchymal stromal cells (MSC) as organizers of hematopoietic niches.
Grand événement - Cycle EuropeNégocier sans y croire : les défis des relations Europe-AfriqueCollège de FranceAnnée 2025-2026Le boom démographique de l'Afrique est-il problématique ?Carlos LopesProfesseur d'économie politique, Nelson Mandela School of Public GovernanceRésuméAu cours des trois dernières années, les négociations dans le cadre des processus parallèles des accords post-Cotonou et des accords conclus entre l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA), initiés à la suite du sommet d'Abidjan de l'UA-UE en novembre 2017, ont adopté une tonalité cynique et peu productive. Alors que l'objectif initial était d'assurer une préparation plus solide pour l'engagement de l'Afrique avec l'UE et de rééquilibrer leur relation, la constante démonstration d'attitudes passives-agressives par l'UE, évitant la communication directe avec des interlocuteurs africains plus exigeants tout en manifestant son soutien envers des partenaires plus conciliants, a terni le paysage des négociations. Cette tendance conforte l'idée selon laquelle on n'obtient pas ce qui est juste, mais plutôt ce qui est négocié avec diligence, mettant en lumière la nature peu productive de ces interactions, qui finalement n'ont que peu de résultats tangibles.
Grand événement - Cycle EuropeNégocier sans y croire : les défis des relations Europe-AfriqueCollège de FranceAnnée 2025-2026Le boom démographique de l'Afrique est-il problématique ?Carlos LopesProfesseur d'économie politique, Nelson Mandela School of Public GovernanceRésuméLes transitions démographiques sont souvent attribuées à la réduction de la fertilité, provoquée par des évolutions significatives dans plusieurs domaines. À cet égard, les gains de santé en Afrique devraient être davantage reconnus comme moteur de sa croissance démographique. Le fait que l'Afrique rajeunit pendant que le reste du monde vieillit à grande vitesse est un élément déconcertant. Ces deux aspects font partie d'un ensemble de considérations qui faussent les perceptions sur la réalité de l'évolution démographique récente du continent et qui méritent des analyses plus fines. Cette conférence montrera que la vision néo-malthusienne de la croissance démographique de l'Afrique est simpliste, bien qu'elle soit utilisée pour stigmatiser les dangers de flux migratoires.
Hugues de ThéCollège de FranceOncologie cellulaire et moléculaireAnnée 2025-2026Hematopoietic Stem Cell through the Ages: A Lifetime of Adaptation to Organismal DemandsConférence - Emmanuelle Passegué : Principle of Hematopoietic Stem Cell Biology and Blood ProductionEmmanuelle PasseguéDirectrice de la Columbia Stem Cell Initiative et professeure émérite de génétique et de développement à l'université ColumbiaRésuméUnlike most adult organs, the blood system regenerates continuously to maintain homeostasis in a life-long process orchestrated by a complex collection of hematopoietic stem and progenitor cells. Self-renewing HSCs reside at the apex of this hierarchy and produce all blood lineages, including the erythroid lineage that forms red blood cells, the megakaryocytic lineage that gives rise to platelets, and the myeloid and lymphoid lineages that generate cells of the innate and adaptive immune systems. Most HSCs exist in a quiescent state, dividing occasionally to self-renew and produce various lineage-biased multipotent progenitors that form a transit amplifying compartment sustaining the daily output of the blood system. We will consider how emerging concepts in cell differentiation and lineage priming are developing our understanding of the hematopoietic hierarchy and its functional attributes.
Grand événement - Cycle EuropeNégocier sans y croire : les défis des relations Europe-AfriqueCollège de FranceAnnée 2025-2026Les effets pervers de l'aide au développementCarlos LopesProfesseur d'économie politique, Nelson Mandela School of Public GovernanceRésuméLa conférence explorera les débats persistants autour de l'aide étrangère, révélant comment divers outils tels que les programmes d'ajustement structurel, les discussions sur l'efficacité de l'aide, la conditionnalité macroéconomique et les perceptions du risque par les agences de notation renforcent tous la logique axée sur l'aide. Cette logique se retrouve dans des initiatives telles que les conventions de Cotonou et de Lomé, ainsi que les nombreux accords de l'UE avec les pays d'Afrique du Nord, sous-tendus par la notion de charité. En effet, les acteurs africains et européens ont tendance à se concentrer sur l'accomplissement des obligations économiques extérieures des pays africains comme mesure de succès, au lieu de plaider en faveur de changements profonds au sein de ces pays, ce qui contraste nettement avec les approches adoptées dans d'autres régions, notamment en Asie. La conférence mettra en avant le fait que la fin de l'ère des programmes d'ajustement structurel a offert une fenêtre d'opportunité pour s'éloigner de cette perspective fondée sur la charité, mais que, malheureusement, ce changement a été de courte durée. Elle explorera les raisons de cette opportunité manquée, éclairant les facteurs qui ont contribué à ce résultat.
Grand événement - Cycle EuropeNégocier sans y croire : les défis des relations Europe-AfriqueCollège de FranceAnnée 2025-2026La décolonisation mentale tarde à venirCarlos LopesProfesseur d'économie politique, Nelson Mandela School of Public GovernanceRésuméLes mentalités et les récits postcoloniaux, fortement influencés par des idées telles que la nécessité de décoloniser les esprits, révèlent une empreinte profonde de l'héritage colonial dans l'imaginaire collectif. L'analyse des raisons historiques sous-tendant la persistance de la stigmatisation de l'Afrique confirme la complexité de la situation. Des penseurs comme Frantz Fanon et Amilcar Cabral ont souligné l'importance de ce processus de décolonisation de l'esprit, mettant en avant le fait que l'expérience coloniale a profondément affecté tant les colonisateurs que les colonisés. Dans le cadre des débats académiques postcoloniaux actuels, cette conférence fera le point sur les récits et les perceptions coloniales qui continuent de résonner un peu partout. Le langage employé par les dirigeants, écrivains et influenceurs tant africains qu'européens témoigne de la persistance d'une vision qui occulte l'héritage colonial, confirmant ainsi que ce dernier imprègne toujours le discours et les interactions contemporains.
Grand événement - Musique ! La Philharmonie au Collège de FranceCycle de rencontres en partenariat avec la Cité de la musique – Philharmonie de ParisCollège de FranceAnnée 2025-2026Écouter la musiqueRima Abdul-Malak, Olivier Mantei & Pierre-Michel MengerTable ronde avec Rima Abdul-Malak, ancienne ministre de la Culture ; Olivier Mantei, directeur général de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris ; Pierre-Michel Menger, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur.Modératrice : Chloë Cambreling. RésuméLa Philharmonie défend l'idée selon laquelle il n'y a pas lieu d'opposer démocratisation et exigence artistique, que cela n'est pas en revoyant les ambitions à la baisse que l'on partagera plus largement la musique et les arts, mais en travaillant sur les voies d'accès, en suscitant les rencontres et en les accompagnant, en défendant un droit à la culture pour chacun plutôt que « pour tous ». Cette volonté trouve un écho particulier au sein du Collège de France où la libre diffusion des savoirs constitue la mission cardinale de l'institution depuis près de cinq cents ans et où l'excellence scientifique n'est jamais contradictoire avec le partage des connaissances et la poursuite d'un idéal d'émancipation par la culture. Quels sont alors aujourd'hui les enjeux croisés de la démocratisation culturelle et de la démocratisation des savoirs ? Quelles évolutions connaissent les publics et les praticiens de la musique ? Comment, finalement, écoute-t-on la musique aujourd'hui ?-- Le Collège de France invite la Philharmonie de Paris pour un cycle de six rencontres gratuites et ouvertes à tous consacrées à la musique. Conférences, masterclasses et tables rondes accueilleront compositeurs, artistes et théoriciens aux côtés des professeurs du Collège de France pour une série de rendez-vous exceptionnels.Depuis 2015, la Philharmonie de Paris érige dans le nord-est de Paris une architecture miroitante, repère familier des automobilistes empruntant le périphérique et lieu de passage obligé des plus grands musiciens internationaux. Dotée de l'une des plus belles acoustiques au monde, cette impressionnante salle de concert ne s'est pas seulement imposée comme l'une des principales maisons musicales, « un temple dans l'ouïe », comme écrivait Rilke. C'est aussi un lieu de savoir, de recherche et de partage, qui héberge orchestre et musée, où la musique s'écoute et se travaille, se visite et s'expose, s'enseigne et se diffuse auprès de tous les publics, en particulier les plus jeunes. Pierre Boulez, professeur du Collège de France de 1978 à 1995, avait voulu la construction de cet auditorium majeur, qui porte désormais son nom. Aussi, pour célébrer cette première décennie d'existence, le Collège de France invite-t-il la Philharmonie de Paris à partager son expérience et à y réfléchir tout au long de l'année 2025-2026 au fil de rencontres associant musiciens, compositeurs, artistes et professeurs du Collège de France. La musique est un plaisir et un savoir : une année durant, le Collège de France et la Philharmonie de Paris les feront résonner de concert.Le cycle Musique ! La Philharmonie au Collège de France est coordonné par le Pr William Marx, titulaire de la chaire Littératures comparées.Modération : Chloë Cambreling.
Denis DubouleChaire Évolution du développement et des génomesCollège de FranceAnnée 2025-2026Nos ancêtres les poissonsConférence - Neil Shubin : How Do New Biological Inventions Arise in Evolution? Lessons from Fossils, Embryos, and GenesNeil ShubinUniversité de Chicago, Président élu de l'Académie nationale des sciences (NAS), États-UnisRésuméWhen we look at the history of life at a grand scale, from the earliest single celled organism to complex animals alive today, we see a past filled with great revolutions. Major transformations pervade this history, involving new features, new developmental processes, new ways of living, and new ecological interactions. In our own lineage, over the past 500 million years some fish evolved to live on land, reptiles evolved to fly, and primates evolved the ability to talk, walk, and think. For each of these major transitions we recognize features that allowed them to happen. The standard view is that these innovations were enablers for a major revolution: for example, feathers arose for flight, lungs, for life on land, etc. But this view couldn't be farther from the truth. Lungs evolved in fish well before they ever took steps on land, feathers arose in dinosaurs before they could fly, and so on. The features that play a role in great evolutionary changes arise by repurposing existing features for new functions. This view of evolutionary tinkering, first pioneered by François Jacob in the 1970's, carries profound implications for modern molecular and paleontological evolutionary biology.
Antoine LiltiChaire Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècleCollège de FranceAnnée 2025-2026Conférence - Darrin McMahon : Les paradoxes de l'égalité : histoire d'un idéal insaisissableDarrin McMahonDartmouth, USARésuméLes historiens ont souvent considéré que l'égalité, en tant qu'idéal politique moderne, avait été inventée au XVIIIe siècle. Il ne fait aucun doute que l'âge des Lumières et des révolutions fut une étape majeure dans la réflexion collective sur l'égalité. Et pourtant, si l'on tient compte de la longue durée intellectuelle, il apparaît clairement que l'égalité n'était en aucun cas un concept nouveau au XVIIIe siècle, ni en « Occident » ni dans de nombreuses traditions religieuses du monde. L'examen du passé long et complexe de l'égalité avant le XVIIIe siècle nous oblige à nous confronter aux usages différents de la notion d'égalité et à constater que celle-ci a souvent coexisté avec la hiérarchie et l'exclusion, et qu'elle a même régulièrement servi de prémisse fondamentale à celles-ci. Après avoir exposé certains aspects de ce passé, McMahon discutera de la manière dont les grandes révolutions du XVIIIe siècle en Amérique, en France et à Saint-Domingue, ont bouleversé les conceptions de l'égalité, avant que celles-ci reviennent, par la suite, à des schémas familiers.
Jean-Jacques HublinChaire PaléoanthropologieCollège de FranceAnnée 2025-2026Comment nous avons évolué pour mourir en bonne santéConférence - Daniel Lieberman : Une perspective évolutionniste sur l'obésité (et comment y remédier)Daniel LiebermanUniversité Harvard, département de biologie évolutive humaineRésuméLa quatrième et dernière conférence abordera les problèmes de l'obésité et de l'excès d'énergie, sans doute les défis les plus importants et les plus croissants en matière de santé aujourd'hui en France et dans d'autres pays à revenu élevé. Quelles sont les causes de l'obésité et pourquoi les humains sont-ils si enclins à devenir obèses et en surpoids ? Comment l'obésité affecte-t-elle la santé ? Comment pouvons-nous mieux réfléchir à l'obésité ?
Denis DubouleChaire Évolution du développement et des génomesCollège de FranceAnnée 2025-2026Nos ancêtres les poissonsConférence - Neil Shubin : The Evolutionary Origins of Bones and TeethNeil ShubinUniversité de Chicago, Président élu de l'Académie nationale des sciences (NAS), États-UnisRésuméTeeth and bones are fundamental features of vertebrate organisms. The earliest vertebrates date from fossils that are over 500 million years old and existed at the time of the Cambrian Explosion, a great burst of innovation in the evolutionary history. The first creatures with tissues similar to our teeth and bones aren't seen until tens of millions of years later. Some of these reports have been controversial because challenges imaging the fossils and comparing the tissues between fossil and living forms. New imaging technologies have transformed our ability to study this issue. Studies from multiple laboratories have revealed that tissues equivalent to our teeth and bones originally evolved outside the body—in the bony exoskeletons of our jawless fish ancestors. Inside this exoskeletal armor are small structures that are distinctly toothlike. Detailed comparisons of these features among living and fossil vertebrates and invertebrates reveal that the earliest teeth likely had a sensory function in the external tissues of these fish. Assessing diverse fossil fish reveals that many distinct features of our bones and teeth, such as the capacity to remodel, originally came about in jawless fish.
Jean-Jacques HublinChaire PaléoanthropologieAnnée 2025-2026Collège de FranceComment nous avons évolué pour mourir en bonne santéConférence - Daniel Lieberman : Pourquoi nous avons évolué pour être physiquement actifs mais pas pour faire de l'exerciceDaniel LiebermanUniversité Harvard, département de biologie évolutive humaineRésuméLa troisième conférence portera sur l'activité physique. Comment et pourquoi les humains sont-ils passés de singes très sédentaires à être si actifs physiquement ? Pourquoi, si nous avons évolué pour être physiquement actifs, tant de personnes n'aiment-elles pas faire de l'exercice ? Et surtout, comment et pourquoi et dans quelle mesure l'activité physique ralentit-elle le vieillissement et réduit-elle notre vulnérabilité à un large éventail de maladies ?
Denis DubouleChaire Évolution du développement et des génomesCollège de FranceAnnée 2025-2026Nos ancêtres les poissonsConférence - Neil Shubin : Discovering How Fish Evolved to WalkNeil ShubinUniversité de Chicago, Président élu de l'Académie nationale des sciences (NAS), États-UnisRésuméThe ability to walk is fundamental to human lives. Like all our biological features walking has a complex and deep history. It is most commonly thought that walking arose as fish made the evolutionary transition to land, shifting from an aquatic environment to a terrestrial one. In this view, the transition out of water meant that animals now had to evolve new mechanisms to deal with gravitational loads. As a consequence, they developed more mobile joints, arm and leg bones with robust connections for expanded locomotory muscles, and other structures to allow them to move about. Surprising, this very intuitive view is not supported either by comparative anatomy or the fossil record. The closest fish relatives to terrestrial vertebrates were capable of walking with four appendages, a fact seen in the structure of the bones and joints in their fins. Moreover, walking either on four appendages or two is commonly seen in aquatic fish ranging from sharks, lobe fin fishes, and diverse ray finned fishes. Indeed, many of these fish use alternating gaits and appendage motions in aquatic settings that are similar to terrestrial tetrapods. This observation leaves open the question of why fish walk in water instead of swimming. To answer these questions scientists have developed underwater treadmills, experiments training fish to walk, and robots that simulate walking behaviors. One major factor in the origin of fish walking, hence our own, is energetics: at slow speeds, and in certain environmental conditions is it energetically more efficient to walk than swim.
Denis DubouleChaire Évolution du développement et des génomesCollège de FranceAnnée 2025-2026Conférence - Neil Shubin : Nos ancêtres les poissons : Finding The History We Share With FishNeil Shubin est invité par l'assemblée du Collège de France sur proposition du Pr Denis Duboule.PrésentationIl y a 380 millions d'années, nos ancêtres les poissons développaient des structures permettant la colonisation du milieu terrestre. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, tenter de reconstituer cette transition évolutive extraordinaire afin d'essayer de comprendre comment cela a pu se passer ?This lecture will explore the deep history of our bodies, one that extends billions of years. As we uncover new fossils, understand the patterns and mechanisms that form diverse animal bodies, and compare the anatomy of organ systems of creatures alive today, we find that every structure in our bodies contains artifacts of our branch of the tree of life. Our limbs are based on the pattern of bones first seen in ancient fish as is the patterns of nerves, muscles, and organs in our circulatory, excretory, and nervous systems. The profound connections we share with the rest of life of our planet also inform biomedical studies. Analyses of fish play important roles in understanding and treating diverse human diseases.Neil ShubinUniversité de Chicago, Président élu de l'Académie nationale des sciences (NAS), États-Unis.Le Pr Neil Shubin est une figure dans le domaine de la paléontologie moderne, en particulier en ce qui concerne l'acquisition des caractères des animaux vertébrés au moment de leur transition d'un milieu aquatique vers un milieu terrestre. Une de ses découvertes majeures est celle de Tiktaalik, un fossile de la période du dévonien (un poisson sarcoptérygien) trouvé lors de fouilles qu'il effectue au Groenland et publié en 2006. Ce fossile, en effet, est une sorte de chaînon manquant entre les tétrapodes et nos ancêtres les poissons, un fossile qui eut un retentissement planétaire lors de sa publication.En plus de ses qualités de chercheur de terrain, Neil Shubin est un communicateur de science hors pair et reconnu. Ses livres (entre autres, The Inner Fish traduit en français chez Laffont : Au commencement était le poisson) lui ont valu une reconnaissance publique et médiatique rare dans ce domaine, pour laquelle il a reçu de nombreuses distinctions, couronnée par son élection récente à la présidence de la prestigieuse Académie nationale des sciences des États-Unis. Son nouveau livre Ends of the Earth vient de paraître (février 2025).




