Discover L'envie de savoir
L'envie de savoir
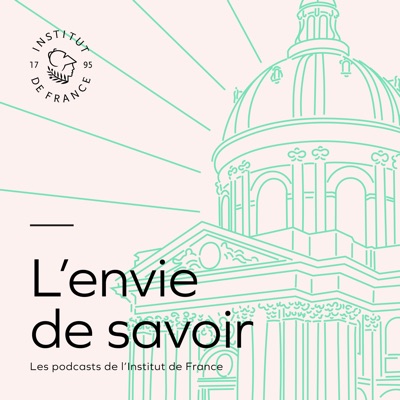
L'envie de savoir
Author: Institut de France
Subscribed: 240Played: 8,128Subscribe
Share
© Canal Académies - Tous droits réservés
Description
Émission de culture générale. Chaque semaine, un nouvel invité (académicien, chercheur, etc) apporte des éclairages approfondis et nuancés sur un sujet tiré de sa spécialité.
297 Episodes
Reverse
Dans l’Antiquité, certains orateurs n’avaient pas pour mission de convaincre ou de juger, mais de célébrer. Ils composaient ce qu’on appelait des discours d’éloge, ou discours épidictique, un art codifié qui exalte un homme, une cité ou une idée. Très répandus, ces textes ne se réduisaient pas à une adulation béate : ils servaient aussi à faire passer des messages subtils, parfois politiques, qu’il fallait savoir décrypter. Un exemple emblématique est le Discours en l’honneur de Rome, prononcé au IIᵉ siècle par le Grec Aelius Aristide, qui met en scène la grandeur de l’Empire romain à son apogée. Ce texte canonique bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle édition traduite et commentée par Laurent Pernot, grand spécialiste de la rhétorique antique, aux éditions des Belles Lettres. L’académicien y explique les fonctions méconnues de l’éloge et montre combien, derrière les apparences d’un hommage, ces discours en disent bien plus sur une époque et ses tensions.
Élu à l’Académie des beaux-arts en 2022, Hervé Di Rosa revendique un passé d’ex-punk et une fidélité constante à ses premières influences : bande dessinée, rock, science-fiction. Dans les années 1980, il cofonde à Sète le mouvement de la figuration libre, une peinture vive, graphique, qui aborde sans détour des thèmes comme le sexe, la drogue, le racisme ou la libération des mœurs. Traversées de références populaires, ses œuvres bousculent les frontières entre culture savante et culture ordinaire. Également promoteur de ce qu’il nomme l’« art modeste », Hervé Di Rosa défend une autre manière de regarder les objets, les formes et les mondes souvent relégués à la marge. Comment naît un mouvement artistique ? À quoi résiste-t-il ? Et que fait-il bouger ?
C’est dans un paysage noir de pluie, de défaite et de corps entassés que débute le dernier roman de François Sureau, de l’Académie française. La France vient de perdre la bataille de Sedan. Tandis que les soldats vaincus errent encore, trois crimes sont commis. Dans cette atmosphère suspendue surgit un détective énigmatique : Thomas More, nouveau héros d’une série policière traversant les siècles. Comment façonner un enquêteur aussi insaisissable que les crimes qu’il poursuit ? Comment distiller le suspense, scène après scène ? François Sureau explore les ressorts du récit policier et l’art de maintenir son lecteur en haleine.
Depuis huit ans, son restaurant déploie sa vision de la haute cuisine au cœur de la Monnaie de Paris, dans un écrin chargé d’histoire. Consacré meilleur au monde par La Liste, il incarne l’excellence selon Guy Savoy, dont la signature culinaire résonne bien au-delà des frontières. De la célèbre soupe d’artichaut à la truffe noire au rouget Barbet « en situation », certaines assiettes sont devenues des références, autant pour leur précision que pour l’émotion qu’elles suscitent. Icône dont l’aura a inspiré les studios Pixar pour Ratatouille, le chef a même figuré au programme du baccalauréat d’histoire-géographie en 2023. En 2024, il a marqué une nouvelle étape en devenant le premier cuisinier élu à l’Académie des beaux-arts. Mais derrière cette reconnaissance mondiale, comment naît une assiette signée Guy Savoy ? Que racontent ses saveurs, ses textures, ses émotions ?
Si l’actualité internationale rappelle chaque jour l’importance des diplomates, nous ignorons souvent comment leurs pratiques ont évolué. Au XVIᵉ siècle, un tournant s’opère. Des représentants sont envoyés à l’étranger, non plus pour quelques semaines, mais pour des missions au long cours. Ils observent, négocient, transmettent, incarnent leurs souverains. Et ils inventent un nouveau métier ! L’historien Lucien Bély, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, retrace les débuts de la diplomatie moderne. Qui sont ces hommes chargés de faire dialoguer les puissances ? Comment parviennent-ils à négocier dans des cours étrangères parfois hostiles ? Et que révèle cette mutation d’une nouvelle manière de penser les rapports entre États ?
Dans un monde saturé d’images, où l’on scrolle plus qu’on ne regarde, comment réapprendre à voir ? Voir vraiment. Décoder ce que les images nous disent, ce qu’elles nous cachent, ce qu’elles supposent. Distinguer une photographie d’un simple cliché, comprendre sa construction, son intention, sa diffusion. L’Envie de savoir se penche sur les enjeux de l’éducation à l’image, cette grande absente de la formation intellectuelle. Pourquoi l’école initie-t-elle si peu au décryptage visuel, alors que les images façonnent chaque jour les regards et les récits ? Éric Karsenty, ancien rédacteur en chef de Fisheye et correspondant de l’Académie des beaux-arts, met en lumière les nouvelles écritures photographiques, les logiques de diffusion de l’image et l’urgence de former un regard critique, notamment face aux photographies d’actualité.
Il couvre plus de 70 % de la surface de notre planète, régule le climat et abrite une biodiversité aussi riche que fragile… Pourtant, l’océan demeure largement méconnu.Aujourd’hui, il est en première ligne face au réchauffement climatique : montée du niveau des mers, acidification, réchauffement des eaux, désoxygénation…Ces menaces pèsent déjà lourdement sur la biodiversité marine, mais aussi sur les sociétés humaines qui en dépendent. Que se passe-t-il exactement dans les profondeurs marines ? Pour y voir plus clair, le climatologue et océanographe Laurent Bopp, membre de l’Académie des sciences, nous éclaire sur ce basculement silencieux mais décisif.
En 1870, la défaite de Sedan précipite la chute du Second Empire et plonge la France dans une profonde incertitude politique. L’Empereur capitule, le régime s’effondre, et la République est proclamée dans l’urgence. Mais le pays reste divisé : monarchistes et républicains s’affrontent sur l’avenir des institutions. Ce n’est qu’en 1875, après de longues négociations, que trois lois constitutionnelles viennent consacrer la naissance de la Troisième République. Pourquoi avoir attendu cinq ans ? Pourquoi trois lois plutôt qu’une Constitution ? Comment les idées républicaines ont-elles gagné du terrain durant cette décennie fondatrice ? Et quel rôle joue encore cet héritage dans les institutions d’aujourd’hui ? Pierre Allorant, historien du droit et président du Comité d’histoire parlementaire et politique, analyse de cette séquence fondatrice, dont les résonances traversent encore nos institutions.
Utilisé quotidiennement sans qu’on y prête attention, le mètre structure pourtant notre rapport au monde. Né sous la Révolution française, il a mis près d’un siècle à s’imposer comme référence commune. En 2025, la Convention du mètre fête ses 150 ans : un jalon essentiel dans l’histoire de cette unité, désormais incontournable dans les sciences, l’industrie ou les échanges internationaux. Mais qu’est-ce qu’une unité de mesure, au fond ? Et pourquoi avoir choisi le mètre ? Pour éclairer ce parcours à la fois scientifique et politique, le physicien Christophe Salomon, membre de l'Académie des sciences revient sur l’histoire de cette mesure universelle.
Quel peut être le rôle d’un philosophe dans le champ des sciences ? À l’heure où les découvertes et les innovations technologiques s’accélèrent, il ne s’agit pas pour lui de produire des résultats expérimentaux, mais d’interroger les fondements, les méthodes et les implications des savoirs en cours de construction. Claude Debru, philosophe et historien des sciences de la vie, professeur émérite à l’École normale supérieure et membre de l’Académie des sciences, a consacré plus de cinquante ans à cette réflexion. Dans Oser le savoir, il retrace son parcours intellectuel et rend hommage à l’une de ses influences majeures, le philosophe Georges Canguilhem.
Le 11 avril marque la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, une occasion d’informer sur cette pathologie neurodégénérative qui touche plus de 200 000 personnes en France, soit près de 2 % des plus de 65 ans. La maladie de Parkinson interroge autant qu’elle inquiète : comment apparaît-elle ? Quelle part revient aux facteurs génétiques ? Et comment les avancées scientifiques récentes permettent-elles d’imaginer de nouvelles pistes thérapeutiques ? Alexis Brice, professeur de génétique médicale, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie de médecine, apporte son éclairage. Ancien directeur de l’Institut du Cerveau, il livre son regard sur les progrès de la recherche, tout en soulignant que certaines questions restent sans réponse dans la compréhension de la maladie.
L’archéologie ne se limite pas à l’étude des civilisations anciennes ; elle façonne aussi les relations entre les nations et constitue un puissant levier d’influence. Dans L’Archéologue et le Diplomate, Nicolas Grimal, Secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, explore cette alchimie singulière entre savoir et stratégie. Il met en lumière le modèle novateur conçu par Charles de Gaulle et Henri Seyrig au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un système unique au monde qui a permis à la France de conjuguer recherche archéologique et rayonnement international. Un maillage subtil qui irrigue encore aujourd’hui la coopération culturelle à l’échelle globale.Nicolas Grimal présentera son ouvrage le mardi 8 avril prochain à la librairie de l’Institut. S’inscrire à la dédicace ici.
Le nom de Jean Le Rond d’Alembert est souvent associé à l’Encyclopédie, œuvre manifeste des Lumières. Pourtant, réduire le personnage à ce projet serait méconnaître une facette essentielle de son génie : celle du mathématicien et du scientifique. Admis à l’Académie des sciences à seulement 24 ans, d’Alembert s’est illustré par ses travaux en mathématiques, en mécanique et en physique, dans un XVIIIᵉ siècle foisonnant de découvertes et de débats scientifiques. Ses travaux ont nourri des controverses, bousculé ses contemporains et marqué l’histoire des sciences. Pour éclairer cette dimension méconnue, Irène Passeron, historienne des sciences au CNRS, Alexandre Guilbaud, enseignant-chercheur à Sorbonne Université, et Christophe Schmit, chargé de recherche au CNRS, apportent leur expertise. Tous trois coordonnent l’édition des œuvres complètes de d’Alembert, dont un nouveau volume a été publié en 2025.
On ne peut pas comprendre l’Europe de l’après-guerre sans revenir sur celle qui fut occupée, remodelée et administrée par les puissances de l’Axe lors de la Seconde Guerre mondiale. Durant ce conflit, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste n’ont pas seulement conquis militairement une grande partie du continent : elles ont aussi esquissé un nouvel ordre européen avec cette ambition : réorganiser l’Europe autour d’un modèle politique, économique et social inédit. Si ce projet a échoué avec la défaite de l’Axe, il a néanmoins laissé des traces, et l’historiographie récente met en lumière cette dimension européenne du fascisme et du nazisme, longtemps sous-estimée. Georges-Henri Soutou, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, auteur de Europa ! Les projets de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste et Maurizio Serra, de l’Académie française, diplomate et fin connaisseur de l’Italie fasciste, auquel on doit notamment une biographie de Mussolini, dialoguent autour de cette tentative de refonte du continent.
Nos forêts demain - Comprendre, transmettre, agir : un colloque pour comprendre l’impact du changement climatique sur les forêts le 21 et 22 mars à l'Institut de France. Deux journées de conférences organisées par l'Institut de France, l'Académie des sciences et le Château de Chantilly.Inscrivez-vous et découvrez le programme ici.
50 années de recherche avec Jean-Pierre Mahé (1/2)
Perché sur la montagne Sainte-Geneviève, au cœur de Paris, le Panthéon occupe une place unique dans le paysage mémoriel français. Ancienne église devenue temple républicain, il accueille depuis la Révolution les grandes figures ayant marqué l’histoire de la nation. Depuis 1958, il revient au président de la République de choisir celles et ceux qui y reposent. Longtemps relégué à l'arrière-plan dans sa fonction de mausolée national, le monument a retrouvé une nouvelle vitalité à partir de la fin des années 1980. Ces dernières années, Simone Veil, Joséphine Baker, ainsi que Mélinée et Missak Manouchian y ont trouvé leur place. Barbara Wolffer, administratrice du Panthéon depuis 2022, présente le rôle du monument dans la construction de la mémoire collective et les défis qui l’attendent en 2025.
Derrière la gestuelle qui attire tous les regards, le rôle du chef d’orchestre apparaît bien plus ample que ce que l’on en perçoit le jour du concert. Guide, interprète, créateur : quelle est la nature de son art ? Compositeur, Bruno Mantovani, membre de l’Académie des beaux-arts, dirige également des orchestres. Comment dialogue-t-il avec les musiciens ? Quelle place accorder au silence, au geste, à l’intuition ? La baguette est-elle un outil indispensable ? Le chef nous dévoile les ressorts d’un métier exigeant, fait d’écoute et de transmission.
De la parabole des talents dans l’Évangile selon Saint Matthieu aux « talent shows » d'aujourd'hui, la notion de talent a traversé les siècles, évoluant au gré des contextes sociaux et culturels. D'abord unité de poids dans l’Antiquité, elle devient un principe méritocratique qui s’impose dans l’Europe des Lumières. Depuis trente ans, le terme connaît une ascension fulgurante dans le monde de l’entreprise et du management, popularisé dans les années 1990 par des cabinets de conseil américains. Mais cette sémantique, en apparence valorisante, ne masque-t-elle pas de nouvelles formes d’inégalités ? Le sociologue Pierre-Michel Menger, membre de l’Académie des sciences morales et politiques et professeur au Collège de France, décrypte les enjeux de ce mot à succès.
Invité de cette émission, Emmanuel Guibert, membre de l’Académie des beaux-arts, nous entraîne dans les coulisses de la création de la bande dessinée Ariol, ce petit âne rêveur devenu une icône de la littérature jeunesse. Conçu avec Marc Boutavant, publié dans J’aime lire depuis 1999, Ariol incarne vingt-cinq ans d’histoires tendres et universelles qui ont conquis des générations de lecteurs. Au fil de l’émission, Emmanuel Guibert, qui s’inspire de son enfance pour écrire les scénarios, revient sur l’alchimie qui donne vie à ce héros attachant. Il répond aussi aux questions spontanées et pétillantes d'enfants qui grandissent avec Ariol.Ariol est publié chez Bayard Jeunesse.




