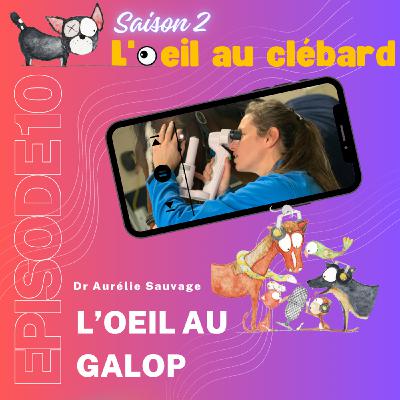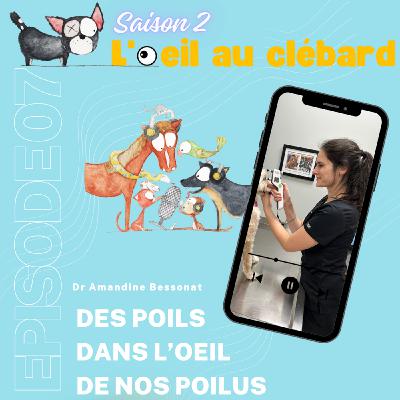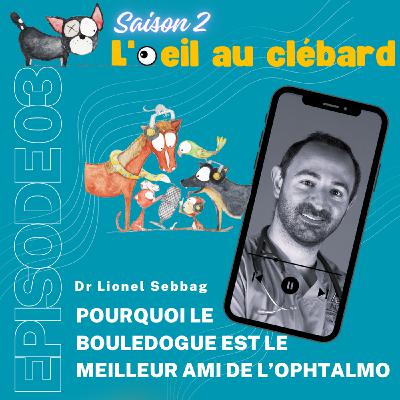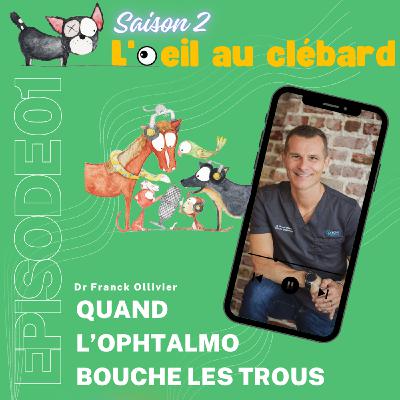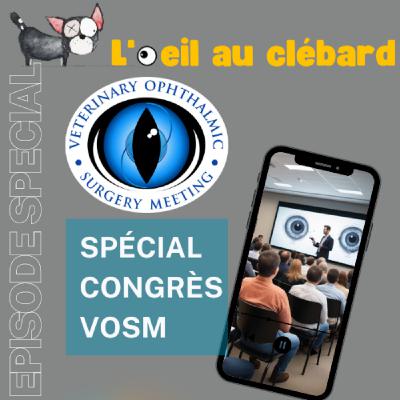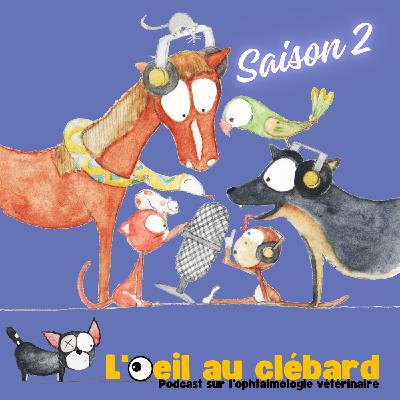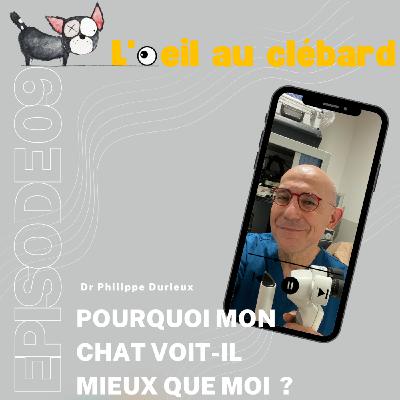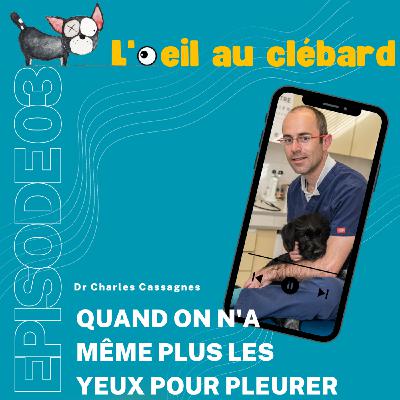Discover L'oeil au clébard
L'oeil au clébard

L'oeil au clébard
Author: BertrandMichaud
Subscribed: 3Played: 20Subscribe
Share
© Dr Bertrand Michaud
Description
🤓Bertrand Michaud, 👨⚕️Vétérinaire praticien exclusif en Ophtalmologie👀à la Clinique Vétérinaire AnimaVet près de Genève interviewe tous les premiers jeudis du mois ses collègues ophtalmologues vétérinaires. Ensemble, ils échangent sur les principales affections qui peuvent toucher les yeux de nos compagnons🐶🐱🐰.
Un podcast mensuel📻 pour connaître les signes d’appels des maladies oculaires des chiens, chats et autres NAC afin de mieux les gérer au quotidien, que l’on soit propriétaire ou vétérinaire. Vous ne verrez plus jamais votre animal de la même façon après avoir écouté notre podcast sur ses yeux !
23 Episodes
Reverse
Aujourd’hui on a vu avec Aurélie Sauvage que le cheval présente la particularité anatomique d’avoir un œil situé en position très latérale sur une tête largement mobile à l’extrémité d’une encolure qui l’est tout autant. Cet œil est exposé aux traumatismes, aux corps étrangers véhiculés dans l’air et aux autres agents physiques. La particularité de l’œil du cheval c’est qu’il manifeste souvent moins la douleur que d’autres espèces.
Dans son exercice quotidien, tout praticien équin peut être confronté à des urgences ophtalmologiques avec une mise en danger de l’intégrité de l’œil ou de ses annexes, à des affections comme les kératites ou les uvéites, qui ont une incidence sur la perception visuelle du cheval et, par conséquent, sur ses aptitudes sportives voire sa vie.
Le cas échéant, à la faveur d’une visite d’achat, il lui est aussi demandé de se prononcer sur des affections oculaires ou encore sur l’incidence visuelle d’une cataracte et son évolution dans le temps.
L’examen ophtalmologique du cheval se fait le plus souvent chez le propriétaire, il est alors souvent difficile d’avoir les meilleures conditions d’exploration. Il est parfois nécessaire de recourir à la sédation ainsi qu’à des blocs oculo-palpébraux pour faciliter l’examen. Des prélèvements biologiques sont souvent réalisés étant donné l’importance d’atteintes fongiques, bactériennes et virales chez les équidés.
L’œil présente aussi l’originalité de déclarer des symptômes similaires lors de bon nombre d’affections, qui sont tout aussi complexes que variées, avec des traitements médicaux et chirurgicaux à adapter. C’est ainsi qu’une cornée avec une forte concentration cellulaire peut être révélatrice d’un abcès stromal ou d’une kératite à médiation immune et on ne les gère pas du tout de la même manière. Dans le premier cas, le vétérinaire fait face à une urgence médicale et chirurgicale, dans le second, il s’agit d’une gestion au long cours avec des traitements qui varient selon qu’il s’agit d’une kératite épithéliale, stromale superficielle ou stromale profonde.
Lors de traumatisme cornéens ou d’ulcération profonde des techniques chirurgicales similaires à celles utilisées chez les petits animaux de compagnie peuvent être proposées. Il est souvent nécessaire d’anesthésier totalement et le coucher ce qui n’est jamais une mince affaire dans ces espèces.
L’uvéite est une affection redoutée chez le cheval en raison de son caractère récidivant et des risques important de perte de fonction de l’œil. De nombreux agents infectieux peuvent être à l’origine d’uvéite chez le cheval mais il semble que les leptospires couplés à des prédispositions génétiques sont les premiers facteurs de risque pour le passage à la chronicité lors d’uvéite récidivante. Différentes solutions chirurgicales ont été développées pour lutter contre ces uvéites comme la pose d’implants suprachoroïdiens de ciclosporine ainsi que l’injection intravitréenne de gentamicine à faible dose.
C’est la fin de la saison 2 de l’oeil au clébard, j’espère que ces 20 épisodes auront pu aiguiser votre intérêt pour l’ophtalmologie vétérinaire.
Aujourd’hui on a vu avec le Dr Maud Debreuque que l’oeil est le seul organe de notre corps où le système nerveux et le système vasculaire sont observables car il est transparent.
L’œil interagit énormément avec le système nerveux central : tout d’abord en tant que récepteur sensoriel via la rétine qui transforme la lumière en influx électrique cheminant ensuite via le nerf optique puis le chiasma jusqu’au cortex dans lequel l’image va se former. Mais l’œil est aussi innervé par quantité de nerfs périphériques dirigeant sa position dans l’axe, l’ouverture des paupières mais aussi un système nerveux dit autonome qui influence des automatismes comme la sécrétion lacrymale et la dilatation pupillaire.
Au-delà des causes oculaires, les animaux peuvent devenir aveugle en raison de lésions nerveuses pouvant siéger à différents endroits sur le trajet des voies visuelles avec un pronostic variable selon l’étiologie. L’exploration fonctionnelle des voies visuelles est particulièrement délicate chez nos animaux car ils ne peuvent pas participer à l’examen comme les nous le ferions. Certains dispositifs comme l’électrorétinographie et la pupillométrie chromatique permettent d’apprécier l’état de fonctionnement de la rétine et des voies visuelles. Des examens d’imagerie comme l’IRM complètent l’examen neurologique et ophtalmologique afin de localiser et caractériser d’éventuelles lésions centrales.
La motricité pupillaire est également un bon indicateur pour la neurolocalisation des lésions. Il faut retenir qu’une persistance normale des Réflexes Pupillaires Photomoteurs lors de perte de vision est évocatrice de lésions en aval du chiasma optique.
Des atteintes du système nerveux autonome peuvent se caractériser par des anisocories : il s’agît de différences de diamètre pupillaire avec le plus souvent un myosis anisocorique constaté chez l’animal à l’obscurité lors de syndrome de Claude Bernard Horner. Dans cette pathologie, une paralysie du système orthosympathique entraîne un ensemble de manifestations oculaires : myosis, ptose de la paupière supérieure, enfoncement de l’œil dans l’orbite, procidence de la membrane nictitante voire rougeur oculaire dans certains cas. Une compression sur le très long trajet orthosympathique en est souvent la cause mais il n’est pas rare de conclure à une origine idiopathique. Une atteinte du système parasympathique pourra occasionner une sécheresse oculaire qui a la particularité d’être associée à une sécheresse nasale unilatérale.
On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison 2 avec le Dr Aurélie Sauvage pour parler des particularités de l’ophtalmologie chez le cheval.
Aujourd’hui on a vu avec Lucas Flenghi qu’il y a près de 10 millions de nouveaux animaux de compagnie en France ainsi que des animaux de faune sauvage captifs ou non.
Lucas peut être amené à soigner des espèces potentiellement dangereuses, il n’est pas rare de devoir sédater certains animaux pour mieux les examiner.
Comme tous les vertébrés ils peuvent présenter les mêmes problèmes ophtalmologiques que nos carnivores domestiques : ulcères, conjonctivite, cataracte mais certaines espèces présentent plus souvent certaines pathologies oculaires voire des pathologies propres à leur espèce.
Les furets présentent ainsi fréquemment des conjonctivites, cataracte et atrophie rétinienne. Le lapin est sans doute le NAC qui présente le plus de pathologies oculaires spécifiques : déjà il n’a qu’un seul point lacrymal, il n’est pas sensible à l’effet cycloplégique de l’atropine... dommage pour la douleur et sa glande lacrymale accessoire est une glande de harder et pas nictitante comme chez le chien et le chat. Il peut présenter des membranes conjonctivales épicornéennes qu’on ne retrouve chez aucun autre animal, des dacryocystites souvent associées à des abcès dentaires (n’oubliez pas de passer des radiographies dentaires aux lapins qui ont les yeux qui coulent), des ulcères atones comparables au bon vieux ulcère superficiel chronique de nos bouledogues et bien sûr des uvéites à encephalitozoon cuniculi qui répondent très bien au traitement chirurgical même lorsque de volumineux abcès sont présents en chambre antérieure.
Les reptiles eux peuvent présenter des blépharites et conjonctivites dont une bien connue par hypovitaminose A chez la tortue. Les serpents eux n’ont pas de paupière mais ils ont une seconde membrane transparente en avant de la cornée qui s’appelle la lunette qui peut avoir du mal à tomber lors de la mue voire être le siège d’abcès. Les oiseaux présentent souvent des pathologies traumatiques ainsi que des atteintes infectieuses, parasitaires et nutritionnelles et peuvent eux aussi être atteints de cataracte ;
La particularité de ces espèces est leur taille souvent plus faible que les chiens et les chats rendant l’application des traitements et la mise en place de moyens de protection beaucoup plus complexe.
Les opérations se déroulent comme chez le chien et le chat, sous microscope opératoire mais l’anesthésie est plus complexe. Si vous voulez en savoir plus sur l’ophtalmologie des NAC achetez le Williams – Ophtalmology of Exotic Pets.
https://www.wiley.com/en-us/Ophthalmology+of+Exotic+Pets-p-9781444330410
On se retrouve dans un mois pour parler de la neuro-ophtalologie avec le Maud Debreuque
Aujourd’hui on a vu avec Amandine Bessonnat que nos poilus peuvent avoir des poils qui les embêtent. Comme nous nos animaux ont des cils et ces derniers peuvent irriter l’œil lorsqu’ils poussent dans le mauvais sens.
On distinguera le distichiasis qui est un cil qui pousse au travers des glandes de meibomius des cils ectopiques qui traversent la paupière et viennent irriter la cornée un peu comme le diamant d’un tourne disque.
Parfois ce sont les poils du pli du nez qui viennent frotter contre l’œil, ce qui survient particulièrement dans de petites races à museau court qu’on appelle les brachycéphales comme le Shih Tzu par exemple. Il convient d’entretenir les poils régulièrement en les recoupant pour éviter qu’ils n’irritent la cornée. On pourra réaliser l’exérèse du pli du nez ou une canthoplastie médiale pour les cas les plus graves.
Lors d’irritation chronique, il peut survenir une kératite par irritation qui s’accompagnera de douleur oculaire, d’une opacification de la cornée, de néovaisseaux, d’une pigmentation cornéenne voire d’ulcère cornéens surinfectés pouvant entraîner la perte de l’œil. Il faut donc être vigilant.
Parfois ce sont les paupières qui s’enroulent sur elles même et qui entraîne un frottement : on parle d’entropion. Ce phénomène peut être congénital et doit être parfois corrigé dès les premiers mois de vie. Il est souvent lié à d’autres problèmes de conformation de l’œil et des annexes. Il peut également être observé après des traumatismes des paupières ou des interventions chirurgicales de ces dernières. La seule solution dans ce cas consiste à corriger la statique palpébrale par l’intermédiaire de la technique chirurgicale la plus adaptée et surtout celle que le chirurgien maîtrise le mieux.
On se retrouve dans un mois avec le Dr Lucas Flenghi pour parler de l’ophtalmologie des nouveaux animaux de compagnie.
Aujourd’hui on a vu avec Cécile Briffod que la désinsertion du cristallin de ses fibres zonulaires est à l’origine d’une luxation du cristallin. Celle-ci survient soit consécutivement à une anomalie de développement de la zonule, soit à sa dégénérescence, soit à sa rupture traumatique (plus rarement). On parle de luxation au sens strict lorsque la désinsertion cristallinienne est complète, de subluxation lorsqu’elle est partielle. La plupart des subluxations se fait en direction ventrale et laisse alors apparaître un croissant aphaque dorsal. La luxation peut être primaire ou secondaire car consécutive à une autre affection oculaire qui prédispose à la rupture zonulaire comme les uvéites antérieure et moyenne, glaucome, synérèse vitréenne, traumatismes…).
Elle pourra s’accompagner des signes cliniques observables suivants :
- Œdème cornéen stromal lié au frottement du cristallin sur l’endothélium cornéen ou au glaucome induit par l’appui du cristallin luxé sur l’angle irido-cornéen.
- Uvéite avec une inflammation marquée de l’iris et une chambre antérieure qui paraitra troublée
- les signes précoces de rupture zonulaire partielle sont un tremblement du cristallin (phacodonésis) et/ou de l’iris (iridodonésis) qui accompagne les mouvements du globe oculaire, ainsi que la présence de floculats vitréens en chambre antérieure (issue de vitré)
- la pression intraoculaire pourra être modifiée
o abaissée en cas d’uvéite antérieure ou moyenne
o élevée en cas de glaucome et d’uvéite hypertensive
La plupart des races canines du groupe des Terriers sont prédisposées à la luxation primaire du cristallin. Un test génétique est disponible pour savoir si son chien est porteur de l’anomalie. Dans certaines races la luxation primaire du cristallin est décrite mais la mutation causale inconnue (Épagneul breton, Shar Pei…).
Chez le chat, les luxations cristalliniennes sont très majoritairement post-inflammatoires ; la luxation primaire est sporadiquement décrite (Maine Coon, Européen)
Le diagnostic de la luxation antérieure et de la subluxation du cristallin repose sur les éléments de l’examen clinique. L’œdème cornéen et l’inconfort du patient peuvent compliquer l’examen, l’échographie permet alors de confirmer le diagnostic. La présence de floculats vitréens en chambre antérieure permettra de suspecter une instabilité du cristallin liée à une fragilité zonulaire.
Le traitement de la subluxation du cristallin pourra être médical (anti-inflammatoires et hypotenseurs topiques) mais plus souvent chirurgical par extraction du cristallin. Des complications de phacoexérèse telles que l’uvéite chronique, le décollement rétinien ou le glaucome ne sont pas rares.
L’usage d’agents myotiques topiques (analogues des prostaglandines) pour l’œil controlatéral peut être utile afin de limiter le risque de déplacement du cristallin adelphe. Des contrôles réguliers sont la règle.
On se retrouve dans un mois avec le Dr Amandine Besonnat qui nous expliquera pourquoi les poils de nos poilus peuvent être gênant pour leurs yeux.
Aujourd’hui on a vu avec Guillaume Payen que le tractus uvéal est composé de l’uvée antérieure et de l’uvée postérieure. Le terme uvéite désigne l’inflammation d’une de ces structures ou des deux à la fois on parle alors de panuvéite. La barrière hémato-oculaire s’interpose physiologiquement entre le sang circulant et les milieux oculaires on distingue la barrière hémato-aqueuse antérieure et la barrière hémato-rétinienne postérieure. Cela implique le traitement symptomatique précoce, intensif, sur une durée suffisante de toute uvéite antérieure aiguë, afin d’éviter que la rupture de la barrière hémato oculaire ne soit responsable de situations définitivement invalidantes avec des opacités cornéennes, une cataracte, un glaucome voire une dégénérescence rétinienne.
Cliniquement les uvéites seront accompagnées de symptômes variables : blépharospasme et photophobie, hyperhémie conjonctivale ,épisclérale , chémosis et infiltration vasculaire kératique périphérique profonde. Lors de phase aiguë on pourra apprécier la présence d’un effet Tyndall, d’œdème cornéen, d’hypopion, hyphéma ainsi que des réflexes pupillaires photomoteurs incomplets. Parfois, des précipités blanchâtres seront observés dans le vitré antérieur lors de cyclite, des synéchies postérieures, une cataracte ou la luxation du cristallin fréquemment associée à un glaucome secondaire au stade chronique de l’uvéite.
Lors d’uvéites postérieures on pourra observer un œdème rétinien, des décollements rétiniens bulleux et des hémorragies du fond d’œil en phase active de choriorétinite. Lors de l’évolution on pourra noter une hyper-réflexion du tapis en foyers plus ou moins nombreux et étendus, avec le plus souvent une migration pigmentaire au stade cicatriciel.
La pression intraoculaire est abaissée lors d’uvéite. L’uvéite peut être uni- ou bilatérale. Dans ce dernier cas, l’origine systémique est plus probable.
Déterminer la cause de l’uvéite est souvent incertain, la démarche diagnostique passe par le recueil minutieux de l’anamnèse, un examen clinique général complet assorti des examens complémentaires adaptés. Un examen oculaire bilatéral complet sera réalisé et complété par un bilan hémato-biochimique complet, un examen urinaire, des analyses sérologiques spécifiques et une recherche d’agents par PCR selon le contexte.
Une uvéite peut connaître différentes origines :
exogènes : traumatiques (plaies perforantes notamment) ;
secondaires : à une kératite profonde;
endogènes spécifiques avec des causes infectieuses qui peuvent être virales (FIV, Fel, PIF) ; bactériennes, parasitaires (leishmaniose, mycoplasmes : Bartonella spp., protozoaires : Toxoplama gondii, larva migrans : diptères, nématodes); fongiques (blastomycose, cryptococcose, coccidioïdose, histoplasmose) ;
endogènes non spécifiques (infection de voisinage, infection génitale…) ;
endogènes à médiation immunitaire : infections chroniques ou récidivantes (immunité de type III : PIF notamment), auto-immunitaires (cataracte phaco-induite) ;
idiopathiques ;
néoplasiques : primaires (mélanomes iriens, sarcomes, adénomes et adénocarcinomes ciliaires et iriens par ordre de fréquence décroissante), métastatiques (lymphosarcomes).
La recherche étiologique de l’uvéite s’avère néanmoins infructueuse dans plus de 2/3 des cas selon les auteurs.
Dans l’attente des résultats d’examens, il y a lieu de toujours contrôler très rapidement l’inflammation et stabiliser la barrière hémato-aqueuse : traitement antiinflammatoire non stéroïdien ou stéroïdien à chaque fois que ce dernier est possible, par voie topique et générale, assez longtemps pour éviter les conséquences invalidantes. Le recours à l’atropine est essentiel pour relâcher le spasme du muscle ciliaire. Lors d’uvéite postérieure ou de signes généraux ou nerveux centraux, une antibiothérapie systémique à base de clindamycine est indiquée.
On conclue le plus souvent à une étiologie idopathique lors du diagnostic d’uvéite.
On se retrouve dans un mois avec le Dr Cécile Briffod qui nous parle de l’instabilité du cristallin.
Aujourd’hui on a vu avec Davy que les conjonctivites du chat ne sont pas simples à diagnostiquer et à traiter. Un examen oculaire rigoureux est nécessaire pour identifier la lésion initiale. Les chats peuvent rester toute leur vie porteurs de l'agent causal responsable de leur conjonctivite (comme par exemple l'herpès virus félin FHV-1) ou développer une immunité post-infectieuse trop brève et donc, à l'origine de rechutes et de réinfections fréquentes (exemple de la chlamydiose).
La conjonctive forme une barrière protectrice entre l'environnement et le globe oculaire. Chez le chien comme chez le chat contrairement à l'Homme, elle est très peu exposée, ce qui nécessite une manipulation des paupières lorsqu'on veut examiner le tissu conjonctival.
La conjonctive est fortement vascularisée, ce qui explique la couleur rouge dont elle se teinte lors d'irritation.
Les conjonctivites se définissent comme des inflammations des conjonctives s'accompagnant d'un ou plusieurs autres symptômes qui ne sont pas spécifiques ; épiphora, chemosis, ulcération, hyperhémie, blépharospasme, kératinisation, pigmentation.
L'évolution de l'affection après la mise en place d'un traitement spécifique ou la réalisation d’examens de laboratoire constituent des outils précieux pour le diagnostic.
l'herpèsvirus FHV-1, responsable de la rhinotrachéite féline, est l'agent infectieux le plus souvent rencontré lors de conjonctivites félines infectieuses. La majorité des chats atteints guérissent sans séquelles mais certains pourront souffrir d'une conjonctivite chronique ou récurrente. Des ulcérations conjonctivales peuvent provoquer des adhésions cicatricielles conjonctivo-conjonctivales : on parle de symblépharon.
Une atteinte de la cornée peut être associée à la conjonctivite lors de réactivation virale chez l'adulte. Elle se caractérise par des signes inflammatoires, une néovascularisation, un œdème et une infiltration cellulaire. Des ulcères dendritiques sont quasi pathognomiques d'une infection par l'herpèsvirus qui se propage le long des fibrilles nerveuses ramifiées. S'il atteint les couches stromales profondes, il peut provoquer la nécrose du stroma également appelée séquestre cornéen.
Le traitement de l'herpèsvirose est un traitement de soutien : application d'un gel hydratant et lubrifiant, antibiotique en topique (pour lutter contre les surinfections bactériennes).
On réserve les thérapeutiques antivirales locales ou systémiques aux cas les plus sévères avec atteinte respiratoire supérieure ou ulcères cornéens. Les antiviraux ne font que diminuer la charge virale, améliorant l'état clinique et réduisant l'excrétion virale mais n'éliminent pas le virus de l'organisme.
Des conjonctivites bactériennes sont également possibles chez le chat : chlamydia felis et mycoplasma felis. Le traitement local repose sur l'application de pommade à base de chloramphénicol ou d’oxytétracycline. Même si leur traitement est souvent efficace, les rechutes sont fréquentes à son arrêt. On y associe un traitement général à base de doxycycline (tétracycline) (10 mg/kg/jour pendant 1 mois) ou d'amoxicilline chez les chatons pour éviter les éventuels effets secondaires des tétracyclines.
Tous les chats en contact avec l'animal infecté devront être traités pour éviter le phénomène de réinfection à partir d'un porteur sain (réservoir).
Des causes non infectieuses peuvent engendrer des conjonctivites comme l’entropion, l’agénésie palpébrale et certaines anomalies des annexes de l’œil.
La conjonctivite éosinophilique peut être unilatérale ou bilatérale chez le chat, souvent accompagnée de kératite, et est fréquemment associée à la formation de nodules blancs ou de plaques en surface de la cornée.
Le diagnostic repose sur l'aspect clinique caractéristique et la détection d'éosinophiles à la cytologie conjonctivale. Le traitement repose sur l’utilisation de corticostroïdes topiques ou avec des immunomodulateurs.
En pratique, pour des raisons de coût, des examens complémentaires sont rarement entrepris lors de conjonctivites infectieuses félines : une application de pommade à base de chloramphénicol en première intention est toujours efficace quelle que soit la cause.
S'il est un point à retenir chez le chat, c'est de ne jamais utiliser de pommade à base de corticoïdes en première intention à cause de la fréquence de l’herpèsvirose féline.
On se retrouve dans un mois avec le Dr Guillaume Payen qui nous parlera d’un autre phénomène inflammatoire fréquent chez le chat : les uvéites.
Aujourd’hui on a vu avec Lionel Sebbag que les races de chien à museau court également appelées Brachycéphales sont très populaires partout dans le monde, mais elle présentent de nombreux problèmes de santé en lien avec la conformation de leur tête en particulier. En plus des troubles respiratoires qui sont connus dans ces races, ils présentent un taux préoccupant de troubles de la surface oculaire qui peuvent générer un inconfort chronique qui pourront nécessiter des traitements à vie et aller parfois jusqu’à la perte du globe.
La sélection de sujets hypertypés avec une combinaison de caractéristiques anatomiques et physiologiques ont conduit au développement d’une maladie de la surface oculaire appelée syndromes oculaire des brachycéphales (SOB).
La morphologie de leur crâne entraîne souvent une exophtalmie et une lagophtalmie exposant plus favorablement l’oeil à des traumatismes, des ulcères voire des proptoses. Des variations anatomiques sont également responsables d’enroulement des paupières (entropion), malposition ciliaires et diminution de la sensibilité cornéenne perturbant d’autant plus la stabilité (l’homéostasie) de la surface oculaire. Les brachycéphales semblent développer plus fréquemment que les autres races de nombreuses pathologies de la surface oculaire comme les déficits qualitatifs et quantitatifs lacrymaux, les ulcères de cornée qui pourront se compliquer de pigmentation, fibrose voire même de collagénolyse lorsque la cornée fond sous l’effet d’enzymes sécrétés par des bactéries. On rencontrera fréquemment une pigmentation cornéenne consécutive aux inflammations régulières subies par la cornée. Des pathologies orbitaires comme la luxation de la glande nictitante et la proptose du globe sont également surreprésentées dans ces races.
La législation sur le bien-être animal existe dans de nombreux pays mais, malgré des exceptions, elle n'est pas suffisamment avancée ni suffisamment spécifique pour protéger les races brachycéphales. Les vétérinaires doivent continuer à informer le public des risques liés aux conformations faciales extrêmes mais aussi en gardant le contact avec les éleveurs et les institutions d’état. L’objectif étant de créer des recommandations et des lois pour préserver le bien être animal en réduisant les conformations anatomiques extrêmes chez les chiens brachycéphales.
Un effort général doit être consenti internationalement par les éleveurs, les propriétaires et les vétérinaires afin de réduire la prévalence de cette atteinte et ainsi améliorer la santé oculaire des chiens atteints. Cela passe par la sélection de sujets dont les conformations faciales sont moins prononcées. Les futurs acquéreurs doivent également se méfier car ils pourront s’exposer à adopter un chien qui présentera de nombreux troubles pouvant nuire à sa qualité de vie et aussi générer des soins lourds et onéreux.
Retrouvez la chaîne YouTube sur les gestes techniques en ophtalmologie : https://www.youtube.com/@VetEyeDoctor
On se retrouve dans un mois avec le Dr Davy Biancamaria qui nous parlera des conjonctivites chez le chat.
Aujourd’hui on a vu avec Olivier Thomas que l’œil de son animal peut perdre sa transparence.
La cornée est le hublot de l’œil, elle est transparente car composée de fibres de collagène parallèles entre elles, avec peu de cellules et aucun vaisseau. Ce sont les larmes qui nourrissent la cornée. Deux couches étanches la prennent en sandwich le stroma il s’agit de l’épithélium et l’endothélium. Lors de rupture de la couche de surface de la cornée (l’épithélium) ou de la couche la plus interne (l’endothélium), la cornée va gonfler par hyperhydratation et devenir bleue : c’est l’œdème de cornée.
Des pigmentations mélaniques pourront également recouvrir la surface cornéenne suite à des cicatrisations ou des irritations chroniques dans des races prédisposées comme les brachycéphales ou des phénomènes nécrotiques comme le séquestre cornéen félin.
Des dépôts blanchâtres microcristallins pourront survenir dans le stroma cornéen particulièrement chez le chien dans des races prédisposées.
Il convient de réaliser un examen ophtalmologique complet et attentif permettant d’apprécier la quantité et la qualité de la sécrétion lacrymale, la stabilité de la statique palpébrale, la pression intra oculaire. Lorsque la cornée est totalement opacifiée il faut recourir à l’échographie transcornéenne avec si possible une sonde linéaire à haute fréquence que l’on appliquera sur l’oeil après avoir instillé des anesthésiques topiques. Cette étape est essentielle afin d’objectiver l’état des tissus endoculaires qui peuvent être le siège de réactions inflammatoires ou néoplasiques et ainsi proposer le meilleur traitement pour l’animal.
Le traitement des troubles de la transparence pourra mettre en oeuvre des traitements topiques pour réduire l’inflammation, augmenter la sécrétion lacrymale ou compléter la sécrétion lacrymale et, bien sûr, en traitant le problème initial. Certaines corrections chirurgicales pourront s’avérer nécessaire pour combler les ulcères, modifier la statique palpébrale ou réduire l’ouverture de la fente palpébrale. Des techniques récentes permettront de réduire la pigmentation au long terme comme avec la cryoapplication, la pose d’implants de ciclosporine et le recours aux cellules souches qui est toujours en cours d’investigation chez le chien mais qui a déjà fait ses preuves chez le cheval.
Lors de dégénérescence endothéliale de nouvelles techniques sont désormais disponibles pour limiter le phénomène et améliorer la transparence.
En synthèse changement d’aspect et de transparence de la cornée doit éveiller le doute chez les propriétaires, encore plus si l’animal présente de la douleur. En effet la vitesse de prise en charge conditionnera la possibilité de récupérer de la transparence et donc de la vision...
On se retrouve dans un mois avec le Dr Lionel Sebaag qui nous parelera plus en détail du syndrome oculaire des brachéphales, une pathologie fréquente et fortement sous-évaluée.
Aujourd’hui on a vu avec Franck Ollivier que l’ophtalmologiste vétérinaire est un chirurgien complet qui doit être capable d’intervenir rapidement lorsqu’un ulcère cornéen dégénère. De nombreuses techniques chirurgicales sont disponibles pour combler les lésions ulcératives afin de restaurer la solidité de la cornée, de véhiculer des éléments trophiques vasculaires et d’assurer la meilleure transparence à terme. Lors d’un creusement rapide de la cornée il convient d’intervenir dans les meilleurs délais, il n’est pas rare de devoir faire de heures supplémentaires en fin de journée…
Contrairement à l’ophtalmologie humaine les vétérinaires ne disposent pas de banque de donneurs et on devra s’adapter selon la disponibilité des matériaux. Avant de recourir à une greffe on pourra prescrire des traitements topiques et généraux soutenus et proposer le cross linking. Si après quelques jours la situation ne s’améliore pas, plus le choix, il faudra réaliser une greffe.
Il existe deux grandes familles de greffe selon les matériaux utilisés : il peut s’agir de biomatériaux, on utilise des membranes de collagène d’origine porcine, bovine ou d’autres espèces ainsi que des membranes amniotiques d’origine équine ou humaine. On peut également utiliser des éléments de l’animal que l’on traite directement permettant une intégration souvent très qualitative de la greffe avec une moindre réaction inflammatoire, on parle alors d’autogreffe.
Le choix de la technique dépendra de la profondeur de l’atteinte, de sa surface, de la disponibilité du matériel utilisé et aussi (voire surtout) de l’expérience du vétérinaire. Le suivi revêt une importance capitale dans l’optimisation du résultat final. La modulation de l’inflammation, la complémentation en larmes artificielles et l’instillation d’immunomodulateurs permettront d’améliorer la transparence de l’œil de nos compagnons.
De nouveaux matériaux aux propriétés idéales sont disponibles depuis peu et permettent d’envisager des prises en charges toujours plus qualitatives. La démocratisation des cellules souches laisse également entrevoir un avenir prometteur en ophtalmologie vétérinaire.
On se retrouve dans un mois avec le Dr Olivier Thomas qui nous parlera de transparence de l’œil !eeee
Voici les liens cités dans ce podcast :
Plus d’infos sur les implants SALVO : https://www.youtube.com/watch?v=kjZ9mfY6sUg
Article en accès libre sur l’avenir du traitement du glaucome chez l’animal : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vop.12678
L’électrorétinographie avec son téléphone portable : https://ocuscience.us/products/smarterg-contribution
Les implants non suturés : https://www.youtube.com/watch?v=sJM0zVaHlIc
Synthèse :
Je reviens du VOSM, le congrès du Veterinary Ophthalmology Surgery Meeting à Chicago, et je souhaite partager avec vous les moments forts de cet événement dans cet épisode spécial de l'œil au Clébard.
Le VOSM, créé en 2018, se concentre exclusivement sur la chirurgie en ophtalmologie vétérinaire, avec une participation limitée à 200 inscrits pour favoriser les échanges. Treize nationalités étaient représentées, et j'étais le seul vétérinaire exerçant en France.
Les discussions ont couvert divers aspects pratiques, notamment la chirurgie du glaucome, de la cataracte et la gestion des complications peropératoires. Voici quelques points clés :
Chirurgie du glaucome :
Les shunts sont en plein essor, avec de nouveaux dispositifs comme l’Ahmed, Molteno, Barveldt, Migs, Salvo, et eShunt.
John Sapienza a présenté le SALVO (Brown Glaucoma Implant), combiné à la cyclodestruction laser transclérale. Une deuxième génération utilisant le PEG pour améliorer la biocompatibilité a montré une baisse significative de la PIO.
Lionel Sebbag a introduit le eShunt, un shunt hautement biocompatible utilisant l’evermatrix, réduisant l'hypotonie postopératoire.
Chirurgie de la cataracte :
Rachel Davis a proposé d’utiliser des injections sous-conjonctivales de triamcinolone pour le post-opératoire, avec des résultats prometteurs.
Les avancées technologiques ont amélioré la conception des aiguilles et la gestion des fluides pour réduire l'hypertension postopératoire.
James Rushton a partagé ses expériences avec les pires complications peropératoires, offrant des astuces pour les éviter.
Anesthésie des brachycéphales :
Ces chiens présentent un risque accru de complications peranesthésiques et lors de la phase de réveil.
Il est recommandé d'utiliser des protecteurs gastriques et de gérer le stress avec des sédatifs appropriés.
Chirurgie du mélanocytome limbique :
Stephanie Osinchuk utilise la membrane nictitante pour réparer les brèches après l’exérèse de cette tumeur.
Utilisation des UV-C pour la désinfection :
Lionel Sebbag a présenté un dispositif générant des UV-C pour diminuer les quantités d'antibiotiques nécessaires.
Matériel et technologies :
Des sondes échographiques ophtalmiques sans fil connectables à un smartphone et un ERG adaptable à smartphone ont été présentés.
L'an prochain, le congrès pourrait avoir lieu sur notre continent, avec toujours plus de partage et de nouvelles techniques. J’espère que cet épisode spécial vous aura enthousiasmés et je vous souhaite de très bonnes vacances. N'oubliez pas de partager ce podcast et de vous retrouver en septembre pour une nouvelle saison riche en contenus et en intervenants du monde entier !
Pour la seconde saison du Podcast l’œil au clébard, je vous propose de faire un tour du monde des ophtalmos vétérinaire francophones. Nous allons approfondir les pathologies oculaires, leurs signes d’appel, leur diagnostic, les dernières actualités et l’avenir en matière de prise en charge thérapeutique. On abordera également les particularités de l’ophtalmologie dans d’autres espèces que le chien et le chat ! Je vous retrouve le premier jeudi de chaque mois sur votre plateforme d’écoute préférée dès le 5 septembre prochain.
N’oubliez pas que vous avez déjà les 10 premiers épisodes de la première saison à écouter ou ré-écouter pendant vos vacances et si vous aimez le podcast, partagez-le avec vos collègues, vos amis et même votre famille, je suis sûr que ça pourrait en intéresser plus d’un.
🤓Bertrand Michaud, 👨⚕️Vétérinaire praticien exclusif en Ophtalmologie👀à la Clinique Vétérinaire AnimaVet près de Genève interviewe tous les premiers jeudis du mois ses collègues ophtalmologues vétérinaires. Ensemble, ils échangent sur les principales affections qui peuvent toucher les yeux de nos compagnons🐶🐱🐰.
Un podcast mensuel📻 pour connaître les signes d’appels des maladies oculaires des chiens, chats et autres NAC afin de mieux les gérer au quotidien, que l’on soit propriétaire ou vétérinaire. Vous ne verrez plus jamais votre animal de la même façon après avoir écouté notre podcast sur ses yeux !
Aujourd’hui avec le Dr Isabelle Guerreschi on a parlé des lunettes pour vos animaux.
Comme chez l’homme, des lunettes de protection existent pour les chiens. Elles permettent de prévenir les traumatismes et irritations de l’oeil lors des balades et leur protection solaires protègent l’oeil de votre animal des rayons ultraviolets à condition qu’il accepte de les porter. Les rayonnements UV peuvent induire ou accélérer des maladies de l’oeil chez le chien comme les kératites, les cataractes ou les troubles rétiniens. Le chat peut également être victime du soleil qui peut entraîner des tumeurs des paupières, particulièrement chez les chats à robe claire. Ne pouvant leur faire porter des lunettes vous pouvez appliquer une protection solaire en crème avant qu’il n’aille se prélasser sur son transat !
Il existe des lunettes de vue pour les animaux mais les troubles réfractifs sont rares et ont souvent très peu de conséquences sur la vie de nos compagnons car ils n’appréhendent pas le milieu extérieur de la même façon que nous. Le vétérinaire ophtalmologue pourra évaluer la nécessité d’une correction en réalisant une rétinoscopie de votre animal. Des lentilles sont fréquemment utilisées lors du traitement des troubles cornéens par les vétérinaires ophtalmo mais ils ne s’agît pas de lentilles correctrices, on les appelle des lentilles pansement : elles permettent de protéger l’oeil pendant la durée de cicatrisation de la cornée.
Les lunettes ne sont pas là que pour faire joli elles permettent de prévenir certaines maladies de l’oeil de votre companon. Différents modèles de lunettes de protection existent, n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.
C’était le dernier épisode de la première saison de l’œil au Clébard, on vous souhaite un bel été et on se retrouve le jeudi 5 septembre pour la nouvelle saison !
Vous souhaitez accéder à plus d'informations autour de l'ophtalmologie vétérinaire ?
Rendez-vous sur mon site internet : www.visionanimale.fr
Page Instagram @visionanimale
Page Facebook pour les vétérinaires : échanges sur les cas d'ophtalmologie
Pour les vétérinaires : visualisez des chirurgies d'ophtalmologie sur ma chaîne Youtube
Aujourd’hui on a vu avec le Dr Philippe Durieux que si nos compagnons ont une meilleure vision nocturne que nous ce n’est pas pour rien.
La structure de l’œil de nos animaux de compagnie est très proche du notre. Ils perçoivent par contre le monde différemment. En simplifiant on peut dire que la vision du chien est de moins haute définition que celle de l’homme car cela est lié à son mode de vie : Médor n’a pas vraiment besoin de pouvoir conduire et jouer aux mots croisés, par contre sa vision sera optimisée pour chasser et on n’a pas encore parlé du chat !
Nos compagnons sont bien meilleurs que nous pour détecter le mouvement ainsi que pour s’orienter dans la pénombre : cela provient de la composition de leur rétine en cellules photosensibles ainsi qu’en la présence d’un tapis clair.
Dans la rétine animale il y a, comme chez l’homme, des cônes et des bâtonnets qui permettent de voir respectivement les couleurs et les nuances de gris. Mais l’œil animal concentre beaucoup plus de bâtonnets ce qui les avantage déjà dans la pénombre.
Le tapis clair est une couche de cellules réfléchissantes en arrière de la rétine permettant d’amplifier la lumière, particulièrement la nuit. Elle est extrêmement développée chez les espèces qui ont besoin d’une vision nocturne comme le chat, le chien, les rongeurs ainsi que les herbivores sauvages comme le cerf.
Dans le règne animal seuls certains primates dont l’homme possèdent 3 types de cônes permettant de voir le jaune, le bleu et le rouge. Nos compagnons, eux, ne possèdent pas ce dernier cône ce qui implique qu’ils ne perçoivent pas la couleur rouge et ses nuances comme l’orange et le vert.
Ce qu’il faut comprendre aussi c’est que l’animal appréhende le monde extérieur avec ses autres sens, le chat par exemple ressent les vibrations à l’aide de ses vibrisses, un véritable sonar ; chez le chien c’est surtout l’odorat qui lui permet de s’orienter les yeux fermés.
Des maladies comme le glaucome, la cataracte, la dégénérescence rétinienne ou encore l’hypertension pourront conduire à une perte plus ou moins rapide de la vision de votre animal. Des traitements peuvent être proposés mais comme toujours plus la prise en charge sera précoce, meilleure en sera l’issue.
On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la première saison de l’œil au Clébard. J’accueillerai le Dr Isabelle Guerreschi qui nous parlera des lunettes pour nos animaux parce que ce n’est pas qu’une histoire de style sur la plage pour cet été ou sur les pistes de ski l’hiver !
Vous souhaitez accéder à plus d'informations autour de l'ophtalmologie vétérinaire ?
Rendez-vous sur mon site internet : www.visionanimale.fr
Page Instagram @visionanimale
Page Facebook pour les vétérinaires : échanges sur les cas d'ophtalmologie
Pour les vétérinaires : visualisez des chirurgies d'ophtalmologie sur ma chaîne Youtube
Aujourd’hui on a vu avec le Dr Anaïs Lamoureux que l’œil n’est pas qu’un simple système permettant la vision. Il est un organisme dans l’organisme et interagit avec lui par des relations tissulaires.
Il est à la fois indépendant, isolé et interagit avec les autres organes et qui, par conséquent, reflète toutes les modifications générales.
Toute variation de l’aspect ou de la couleur de l’œil doit motiver une visite chez son vétérinaire qui saura vous orienter.
On a vu que de nombreuses maladies inflammatoires, infectieuses, parasitaires, tumorales voire indéterminées peuvent changer l’aspect interne des yeux, qu’il peut y avoir des saignements endoculaires et qu’un décollement de la rétine peut survenir secondairement à l’hypertension artérielle systémique, principalement chez le chat.
Cette maladie est malheureusement sous diagnostiquée car la mesure de la pression artérielle n’est pas toujours systématisée et compliquée à mettre en œuvre chez le chat qui est souvent stressé en consultation. La réalisation d’un fond d’œil permet simplement de détecter des stades précoces de la maladie et mettre en place un traitement souvent efficace et qui empêchera votre chat de devenir aveugle.
On se retrouve dans un mois pour l’épisode 9, j’aurai le plaisir d’accueillir le Dr Philippe Durieux qui nous expliquera pourquoi mon chat voit mieux que moi, particulièrement la nuit !
Vous souhaitez accéder à plus d'informations autour de l'ophtalmologie vétérinaire ?
Rendez-vous sur mon site internet : www.visionanimale.fr
Page Instagram @visionanimale
Page Facebook pour les vétérinaires : échanges sur les cas d'ophtalmologie
Pour les vétérinaires : visualisez des chirurgies d'ophtalmologie sur ma chaîne Youtube
Aujourd’hui avec le Dr Arnold Lavaud on a vu que nos animaux, comme nous, peuvent présenter une cataracte. Elle correspond à la modification de la structure du cristallin qui est la lentille d’accommodation visuelle située au centre de notre œil. Chez les animaux, le cristallin est plus gros et la capsule qui l’entoure beaucoup plus fragile que chez l’homme. Souvent les propriétaires pourront noter un blanchiment dans l’aire pupillaire de leur compagnon et apprécier des troubles visuels lorsqu’une partie importante du cristallin sera atteinte.
La cataracte peut atteindre les animaux de tout âge, être uni ou bilatérale, elle pourra être héréditaire, traumatique, sénile ou liée à des maladies générales comme le diabète. Le vétérinaire devra distinguer la cataracte d’une sclérose qui est une modification de l’opacité du cristallin avec le temps qui ne perturbe pas le passage de la lumière jusqu’à la rétine. La réalisation d’un examen du fond d’œil permettra de différencier les deux atteintes.
Le traitement de la cataracte est chirurgical et il est conseillé de le réaliser le plus précocement possible par un vétérinaire disposant de l’expérience chirurgicale nécessaire. Contrairement à une idée reçue, il ne faut pas attendre que votre animal soit aveugle pour réaliser l’opération. En effet, si on attend trop longtemps, le cristallin sera plus dur et les risques de complications comme le glaucome ou les uvéites seront majorés.
L’intervention est la même que chez l’homme et consiste à réaliser une phacoémulsification de la partie interne du cristallin en préservant sa capsule. En fin de procédure on pourra mettre en place une lentille intra-oculaire visant à rétablir le rôle optique du cristallin et assurer une vision normale de l’animal.
La chirurgie de la cataracte est un acte bien codifié au pronostic généralement très favorable, pour peu que les examens complémentaires pré opératoires aient été exhaustifs et n’aient pas identifié de facteurs affectant le pronostic. Des complications postopératoires peuvent survenir dans moins de 10% des cas, les plus graves peuvent entraîner une perte définitive de la vision comme le glaucome et le décollement rétinien. Certaines races comme le bichon frisé présentent des taux de complication plus importants que les autres races. Le suivi postopératoire est important et long, il devra être respecté pour limiter les risques de mauvaise évolution.
Nous nous retrouvons le mois prochain avec le Dr Anaïs Lamoureux pour aborder l’ophtalmologie sous l’œil du médecin parce que l’œil de votre animal c’est un peu un hublot sur son organisme.
Vous souhaitez accéder à plus d'informations autour de l'ophtalmologie vétérinaire ?
Rendez-vous sur mon site internet : www.visionanimale.fr
Page Instagram @visionanimale
Page Facebook pour les vétérinaires : échanges sur les cas d'ophtalmologie
Pour les vétérinaires : visualisez des chirurgies d'ophtalmologie sur ma chaîne Youtube
Aujourd’hui on a vu avec le Dr Sophie Cognard que le glaucome n’est pas qu’une simple augmentation de pression mais avant tout une neuropathie optique.
Il atteint particulièrement le chien mais peut affecter toutes les espèces soignées par les vétérinaires.
Il existe différentes causes de glaucome : primaire surtout chez le chien avec des races prédisposées et secondaire chez toutes les espèces animales.
C’est une maladie qui doit être prise en charge en urgence.
Les principaux signes d’appels sont la baisse de vision,, dilatation de la pupille, rougeur, douleur , oedèpme cornée. Il faut confirmer cette suspicion en mesurant la pression de l’oeil.
Le traitement sera établi selon que l’oeil soit encore voyant ou non et pourra faire appel à des traitements médicaux ou chirurgicaux permettant de rétablir une pression normale et assurer un confort à l’animal.
Le diagnostic est souvent tardif par défaut d’information du propriétaire il est important de sensibiliser les possesseurs d’animaux à risque de l’existence de cette pathologie.
On se retrouve au prochain épisode avec le Dr Arnold Lavaux pour parler cataracte parce que les animaux aussi peuvent faire une cataracte.
Vous souhaitez accéder à plus d'informations autour de l'ophtalmologie vétérinaire ?
Rendez-vous sur mon site internet : www.visionanimale.fr
Page Instagram @visionanimale
Page Facebook pour les vétérinaires : échanges sur les cas d'ophtalmologie
Pour les vétérinaires : visualisez des chirurgies d'ophtalmologie sur ma chaîne Youtube
Aujourd’hui on a vu avec le Dr Simon Privat qu’un changement de l’aspect ou de la couleur de l’iris de son chat doit toujours motiver une visite chez un vétérinaire ophtalmologue assez rapidement. Le mélanome diffus est une entité singulière à l’espèce féline et tous les animaux peuvent également présenter des mélanomes.
On peut se baser sur des anciennes photos prises avec son smartphone pour apprécier l’évolution de la surface, de la densité voire du relief des tâches sur l’iris.
Le vétérinaire ophtalmologue fera la distinction entre mélanose et mélanome diffus en s’aidant de différents examens comme l’examen en fente, la macrophotographie, l’échographie ou la biopsie.
Le danger principal est le passage de cellules tumorales dans la circulation générale via l’envahissement de l’angle iridocornéen chez le chat.
En cas de confirmation clinique ou histologique de mélanome diffus de l’iris Il convient de réaliser une énucléation qui pourra être précédée d’un bilan d’extension.
Il ne faut pas perdre de vue que la décision d’enlever un oeil n’est jamais chose aisée et qu’elle est l’unique solution afin d’éviter les complications systémiques.
Le mois prochain nous retrouverons le Dr Sophie Cognard qui nous parlera du glaucome chez l’animal parce qu’eux aussi peuvent monter en pression !
Vous souhaitez accéder à plus d'informations autour de l'ophtalmologie vétérinaire ?
Rendez-vous sur mon site internet : www.visionanimale.fr
Page Instagram @visionanimale
Page Facebook pour les vétérinaires : échanges sur les cas d'ophtalmologie
Pour les vétérinaires : visualisez des chirurgies d'ophtalmologie sur ma chaîne Youtube
Aujourd’hui on a vu avec Aurélie Bourguet que nos animaux peuvent eux aussi devenir aveugle et pas forcément en vieillissant. L’évolution peut être rapide ou lente mais le propriétaire s’en rend souvent compte tardivement ce qui complique la prise en charge thérapeutique.
Le vétérinaire peut réaliser différents examens pour apprécier la vision animale mais aucun test ne permet d’apprécier l’acuité visuelle chez nos compagnons. Les vétérinaires ophtalmos peuvent néanmoins réaliser des examens fonctionnels de la rétine pour apprécier le fonctionnement des cellules qui perçoivent la lumière : les photorécepteurs.
De nombreuses maladies oculaires et extra-oculaires peuvent entraîner une cécité. Ces atteintes peuvent perturber la transparence des milieux de l’oeil empêchant la lumière d’atteindre la rétine, mais elles peuvent également atteindre la rétine via des processus dégénératifs ou hypertensifs. Des maladies générales peuvent rendre aveugle nos compagnons comme le diabète ou l’hypertension artérielle. Enfin des causes dites extra-oculaires peuvent entraîner une perte soudaine de la vue lors d’affections neurologiques centrales par exemple.
La prise en charge de la cécité passe par un dépistage précoce et un traitement étiologique lorsqu’il est possible. Si l’animal ne recouvre pas la vue il pourra s’adapter en développant d’autres sens comme l’odorat et l’ouïe pour compenser la perte de vision. On pourra équiper son animal de systèmes de protection pour éviter les chocs et surtout ne changez jamais l’environnement d’un animal aveugle au risque de le désorienter totalement.
On se retrouve le mois prochain avec le Dr Simon Privat (alias Bodow pour les intimes) qui nous parlera de l’hyperpigmentation irienne chez le chat. Parce que quand votre chat vous jette un regard noir ça peut être dangereux aussi pour lui.
Vous souhaitez accéder à plus d'informations autour de l'ophtalmologie vétérinaire ?
Rendez-vous sur mon site internet : www.visionanimale.fr
Page Instagram @visionanimale
Page Facebook pour les vétérinaires : échanges sur les cas d'ophtalmologie
Pour les vétérinaires : visualisez des chirurgies d'ophtalmologie sur ma chaîne Youtube
Aujourd’hui on a vu avec le Dr Charles Cassagnes que nos animaux peuvent présenter des insuffisances de larmes, on appelle ça une KCS : kérato conjonctivite sèche également appelé syndrome de l’oeil sec.
Contrairement à l’homme, l’animal ne pleure pas par émotion. La KCS se manifeste par un oeil qui devient douloureux, rouge et dont les sécrétions s’épaississent. Elle est beaucoup plus fréquente chez le chien que chez le chat, apparaît le plus souvent après 7 ou 8 ans chez des races prédisposées à museau court comme le Shih-Tzu, le Carlin et le Bouledogue ou de façon congénitale, dès la naissance, chez le Yorkshire Terrier.
Les larmes protègent, nourrissent et défendent la cornée, en cas de déficit des mécanismes inflammatoires conduiront à l’opacification de la cornée pouvant entraîner jusqu’à la perte de vision de votre animal si le problème n’est pas pris en charge suffisament rapidement.
Les larmes c’est essentiellement de l’eau : une phase aqueuse sécrétée par deux glandes lacrymales : la principale au dessus de l’oeil et l’accessoire qui se trouve à la base de la troisième paupière.
Mais il y a également deux interfaces : une muqueuse qui fait le contact avec la cornée et une couche lipidique qui évite l’évaporation des larmes.
En cas de supicion le vétérinaire quantifiera les larmes à l’aide du test de schirmer et évaluera la qualité du film lacrymal.
Le traitement fait appel à des agents mouillants pour hydrater l’oeil ainsi que des molécules immunomodulatrices. En cas de difficultés à appliquer les traitements ou d’inaction des médicaments, on pourra recourir à des interventions chirurgicales.
En prévention, les propriétaires de chien à risque peuvent appliquer des produits lubrifiants vétérinaires, bien nettoyer et entretenir l’oeil de leur compagnon voire leur faire porter des lunettes.
N’hésitez pas à en parler à votre vétérinaire lors de la prochaine visite de votre compagnon, il saura vous conseiller et détecter toute anomalie de l’oeil de votre compagnon.
Le mois prochain je recevrai le Dr Aurélie Bourguet pour aborder le thème de la déficience visuelle chez nos animaux et les solutions que les ophtalmo vétérinaires peuvent leur apporter. Parce que malheureusement un chien guide pour chien aveugle ça n’existe pas...
Vous souhaitez accéder à plus d'informations autour de l'ophtalmologie vétérinaire ?
Rendez-vous sur mon site internet : www.visionanimale.fr
Page Instagram @visionanimale
Page Facebook pour les vétérinaires : échanges sur les cas d'ophtalmologie
Pour les vétérinaires : visualisez des chirurgies d'ophtalmologie sur ma chaîne Youtube