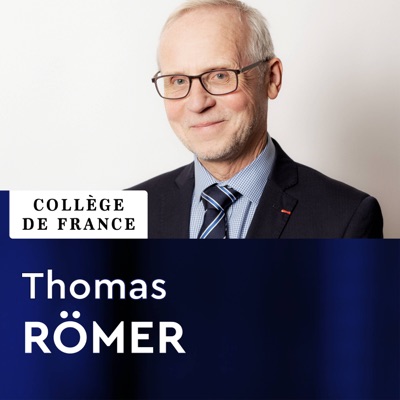
Milieux Bibliques - Thomas Römer
Author: Collège de France
Subscribed: 241Played: 5,798Description
Le titre de la chaire Milieux bibliques souligne le fait que la Bible hébraïque peut et doit être étudiée avec les mêmes méthodes et les mêmes approches que les autres corpus textuels du Proche-Orient ancien. Les études bibliques en France ne sont malheureusement pas très développées à cause d'une certaine compréhension de la laïcité. Durant les recherches des dernières années la nécessité d'une collaboration étroite entre les études philologiques, historiques et archéologiques s'est fait de plus en plus sentir, et l'équipe a renforcé les contacts avec le département d'archéologie de l'université de Tel-Aviv.
La plupart des cours du titulaire de la chaire ont porté sur différents ensembles littéraires qui sont à l'origine de la Torah (du Pentateuque), et donc de la Bible hébraïque : les traditions sur Abraham, le livre de l'Exode, l'histoire de Joseph (Gn 37-50) et le livre des Nombres. Contrairement au modèle traditionnel dit documentaire (toujours en vogue dans de nombreuses universités nord-américaines), il paraît désormais plus que plausible que l'origine du Pentateuque se trouve dans la narration de l'Exode, qui à l'origine a été une tradition du Nord, et qui a été mis par écrit pour la première fois au VIIe siècle avant l'ère chrétienne, dans le royaume de Juda. Des cours récents sur l'histoire de l'Arche ont confirmé cette hypothèse qui est actuellement soumise à vérification dans un cours de synthèse s'étendant sur trois ans : Naissance de la Bible.




