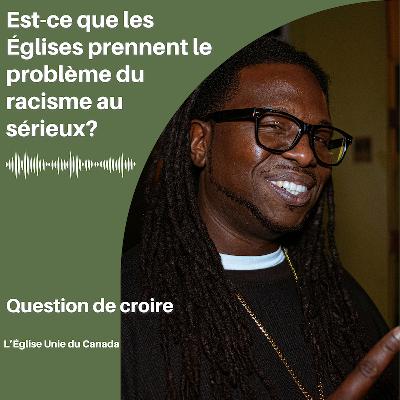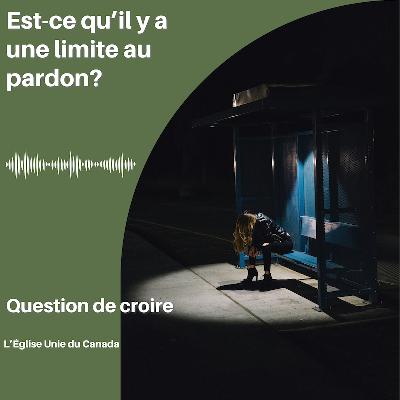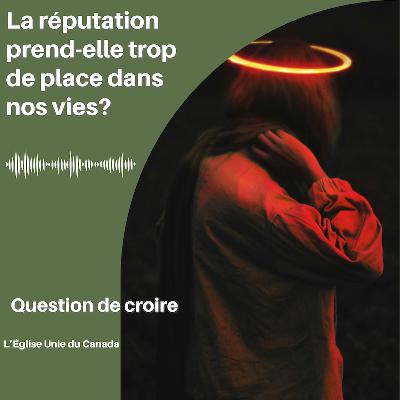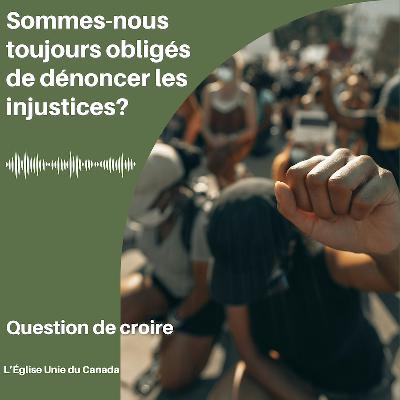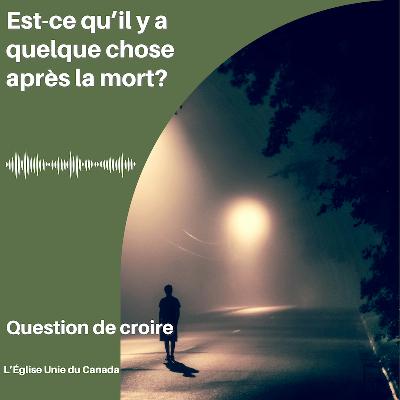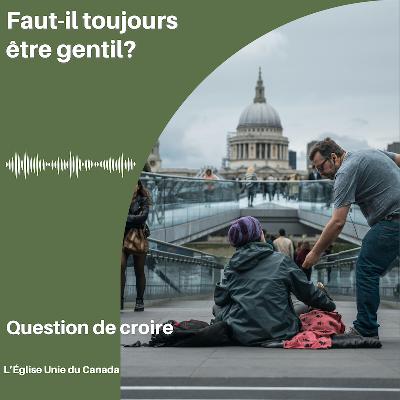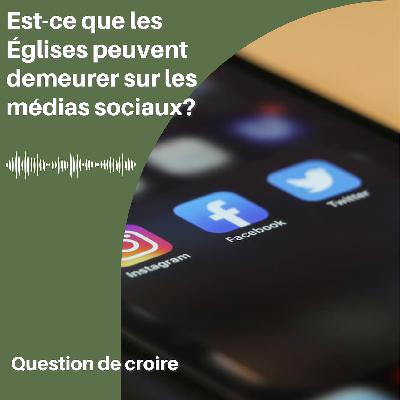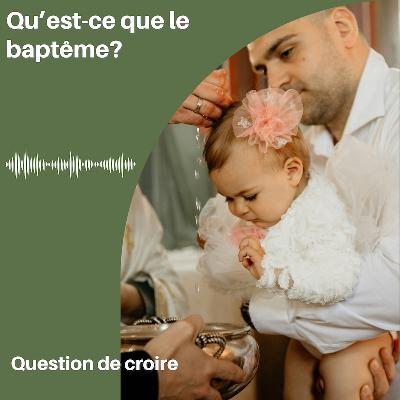Discover Question de croire
Question de croire

Question de croire
Author: Questiondecroire
Subscribed: 7Played: 110Subscribe
Share
© Copyright 2022 All rights reserved.
Description
Une collaboration canado-suisse qui ose questionner la foi et la spiritualité chrétienne de manière ouverte et progressiste. Tous les deux semaines, le révérend Stéphane Vermette d’Ottawa et Joan Charras-Sancho de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) explorent en toute simplicité un thème qui touche la vie de gens.
76 Episodes
Reverse
Est-ce que les Églises prennent le problème du racisme au sérieux?
Le message de Jésus était pour l’ensemble de l’humanité. Alors, pourquoi retrouvons-nous toujours du racisme à l’intérieur de nos Églises? Pourquoi est-ce si difficile de changer ou de voir les choses du point de vue de l’autre?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane partagent des expériences d’inconfort, réfléchissent sur nos biais et discutent de la différence entre racisme et racisme systémique.
Site Internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Réforme: https://www.reforme.net/podcast/
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Brian Lundquist, unsplasch.com. Utilisée avec permission.
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, est-ce que les Églises prennent le problème du racisme au sérieux?
Bonjour Stéphane. Bonjour, Joan, bonjour à toutes les personnes à l'écoute.
Avoir des biais et des préjugés
[Joan] J'ai une anecdote qui me concerne. C'est-à-dire que pour une fois, je me moque de moi-même.
J'avais une réunion avec un collègue et pendant la même réunion, je me suis plainte à un moment donné d'un racisme que je considérais résiduel dans la communauté.
Et à un autre moment de la réunion, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai imité une dame d'un certain âge de la bourgeoisie genevoise. Parce qu'elle m'avait parlé, elle m'avait dit « oh, mais enchantée, très bien, très bien ». Et j'avais bien réussi à l'imiter.
Ils rigolent un peu, puis le collègue me dit « Ce n'est pas raciste ça, d'imiter une vieille dame bourgeoise genevoise ?».
Alors, je ne sais pas. Je suis restée avec cette question, à m'interroger moi-même sur mes propres ressorts un peu racistes, un peu classistes. Est-ce que c'est OK de se moquer des accents bourgeois? Après tout, elle a été élevée comme ça.
Une fois, on avait parlé, toi et moi, et tu m'avais dit, c'est vrai que je suis un mec blanc depuis plus de 50 ans, mais je ne l'ai pas choisi.
C’est vrai que souvent, quand on est bourgeoise et âgée, ce sont des choses qu'on ne choisit pas vraiment. Est-ce qu'on choisit son accent? Est-ce qu'on doit en changer pour avoir l'air moins bourgeoise ou moins française ou moins autre chose? Probablement pas, finalement. Donc voilà, on a nous-mêmes nos propres biais et ça peut être intéressant d'y réfléchir.
La difficulté avec les pasteurs venus d’ailleurs
[Stéphane] C'est vrai que je n'ai pas choisi d'être caucasien. Je n'ai pas choisi de naître en Amérique du Nord. Comme je dis souvent, si j'étais venu au monde au Burkina Faso, ma vie serait complètement différente.
Je crois qu'il y a un peu d'angélisme dans les Églises, dans le sens où on a cette idée que nous sommes une Église universelle, que Jésus accueille tous et toutes et sans distinction. Oui, je suis pas mal convaincu que Jésus-Christ accueille tous et toutes.
Le problème, ce sont les gens dans l'Église… c'est malheureusement une autre chose. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les Églises chrétiennes ont un lourd passé colonial. On envoyait des gens avec un message quand même assez clair, vous allez dans des pays sous-développés, vous allez les sortir de leur culture et religion primitive.
Maintenant qu'il y a ce qu'on appelle une crise de vocation dans nos Églises, nous avons de la difficulté à trouver des pasteurs occidentaux. On se dit bon, on a été évangéliser les gens là-bas, ben ils vont nous renvoyer des pasteurs. C'est un échange de bons procédés.
Et d'un coup, hop, ils sont différents, ils parlent différemment, ils arrivent avec d'autres cultures. Là, ça ne marche pas.
Donc, il y a une espèce de pensée magique que le racisme, la discrimination ou du moins l'inconfort n'existent pas. Ce n'est pas vrai.
Prendre le temps de bien se comprendre
[Joan] J'aime beaucoup que tu parles de l'inconfort. Je trouve ça génial en fait. L'inconfort, c'est ce qu'on ressent tous et toutes lorsqu'on est avec quelqu'un de différent. Et c'est ok de ressentir de l'inconfort.
Quand c'est quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité, c'est une personne qui fait déjà beaucoup d'efforts, ce n'est pas ok de lui montrer notre inconfort en fait. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres endroits où déposer cet inconfort.
Quand c'est quelqu'un qui nous met dans une situation un peu inconfortable, mais qu'elle le fait un peu sciemment et qu'elle le fait depuis une place quand même avec des privilèges, on peut l'interpeller et lui poser la question. Et ça se passe bien souvent.
J'anime une petite page Instagram, trois fois rien, sur le ministère que j'ai la bénédiction de vivre depuis trois mois avec des personnes qui sont en situation migratoire, et pour une partie d’entre eux, qui sont en train de s'installer ici en Suisse.
Et sur cette page Insta, dont je peux donner la référence si les gens nous écrivent, pas de problème, je racontais qu'à la fin d'une entrevue avec une marraine, donc une dame qui va former un tandem avec quelqu'un qui est arrivé depuis pas longtemps en Suisse, à la fin de la conversation, elle me dit « Mais pourquoi vous dites tout le temps “comme dit” ? »
En fait, ça vient de wiegesatack et c'est un alsacisme. En fait, les Alsaciens disent « comme dit » pour dire « comme nous l'avons dit » ou « comme je te l'ai dit » ou « comme ça a été dit ». On dit « comme dit ».
Elle me l'a dit comme ça, un peu à brûle pour point, mais avec un sourire et tellement gentiment. Et elle m'a expliqué qu'en fait, ça faisait une heure que je lui répétais « comme dit », « comme dit », « comme dit ». Et puis moi, je n'en avais pas du tout conscience.
Donc parfois on est un petit peu inconfortable, notamment parce que c'est une expression qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas sûr de suivre le fil de l'autre.
Je me rappelle qu’une fois, je parlais avec un collègue congolais qui s'appelle Moussa et que je salue au passage. Et j'avais besoin d'avoir une réponse à une question. Il me dit « Ah, si, si. Non, non. Voilà! » Voilà, j'avais des réponses, cela dit, mais pas du tout celle que j'attendais.
C’est intéressant, parce que des fois ce n'est pas possible. On n'arrive pas à répondre. Il y a une distance culturelle. La question telle que posée ne correspond à rien, cognitivement, de ce que nous on connaît.
Et si, sinon, on voit là, c'est une façon très polie de dire, voilà, laisse-moi du temps, je n'y suis pas encore, ta question me surprend, je ne la comprends pas. C’est OK aussi de se prendre ce temps-là. Ça peut éviter des réactions racistes, en fait, de se donner du temps.
Le racisme ethnique dans la Bible
[Joan] Par rapport au racisme, il y a eu un avant et un après pour moi dans ma lecture de la Bible. Et c'est quand j'ai compris que Aaron, le frère de Moïse, avait renvoyé dans le désert les femmes étrangères dans une espèce de recherche de purification ethnique.
Vous ne vous marierez pas avec des étrangères parce qu'elles avaient d'autres dieux, elles n'avaient pas un dieu unique ou alors pas le dieu unique tel que le peuple hébreu le comprenait.
J’étais saisie d'horreur et je me suis dit, mais quel racisme horrible de prendre des femmes, d'avoir des relations avec ces femmes, même des enfants, et puis d'un seul coup de leur dire « on ne veut pas de vous, on vous renvoie dans le désert ».
Qu'est-ce qu'elle peut bien devenir, une femme seule ou plusieurs femmes seules dans le désert, parfois avec des bébés sous le bras? Quel est leur avenir en fait?
Je me suis rendu compte que la Bible portait en elle beaucoup d'histoires teintées par ce racisme, ce racisme ethnique, tribal, ce besoin un peu de purification, et tout ça pour honorer Dieu.
C’est dur, après, d'en faire quelque chose, de s'en saisir et de s'en dessaisir, d'être loyale; ça, c'est notre épisode de podcast d'il y a deux semaines. Et en même temps, de ne pas tomber dans une sorte de sectarisme, de racisme, quoi.
Tenter de devenir conscient du problème du racisme
[Stéphane] C'est vrai que les écrits bibliques ne sont pas neutres. C'est l'histoire du peuple de Dieu, donc avec tout ce qu'il y a de plus beau et de moins beau.
C'est sûr qu'on aime bien le passage de Galates, chapitre 3 : « Il n'y a plus de Juifs, ni Grecs; il n'y a plus d'esclaves, ni libres; ni hommes ni femmes. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. » Puis là on dit: “ah que c'est beau”.
Mais lorsqu'on y pense quelques secondes, pourquoi l'auteur a-t-il voulu écrire ça? C'est parce que, probablement, il y avait un problème. Probablement, il y avait des gens qui disaient « Ah, eux, ce sont des Grecs; eux, ce sont des Juifs; puis eux, ce sont juste des esclaves; nous, on est libres. »
Il y a ces problèmes-là qui sont là probablement depuis le début de l'humanité et l'Église n'y échappe pas; il faut en être conscient. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais lorsque l'on devient conscient du problème, on peut y travailler.
L'Église Unie a décidé, il y a quelques années, d’être une église antiraciste. Encore une fois, bravo, mais cette position-là a émergé après que plusieurs personnes aient raconté des histoires vraiment touchantes et très tristes, de racisme et tout ce qui venait avec, de discrimination, de commentaires vraiment pas gentils.
L'Église a pris conscience du problème. Elle n'a pas dit qu’on est meilleur, non ça n'existe pas. L'Église a plutôt décidé de dire, oui, nous avons un problème et nous allons y travailler. Nous allons y faire face. Et c'est ça qui est difficile pour une Église, une paroisse, d'être capable de reconnaître notre problème.
Multi culturalité et interculturalité
[Joan] Tu sais qu'en fait, ce verset de Galates 3, mais tu dois le savoir, en tout cas tu l'as appris dans un de tes cours
Doit-on être loyal à son Église?
La loyauté que nous ressentons envers notre Église doit-elle être plus importante que la liberté d’expression ou l’accomplissement spirituel? Et qui décide si une personne est loyale ou non?
Dans cet épisode Joan et Stéphane abordent la récente situation à Protesinfo, explorent la question de loyauté sur les médias sociaux et se questionnent sur les façons appropriées de critiquer la hiérarchie de son Église.
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, doit-on être loyal à son Église? Bonjour Stéphane. Bonjour, Joan, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
Peut-on visiter les autres Églises tout en demeurant loyal?
[Joan] J'ai une petite anecdote sur cette histoire de la loyauté. Quand j'étais jeune étudiante en théologie à Strasbourg, je me suis rendue dans une communauté, une communauté réformée.
Il y avait là un certain nombre de personnes investies à plusieurs niveaux de l'Église.
Et moi, j'étais à ce moment-là un petit peu comme quand on a 19-20 ans où on s'intéresse aux autres Églises. On s'en va voir à droite, à gauche, et j'avais découvert un peu les Églises pentecôtistes. Il y avait des aspects que je trouvais intéressants dans ces églises, notamment la louange, le groupe de jeunes et tout.
Un peu innocemment, je commence à parler avec des personnes bien plus âgées que moi, tout à fait réformées, de mes petites découvertes dans les assemblées pentecôtistes, et l'une de ces personnes me coupe et me dit « nous on est des réformées, on n'a rien à voir, rien à faire avec les pentecôtistes ».
Alors ça, c'était il y a 25 ans. Je lui ai dit : « quand même, on n'a rien à faire, rien à voir? Ce sont des protestants comme nous! » « bof, pas vraiment, reste loyal à ton Église » m'a-t-on dit.
Ça m'a fait réfléchir un petit peu sur ce qu'est la loyauté. Est-ce qu'on va visiter les autres ou pas? Est-ce que s'intéresser au culte des autres, c'est être déloyal?
Il y a quelques années, j'ai remarqué qu'un certain nombre de ces personnes qui avaient pris aussi des années, et puis d'autres qui n'étaient pas les mêmes, mais qui étaient un petit peu des mêmes milieux s'intéressaient très fortement dans des articles, dans des interviews, dans différentes émissions protestantes, à l'essor des pentecôtistes.
Je vois sur Facebook une publication officielle d’une délégation des Églises luthéro-réformées qui était allée visiter je ne sais quelle grande Église pentecôtisante du côté de Paris. Ils avaient trouvé ça formidable et très intéressant.
Et, semblerait-il, ils allaient apprendre plein de choses de leurs expériences, parce que c'était des assemblées très mélangées, avec tous les âges, et très très vivantes.
C'est intéressant parce que finalement, qu'est-ce que la loyauté là-dedans? Quelle est la différence entre ce que moi j'ai fait il y a 25 ans comme étudiante et ce qui se fait là maintenant?
Et moi je ne l'avais pas fait de façon intéressée ; ce n'était pas parce que mes propres assemblées commençaient à s'amenuiser, c'était vraiment par curiosité.
Donc voilà, qu'est-ce que la loyauté et qu'est-ce qu'on a en nous comme conflit d'intérêts parfois, quand on s'intéresse aux autres, quand on parle des autres, quand on va vers les autres?
Être loyal à quelle Église?
[Stéphane] Comme je l'ai répété souvent, j'ai grandi Catholique Romain et au début de ma vingtaine, j'ai découvert l'Église Unie du Canada et j'ai transféré vers le protestantisme.
Et oui, il y avait chez certaines personnes un peu cette idée que j'avais trahi ou délaissé, un peu comme on délaisse sa mère, son père, sa famille.
Ça n'a pas été : « Ah, tu as trouvé la place que tu recherchais, on va célébrer ça ». Non, c'est « On a perdu quelqu'un ». Comme s'il fallait que je demeure loyal, même si je me sentais inconfortable et pas satisfait dans une institution.
Mais en même temps, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des personnes qui ont provoqué des choses, qui ont remis des choses en question.
En tant que protestant, est-ce que Martin Luther a été loyal à son Église? Certains diront non. Mais de quelle Église parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'Église Catholique romaine? Est-ce qu'on parle de l'Église de Dieu sur terre?
Je comprends que c'est compliqué, je comprends que parfois il y a des notions qui amènent beaucoup d'émotivité.
Lorsque quelqu'un va un peu à l'encontre de l'ordre établi ou de ce à quoi on s'attend, on a l'impression que cette personne-là n'est pas loyale, mais encore une fois, est-ce une question de loyauté ou est-ce qu'une question de vouloir que la personne soit heureuse, se développe, trouve la place où elle devrait être?
La loyauté implique de prendre l’autre au sérieux
[Joan] C'est vrai qu'à titre personnel, je relie un peu la question de la loyauté à celle de l'amour. C'est ce que je dis souvent, parce que moi je suis quelqu'un d'assez... enfin objectif je n’en sais rien, mais j'aime bien que les choses soient bien faites.
Ça m'a amené parfois à être critique envers moi-même, envers ce qui se fait, ce qui se dit. En fait c'est parce que pour moi aimer, c'est prendre l'autre au sérieux.
Prendre l’autre au sérieux, c'est lui dire, écoute, sincèrement, ce que tu as dit, ce que tu as fait là, je ne m'y retrouve pas. Est-ce qu'on peut en discuter? Ou, parfois, poser des limites. Parce que c'est un amour véritable, un amour qui n'est pas dans le faux semblant.
Mais aussi, aimer l'autre, c'est ne pas lui faire de mal. Et c'est là que je comprends aussi qu'être loyale, c'est complexe, parce qu'avec ma perspective, c'est à la fois prendre l’autre au sérieux et ne pas lui faire de mal.
J'aime dire les choses clairement, distinctement, poser mes questions, mais je ne voudrais pas nuire à mon Église. Et ça, c'est très important, je ne voudrais pas nuire aux témoignages de l'Évangile.
En même temps, comme j'aime mon Église, je ne voudrais pas me taire quand les choses ne vont pas bien, que ce soit au niveau global, que ce soit au niveau local. Je trouve que c'est un chemin difficile, c'est une posture assez complexe et il n'y a pas de manuel pour ça. Il y a éventuellement des discussions communes à avoir, mais il n'y a pas de manuel.
Pouvoir être capable de dénoncer son Église
[Stéphane] Je ressens aussi le même tiraillement. Je suis membre d'une Église qui carbure à la justice sociale, des combattants de justice sociale qui dénoncent les riches, dénoncent les puissants. Mais quand c'est notre Église qui semble mal agir ou que j'ai l'impression que les priorités ne sont pas à la bonne place, qu'est-ce que je fais?
L'Église Unie est en période de décroissance administrative. Il y a moins d'employés, il y a moins de dossiers abordés.
Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils croient que tel sujet devrait être plus prioritaire qu'un autre sujet. Est-ce qu'on peut critiquer les choix? Et qui critique-t-on? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que ce sont les personnes?
Je pense qu'il y a une façon de bien identifier les choses. Je n'aime pas la décision que mon Église a prise, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon Église, mais telle décision ou telle personne a fait tel choix et je suis en désaccord.
Un autre exemple, lorsque le projet de loi sur l'aide médicale à mourir au Canada, l'Église Unie a écrit un mémoire. Moi, je ne l'ai pas apprécié, ce mémoire-là; non pas parce qu'il était mauvais, mais je trouvais qu’il ne soulevait peut-être pas les bonnes questions.
Ce qui m'a déçu, c'est que nous sommes une Église. Donc, je pensais que les questions sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie au-delà de la mort, ça, en tant qu'Église, on a quelque chose à contribuer d'assez unique. Ça n'a pas été fait.
J'ai manifesté ce désaccord-là avec certaines personnes. Je ne suis pas monté sur la place publique, déchiré ma chemise et dire que l'Église était conne. Mais je pense que j'ai trouvé moyen d'expliquer d'où venait mon désaccord.
Je ne pense pas que j'ai manqué de loyauté en disant : « Je pense que vous avez, de mon point de vue, manqué votre cible ».
Le cas de Protestinfo
[Joan] Manquer sa cible, ça nous arrive assez souvent en Église. Et là, ces derniers temps, en Suisse romande, les Églises réformées romandes ont été un peu placées sous les feux des projecteurs, puisque ce qu'on appelait avant la conférence des Églises romandes, qui vient de changer de nom, finance normalement une agence de presse, qui s'appelait à ce moment-là Protestinfo.
C'est intéressant parce que c'est beau que depuis 25 ans des Églises aient une agence de presse. Une agence de presse, ça signifie qu'on fait des articles sur des sujets, puis qu'après on peut les vendre à des journaux cantonaux, à différents titres qui existent déjà, Le Temps, 24 Heures et plein d'autres.
C'est beau comme idée, comme philosophie, c'est ambitieux aussi. Ça veut dire que ce sont des articles qui doivent pouvoir intéresser le grand public. Donc forcément des articles dans lesquels il peut y avoir un regard critique, des questionnements.
Comment se joue la loyauté envers l'Église dans ces cas-là ? C'est un petit peu de tout ça dont les gros titres ont beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'évidemment, dans le milieu de la presse, quand on licencie deux journalistes, les deux journalistes responsables de cette agence de presse, les collègues se demandent pourquoi. Il y a ces questions de liberté de la presse.
Et d'un autre côté, il y a la question de la loyauté à l'Église. Est-ce que quand on est financé par l'Église, on peut faire les enquêtes, les investigations de la même façon que quand on est indépendant par rapport à cette Église?
Est-ce qu'on peut faire le métier de journaliste de la même façon ou pas, sachant qu'il y a cette loyauté implicite et sachant aussi que c'est un petit milieu. Quand on va interroger A qui connaît B et qui est marié à C, (puis, je plaisante,) mais qui es
Le pardon est à la base du christianisme. Cependant, ce pardon est difficile à accorder. Est-ce qu’il y a des choses impardonnables?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane explorent la différence entre la saine vigilance et la possibilité de changement, et abordent les limites que nous nous imposons.
Site Internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Réforme: https://www.reforme.net/podcast/
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Edwin Andrade, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, est-ce qu'il y a une limite au pardon?
Bonne question et bonjour Stéphane! Bonjour Joan, bonjour aux gens qui nous s'écoutent!
Le pardon et Sodome et Gomorrhe
[Joan] Cette notion du pardon... Elle traverse un peu toute la Bible, elle culmine avec Jésus qui est un grand maître.
J'aime beaucoup une histoire biblique à ce sujet concernant la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est vrai que l’on connaît un peu Sodome et Gomorrhe via des exégèses souvent biaisées qui disent que ce sont des villes où on pratiquait l'homosexualité.
Alors tout de suite, je fais mon standing point. On y pratique beaucoup de choses, mais surtout pas le consentement ni l'hospitalité.
C'est vraiment ça le cœur du propos, finalement, et aussi le cœur de la condamnation de Dieu qui se dit « je vais exterminer cette ville ».
Et puis Abraham négocie.
C'est rigolo parce que là, on est dans une histoire biblique, on dirait presque un midrash, une histoire un peu parallèle qui explique la Bible; mais non, c'est une histoire biblique. Et Abraham négocie avec Dieu. C'est à lire, comme passage c'est un peu croustillant. À mettre en scène avec des jeunes, c'est assez rigolo.
Finalement, Dieu demande qu'il y ait au moins 50 justes, 50 personnes qui suivent les voies du Seigneur, qui probablement pratiquent l'hospitalité et font gaffe aux questions de consentement, ou en tout cas à ce qui existait à l'époque en matière de consentement.
On ne sait pas trop ce que c'est, ce n'est pas tout à fait comparable à aujourd'hui, mais c’est un respect des règles, tout simplement, quelque chose qui n’est pas tout le temps de l'ordre de la domination et du pouvoir.
Finalement, ils arrivent ensemble à un chiffre qui est 10. C'est un chiffre symbolique parce que dans la tradition juive, il faut 10 hommes pour minian, pour faire la prière, donc pour faire éclore un petit peu quelque chose du royaume de Dieu dans notre quotidien.
C'est vrai que c'est un peu aussi ma compréhension du pardon, c'est-à-dire oui, je suis prêt à pardonner à cette ville, dit Dieu, mais à condition qu'il y ait un semblant de justesse et de justice et qu'il y ait des personnes pour l'incarner. Et moi, c'est un petit peu comme ça que j'aborde les questions de pardon.
Souvent on pose des questions. Il y a quelques jours, et c'est un petit peu à elle que je pense, j'ai une amie d'enfance qui sort d'une situation dans laquelle elle ne s'est pas sentie respectée, une situation sentimentale, amoureuse; elle me dit, qu'est-ce que tu penses du pardon dans ces cas-là, quand tu te n'es pas sentie respectée dans une relation?
Alors voilà, on a commencé une discussion et je lui dédie aussi un petit peu cet épisode de podcast.
Je me dis souvent que ce qui n'est pas tellement important, c'est que moi j'ai pardonné, bien que si ça fait du bien à l'autre, je veux bien me mettre en chemin.
L’important, c'est qu'après cette demande de pardon et le fait de poser les choses à plat, il y ait une vraie possibilité d'agir avec justesse. Pour moi, demander pardon à quelqu'un et puis ensuite recommencer cinq minutes après à faire n'importe quoi, il n'y a pas de sens à ce type de pardon.
La sincérité des hommes politiques
[Stéphane] C'est très intéressant, cette notion de pardon, parce qu'on a un peu l'impression qu'il faut absolument pardonner, peut-être par les enseignements qu'on a reçus, peut-être par notre jeunesse. Moi j'ai souvent vécu ça. Plusieurs personnes à l'écoute ont vécu ça ou ont vu ça.
Deux enfants se chamaillent, puis là, l'adulte intervient. Bon, vous allez arrêter tout ça et serrez-vous la main, puis c'est terminé. Un peu comme c'est tout. Voilà, vous vous êtes serré la main, c'est pardonné, on oublie, on passe à autre chose. Il y a comme quelque chose qu'on croit magique.
Ça me fait penser aussi à l'homme politique qui se fait prendre la main dans le sac, peu importe la situation. Il arrive sur la place publique, je m'excuse, bla bla bla, je suis désolé. Et on se pose la question, mais est-ce que c'est sincère?
Je pense qu'il y a une question de crédibilité reliée au pardon. Lorsque les personnes présentent leurs excuses, bon, c'est bien, je veux bien. Mais est-ce que, parce que tu t'es fait coincer, tu te sens mal et tu veux que je te pardonne, ou vraiment il y a une réflexion de dire « ce n'est peut-être pas la meilleure chose que j'ai faite et c'est vrai que je veux changer. »
Laisser une porte ouverte en cas de conflit
[Joan] Il me semble que, sauf cas de personne manipulatrice, on le sent, on l'entend, on le sait lorsqu'il y a une vraie réflexion.
Moi j'ai une politique personnelle sur le pardon avec mes amis. Je me dis, la vie est compliquée, mais elle est aussi longue. Et c'est vrai, on en a parlé dans l'épisode précédent, des fois on finit par se retrouver pour des raisons XY, de déménagement, de situation de vie.
Alors souvent j'essaye, quand on a un désaccord, (j'ai 45 ans, il y a eu des gens avec qui j'ai eu des désaccords, des gens proches), j'essaye de refuser qu'on se quitte avec des griefs. Je me dis, parlons-en, disons-nous les choses.
Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quelqu'un que j'aimais beaucoup dans ma vie, qui avait une grande place. Et voilà, on arrive à un point où notre relation n'était plus la même. Il ne s'agit pas de mon mari. Je me suis dit : il faut boucler cette boucle et le dire franchement. Et se dire aussi, peut-être qu'un jour, on arrivera à dépasser certaines choses et à vivre encore d'autres choses.
Disons que, sauf cas extrême, la porte reste toujours ouverte. C'est un petit peu comme ça que je gère mon rapport au pardon. Mais après, il y a la question du cas extrême. Et donc, on arrive à cette question de la limite.
La nomination controversée de l’archevêché de Toulouse
[Stéphane] C'est très pertinent parce que, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner? Ce que moi, je considère qu'on ne peut pas pardonner, ce n'est pas la même ligne normalement que la tienne, Joan, ni qu'une personne qui est à notre écoute. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Oui, il y a des systèmes de loi lorsqu'il y a des crimes. Bon, c'est bien. Lorsqu'on parle de choses peut-être un peu plus émotives, lorsqu'on sent une trahison.
Un exemple, et c'est un peu cette histoire-là qui m'a inspiré, moi, pour qu'on traite ce sujet, c'est le cas de l'archevêché de Toulouse. Certaines des personnes à l'écoute connaissent les faits, mais juste au cas où.
L'archevêque Mgr Guy de Kerimel a nommé une personne, je ne dirai pas son nom, mais c'est public si vous voulez aller le chercher, dans une position quand même assez importante au niveau de l'archevêché. Le truc, c'est que cette personne-là, il y a environ 30 ans, a été reconnue coupable d'agressions sexuelles sur mineurs – ce ne sont pas juste des accusations comme ça –.
Ça a créé une réaction épidermique. On le comprend après toutes ces années de scandales et surtout de mensonges et de dissimulation pendant des décennies, voire des siècles. Ce n'est pas surprenant.
La question est : une fois que la personne a payé entre guillemets sa dette à la société, est-ce qu'elle peut être réintégrée ou non? C'est très difficile et je ne prends pas parti pour l’un ou pour l'autre, je constate juste de l'extérieur que c'est très difficile de tirer une ligne.
Peut-on pardonner à un pédo-criminel
[Joan] Écoute, je salue ta neutralité canadienne qui rejoint d'ailleurs la neutralité suisse. Moi, sur les questions de pédocriminalité, je refuse l'angélisme. En fait, je me suis beaucoup renseignée.
D'abord, je viens d'une famille de travailleurs et travailleuses sociaux, donc ce sont des sujets avec lesquels j'ai grandi. J'ai aussi vu malheureusement des petites victimes qui ont été hébergées par mes parents. Sans entrer dans les détails, je me figure tout à fait les ravages que ça fait sur les enfants et les jeunes, les actes de pédocriminalité.
Pour moi, un pédocriminel récidiviste, je ne parle pas nécessairement d'un gamin de 16 ans qui découvre sa sexualité et qui fait des choses criminelles avec quelqu'un de plus jeune de sa famille. Après, on lui explique les choses, il est suivi, il comprend la portée de son acte, peut-être qu'il a reproduit quelque chose qu'il a subi. Des fois, il peut y avoir des situations où, pédagogiquement, on peut reprendre les choses, on peut les encadrer, on peut les surveiller.
Je parle vraiment de quelqu'un d'adulte et de criminel récidiviste qui est prédateur, donc qui fait des plans. Je connais cette situation de très près, puisque ma deuxième fille a malheureusement été suivie par un prédateur comme ça, donc c'est tout un état d'esprit.
J'estime que quelqu'un comme ça, qui a développé maintenant ce type d'approche de prédation, de criminalité et de sexualité, n'a pas été pardonné de ses péchés, dans le sens où il a une pathologie. C'est pathologique là maintenant, c'est quelque chose dont il ne pourra plus se séparer, dans l'état des soins actuels.
Donc, comme il va toujours finir par faire du mal à une personne plus faible
Qu’est-ce qu’un ennemi? Au-delà de notre appel à aimer nos ennemis selon l’Évangile, est-ce possible d’offrir cet amour sans exception? Comment pouvons-nous déterminer qui sont ces ennemis dans notre monde polarisé?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane réfléchissent sur la notion d’ennemis et essaient de comprendre pourquoi nous réagissons si fortement envers certaines personnes.
Site Internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Réforme: https://www.reforme.net/podcast/
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Chris Henry, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, doit-on aimer tous nos ennemis?
Bonjour Stéphane. Bonjour Joan. Bonjour à toutes les personnes qui sont à l'écoute.
Parfois nos ennemis sont plus proches que l’on croit
[Joan] J'aime bien le fait qu'on ose aborder cette thématique des ennemis et de l'amour des ennemis, parce que je pense que c'est vraiment une thématique un peu taboue, dans le sens où on est toujours capable de faire de grandes déclarations quand on prêche ou bien dans nos prières.
Et puis, il y a un peu concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Et ça me fait penser à une petite anecdote.
J'avais sur Facebook un de mes contacts, un pasteur, qui n'est pas Suisse, qui vient d'ailleurs, donc pas l'un de mes collègues actuels, ni d'ailleurs des années passées, avec qui régulièrement on débattait, on n'était vraiment pas d'accord sur la question de l'égalité des droits pour le mariage.
Ça m'a occupé un certain nombre d'années, comme vous aurez fini, auditrice, auditeur, par le comprendre.
En fait, il en venait à être un petit peu obsessionnel à mon sujet, c'est-à-dire qu'il allait commenter partout, même sur des trucs qui ne concernaient pas le sujet. Il s'intéressait un peu à tout ce que je faisais en annexe, par exemple professionnellement, en dehors de cette question.
Il aimait bien un petit peu me faire sentir qu'il me surveillait. Puis je racontais ça à une copine qui m'a dit : « Écoute, avec des ennemis comme ça, pas besoin d'amis! Si tu n’es pas bien, tu fais un malaise, il sera mieux que tes amis où tu te trouves! »
L’obligation d’aimer nos ennemis
[Stéphane] C'est vrai que c'est un enjeu difficile. Même lorsqu'on a discuté de ce thème-là, on a eu une conversation par messagerie parce que c'était de bien définir la question. Parce qu'au début, la question était « faut-il aimer tous nos ennemis? » Moi, j'ai amené « Doit-on aimer tous nos ennemis? »
Et c'était plus qu'une question de jouer sur les mots, parce que pour moi, il faut... c'est une invitation, c'est un rêve, par exemple. Il faut que je perde 15 kilos. Bon, oui, ce serait bien, mais fort probablement, ça n'arrivera pas.
Doit-on? Là, il y a une obligation. Là, il y a quelque chose de plus sérieux. On doit prendre telle médication lorsqu'on est malade? Ben oui, là, il faut.
Cette question « doit-on », est-ce une obligation dans tous les cas? Parce que ça va, comme tu as dit, au-delà des bonnes intentions.
Jésus nous a dit qu'il faut aimer nos ennemis. Oui, bon, c'est bien. On entend ça le dimanche matin. Mais lorsqu'on est justement confronté à cette réalité-là, ouf! Là, c'est difficile et ça nous emmène dans des zones très inconfortables.
Nos ennemis sont-ils déterminés par nos relations?
[Joan] Il m'est arrivé autre chose sur les médias sociaux, il y a aussi un paquet d'années. Maintenant, je suis beaucoup moins sur Facebook. Enfin, je n'y suis plus, pour ainsi dire.
Et puis Instagram, je fais comme tout le monde, je partage quelques photos, limite de chatons mignons. J'ai eu ma période plus politisée. Là, maintenant, j'ai une période plus pastorale, disons presque de rue, en tout cas de proximité. Et c'est OK, il y a plusieurs saisons dans la vie.
Et un jour, j'ai eu un désaccord super fort avec un ami Facebook, qui en plus était un peu un compagnon de lutte, un collègue, un pasteur, aussi pas en Suisse, puisqu'à ce moment-là, je n'exerçais pas en Suisse.
Et en fait, il avait affiché mon père, c'est-à-dire qu'il était allé regarder qui avait liké le profil de tel ou tel homme politique.
Et il se trouve que mon père, pour des raisons qui lui appartiennent, avait suivi je ne sais quel homme politique un peu controversé de ce moment-là, la grande famille gauchiste, et il avait fait une capture d'écran, ce collègue, et il avait affiché mon père et d'autres.
Il avait écrit « Les amis de mes amis sont-ils mes amis? Car là, ce sont mes ennemis. Du coup, si mon ami est ami avec mes ennemis, deviennent-ils mes amis ou mon ami devient-il un ennemi? »
Et là, ça pose plein de questions, c'est-à-dire est-ce que mon amitié se base sur ce que toi tu aimes et tu préfères seulement, sur tes goûts, sur tes choix politiques ou de follower quelqu'un sur des médias sociaux.
Ça pose des questions assez profondes. Sur quoi est-ce que je base mon amitié ?
Et du coup, sur quoi est-ce que je base mon inimitié aussi ? Et du coup, ça pose la question de qui est mon ennemi ? Et ça, ce sont des questions qu'on n'ose pas trop souvent se poser.
Et pourtant, c'est des questions qui intéressent Jésus.
Les ennemis à l’époque de Charlie Kirk
[Stéphane] C'est vrai que c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un ennemi?
Tout le monde le sait (toi, moi, les gens de notre écoute), on vit dans un monde tellement polarisé. Tu es d'accord avec moi, tu es mon ami. Tu as un désaccord avec moi, tu es un ennemi.
J'ai l'impression qu'on jette ça un peu à la légère, dans le sens où on ne réfléchit pas avant de déclarer quelqu'un notre ennemi, mais en même temps, c'est très lourd de dire que cette personne est un ennemi.
On aborde ce sujet-là dans un moment très stressant en Amérique du Nord, probablement dans le reste du monde, parce qu'aux États-Unis il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk il n'y a pas si longtemps (au moment où ce qu'on enregistre).
Et on voit là les appels de la classe politique à l'élimination de l'opposition. Les mots sont chargés, c'est exacerbé.
Il y a quelques jours, un animateur de talk-show assez célèbre a perdu son émission, du jour au lendemain, à cause des pressions politiques, parce qu'il avait fait un commentaire un peu limite, mais rien vraiment de très grave.
Et c'est ça. Soit on rentre dans le rang, on est les bonnes personnes, si on ne rentre pas dans le rang, on est dans la case de l'ennemi, on est dans ce qu'il faut abolir, ce qu'il faut éliminer, on n'a aucune valeur intéressante.
C'est très difficile et c'est très stressant parce qu'on peut décider de dire : « bon moi j'y vais au minimum, je ne m'exprime pas, en tout cas pas en public ».
Mais lorsqu'on a un peu de courage, lorsqu'on a un peu de conviction, lorsqu'on veut changer les choses, on se met un peu la tête sur le billot, on ne sait jamais comment ça va revirer la décision d'un, la décision de l'autre.
Donc toute cette notion d'ennemi est tellement chargée dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
L’importance d’être en désaccord de Paul Ricoeur
[Joan] Je pense aux modalités pour être de bons ennemis. J'ai réfléchi à ça. Je me suis dit en fait, on nous enseigne souvent à être de bons amis depuis qu'on est petit. Fais-toi des amis. Traite bien tes amis. Elle, c'est ton amie. Lui, c'est ton ami. On est de meilleurs amis. On parle des besties maintenant. Mais je me dis, il y a peut-être des modalités pour être de bons ennemis.
Puis, je me suis un peu tournée vers Paul Ricoeur. Alors voilà, Paul Ricoeur, je suis comme tout le monde. Moi, je lis des extraits, je lis des résumés, j'écoute des podcasts. Je lis rarement ses bouquins de A à Z. Je rassure tout le monde. Ça reste une écriture fine, nuancée, et parfois on en a besoin.
Paul Ricoeur rappelle souvent, c'est que dans la question du dialogue, il y a la question de l'interprétation. Et souvent, nos conflits sont liés à des interprétations de textes, de symboles, de l'autre.
C'est pour ça qu'il prend une distance, Ricoeur, en disant que ces conflits doivent être traités par l'herméneutique, c'est-à-dire justement par l'interprétation, mais consciente, la médiation, la traduction, la compréhension. La meilleure façon d'avoir de bons ennemis, d'entretenir quand même de bons rapports avec ses ennemis, c'est d'éviter l'imposition. L'imposition en disant à l'autre : « mais non, tu devrais penser ça ».
C'est vrai que c'est un petit peu quelque chose qui me frappe dans ces temps de polarisation, en ces temps où il y a un génocide qui est documenté en direct. Maintenant, l'ONU a déclaré que quatre des cinq critères sont réunis pour déclarer un génocide. Je trouve que quand il y a des outils d'analyse, c'est important de les prendre en compte et de les respecter. Ce génocide est documenté en direct. Il y a d'autres génocides en cours. Il y a le Soudan… On va faire la liste, on va être déprimés.
Celui-ci est documenté en direct, et on a l'impression qu'on peut agir nous aussi en direct, puisque finalement, c'est documenté en direct. Mais en fait, non. En fait, on ne peut pas faire grand-chose.
Souvent les conflits nous échappent à nous en tant qu'individus. Si le gouvernement de certains pays n'a pas bougé avant, c'est sûrement pour des raisons qui nous échappent aussi.
Et comme ce conflit est documenté en direct, on demande aux gens, on leur impose maintenant lorsqu'il y a des tables rondes, lorsqu'il y a des débats, de faire un statement, de faire une déclaration sur Gaza. Ça va tout à fait à l'encontre de tout ce que nous offre Paul Ricoeur comme outil d'analyse pour être des bons ennemis, pour être en désaccord.
Ce qu'il propose, Ricoeur, c'est de laisser une place à l'autre,
Que penser de la théologie de la prospérité?
La théologie de la prospérité promet des récompenses matérielles aux personnes professant la bonne foi. Cependant, plusieurs pasteurs l’utilisent pour s’enrichir ou faire grandir leur communauté. Plusieurs histoires de la Bible et de Jésus nous enseignent une relation plus éthique avec l’argent.
Dans cet épisode, Joan et Stéphane réfléchissent sur la notion du partage de la richesse et se demandent qui profite de cette prospérité.
Site Internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Réfome: https://www.reforme.net/podcast/
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Alexander Schimmeck, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Bonjour! Bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine : que penser de la théologie de la prospérité?
Bonjour! Bonjour, Joan, bonjour à toutes les personnes qui sont à l'écoute
Comment utiliser la prospérité pour faire grandir une paroisse
[Joan] Ce qui est marrant avec cette théologie de la prospérité c'est que j'en ai entendu parler depuis le début de mes études en fait donc on peut dire fin années 90.
Il y a l'un de nos professeurs, André Birmelé, très grand systématicien, qui a vraiment consacré sa vie aux dialogues bilatéraux et œcuméniques, entre Églises, entre œuvres, qui a travaillé au sein de la Fédération luthérienne mondiale, enfin voilà.
Il a vraiment consacré sa vie aux dialogues entre les Églises en fait. Il a cru en cette paix de l'église universelle.
Un jour, il avait je ne sais quelle assemblée, je ne sais où, et donc on leur a dit est-ce que vous êtes intéressé de connaître un peu les réalités des gens sur le terrain? Quelles sont les Églises en croissance?
Et puis il est parti avec, je les imagine un petit peu des délégués qui viennent d'un peu partout, pas que d'Europe ni d'Occident d'ailleurs.
Et puis je les imagine dans leur petit bus en train d'aller voir dans je ne sais quelle banlieue, je ne sais quelle Église.
Et là, il y a un pasteur qui très, très, très, mais alors très fièrement, leur a dit de toute façon, vous ne savez pas faire en Europe ou en Occident, vous ne savez pas comment faire pour avoir de la croissance d'Église.
Ah bon? Ils ont été très intéressés. Que faut-il donc faire?
Il dit, ce qu'il faut faire, c'est que tu pries avec ta communauté et tu demandes qui a faim et tu demandes qui n'a plus rien sur le compte ou qui n'a plus d'argent dans la poche.
Et tu as une équipe qui repère qui sont les personnes. Et le lendemain, tu leur fais déposer des sachets de courses.
Et le dimanche d'après, tu dis, qui avait faim et a été nourri? Qui a eu de l'argent alors qu'ils n'avaient plus rien dans la poche?
Vous, vous, vous? C'est Dieu qui vous a bénis. C'est parce que vous êtes venus à l'église prier.
Et maintenant que vous avez été bénis, pensez bien à bénir les autres. Et d'ailleurs, il y a une collecte à la fin.
C'est un vrai travail d'équipe quand tu écoutes ça, c'est bien organisé comme affaire.
Il faut que tu aies des gens qui repèrent, qui notent où habitent les gens, d'autres qui aillent faire des courses, d'autres encore qui déposent des courses de façon discrète sans se faire voir.
Comment je dois dire, une sacrée logistique. J'ai de l'admiration pour cette logistique.
Mais ce qui me faisait marrer, c'est le décalage entre André Birmelé, quelqu'un qui connaît très bien sa Bible, les écrits symboliques, qui a beaucoup travaillé théologiquement, qui s'est donné du mal pour créer tous ces accords et ces liens entre Églises, et puis le pasteur de je-ne-sais-où qui a trouvé une espèce d'esbroufe, comme on dit en français de France.
C'est une espèce d'esbroufe pour tout simplement tromper son monde, mais qui en est très fier, très, très fier.
Voilà, théologie de la prospérité, il y a une petite part de manipulation, je crois qu'on peut le dire.
Une théologie qui récompense matériellement les bons croyants
[Stéphane] Je dois avouer que ce n'était pas sur mon radar. Par exemple, lors de mes études en théologie, on n'en a jamais parlé.
Même lorsqu'on aborde les différents courants théologiques ou les différentes manières d'être l'Église, ce n'était pas là.
Mais j'ai reçu cet été un courriel d'un auditeur qui, justement, me posait des questions là-dessus. Et il me dit « Ah, ce serait bien de faire un épisode. »
Et en réfléchissant, il y a plein de choses qui me sont revenues en mémoire.
Par exemple, dans les années 70-80 (1970-1980), tous ces télévangélistes américains et leurs émissions hebdomadaires où on voyait le pasteur, l'épouse et les enfants. Ils étaient très beaux, très belles images et qui invitaient les gens à donner.
Tout ce courant-là qui existe en Amérique du Nord depuis quand même assez longtemps, qui est encore visible aujourd'hui, ça a pris d'autres formes et on dirait que, pour certains d'entre nous, peut-être qu'on fait une blague comme ça, mais on fait presque semblant que ça n'existe pas.
Et pourtant, il y en a plusieurs.
Ce n'est pas que c'est la majorité, mais il y a quand même plusieurs paroisses, plusieurs pasteurs qui sont dans cette mouvance-là, qu’ils y croient, qu’ils n'y croient pas, on pourra toujours en débattre, mais qui font la promotion de cette idée-là que Dieu récompense financièrement ou sur le plan matériel les bons croyants, les bonnes croyantes.
C'est quand même quelque chose.
Le décalage entre Jésus et l’argent
[Joan] Alors, moi, ce qui me frappe dans la théologie de la prospérité, c'est que c'est une théologie qui se veut vraiment très littérale, avec une lecture de la Bible, comment est-ce qu'on pourrait dire, très soigneuse.
Mais, il me semble que le péché le plus abordé dans la Bible, c'est l'argent. L'argent mal gagné, l'argent non partagé, l'argent qui passe avant le reste.
Il me semble que Jésus, en ce sens, est exemplaire.
Il y a vraiment plein d'aspects de la vie de Jésus qui, moi, me frustrent parce que je ne sais pas comment, quel genre de mari c'était.
J'aimerais bien savoir s'il était végétarien ou pas. On sait qu'il mangeait du poisson, donc il n'était pas végétarien. Il y a vraiment plein de choses que j'aimerais savoir à propos de Jésus.
Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il avait un rapport très détaché aux biens matériaux, qu'il était vraiment très peu dans le matériel, très peu dans l'argent et qu'il était assez dur en fait envers les personnes qui voulaient amasser de l'argent, qui ne voulaient pas partager de l'argent, qui n'avaient pas un moyen, comment est-ce qu'on pourrait dire, éthique de gagner de l'argent.
Et donc j'ai vraiment beaucoup de peine à comprendre comment est-ce qu'on peut être pasteur dans le sens comme moi je l'entends, et puis avoir ce rapport tellement obsessionnel avec l'argent.
Et puis comme tu dis, d'utiliser en plus le visuel, le paraître pour obtenir de l'argent, ma petite famille, mon petit machin, la plus belle image télé, le plus beau setting.
Je ne sais pas, pour moi il y a un énorme décalage et du coup, ce qui m'interroge le plus, c'est qu'est-ce que les personnes recherchent là-dedans?
Vouloir croire malgré les signes contraires
[Stéphane] En anglais, on a cette expression « suspension of disbelief », la suspension de l'incrédulité. C'est de vouloir accepter la fiction comme quelque chose de vrai.
Comme tu dis, Jésus n'était pas là pour faire du fric.
Même, on retourne dans le Premier Testament, le discours des prophètes. Ils disaient aux puissants, aux riches, vous abusez des pauvres gens, vous abusez des veuves, vous abusez des orphelins pour devenir plus important, devenir plus riche.
En même temps, on veut croire qu'il y a comme une formule magique, que Dieu est comme une sorte de distributrice de bonbons. Si on met suffisamment de prières, les bonbons vont arriver, l'argent va arriver, et que, tout simplement, tout va bien aller.
Mais on sait que ce n'est pas ça. Si on regarde dans notre monde, non, ce n'est pas nécessairement ça.
Oui, il y a des gens qui font de bonnes choses et ces personnes s'enrichissent. Bravo!
Mais il y a des personnes qui font également les bonnes choses et ne s'enrichissent pas pour toutes sortes de raisons.
On vit entre autres dans un monde capitaliste.
L'éthique n'est pas toujours au rendez-vous, mais on veut y croire à quelque part. que nous sommes le peuple élu, nous sommes un peu comme les préférés de Dieu, alors Dieu va nous faire une faveur, va nous favoriser par rapport aux personnes qu'on aime moins ou les personnes qui n'ont pas la bonne religion, de notre point de vue naturellement.
On veut y croire, mais à quelque part, on le sait, si on regarde les faits, que ça ne fonctionne pas. Et on dirait qu'il y a cette déconnexion dans notre cerveau.
L'histoire de la veuve de Sarepta
[Joan] On avait travaillé avec le groupe des femmes du 8 mars l'histoire de la veuve de Sarepta.
Il y a un prophète Élie, il s'est passé plein de trucs. Et puis, Élie lui demande à manger.
Et elle lui répond « Aussi vrai que l'éternel ton dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. »
Alors là, lui, il l'exhorte à faire ce pain et il lui dit qu'en fait, finalement, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'éternel fera pleuvoir sur le pays.
Et ce qui est intéressant c'est que c'est un très, très beau récit et on l'a travaillé avec les femmes pour la célébration autour du 8 mars.
Et nous notre conclusion c'était finalement que c'était une parabole, un conte qui nous enjoignait à toujours faire confiance à Dieu, qui nous donnera toujours d'une certain
Nous vivons tous et toutes des moments de transitions au cours de nos vies. Nous changeons d’emploi; nous connaissons des ruptures; nous déménageons dans une autre région. Comment réagissons-nous durant ces moments? Quelles sont nos sources de réconforts dans ces événements voulus ou non?
Dans ce premier épisode de la quatrième saison, Joan et Stéphane nous partagent des moments personnels pour illustrer les réalités et les défis des transitions professionelles et intimes.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Réfome: https://www.reforme.net/podcast/
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Caleb Jones, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité une question à la fois. Cette semaine, comment aborder les transitions professionnelles ?
Bonjour Stéphane. Bonjour Joan.
[Joan] On est de retour après un été un peu chargé de mon côté et du tien.
[Stéphane] Oui, moi aussi. J'avais dit que j'étais pour faire des capsules, peut-être cet été. Je n'ai pas pu. Je m'en excuse à toutes les personnes qui sont à l'écoute. Ça a été très chargé.
Un déménagement pour Joan
[Joan] Et en parlant d'ailleurs de transition, là on va transitionner vers les soixante-dix ou septante quelque chose épisode. Bravo à nous !
[Stéphane] Oui, notre quatrième saison.
[Joan] Et puis, moi j'ai une grosse transition cet été puisque ça y est, on a déménagé en famille en Suisse, après plusieurs années, voilà, d'exploration.
Pour démarrer un petit peu la thématique de cet épisode, il y a un collègue il n'y a pas longtemps qui m'a écrit un WhatsApp comme ça, mais comme on dit en anglais, out of nowhere, c'est-à-dire vraiment qui est sorti de nulle part et il m'a écrit, peut-être qu'il se reconnaîtra, tu as trop de missions, je m'y perds dans ton cahier des charges.
Et c'est vrai qu'entre cette période où j'étais entre l'Alsace et Zurich et puis l'Alsace et Lausanne, et maintenant j'ai un 80% pour les solidarités, notamment la migration et soutien aux paroisses autour d'Yverdon.
Et j'ai aussi un 20% pour toute l'Église cantonale sur les questions d'inclusivité et de conjugalité plurielle.
Alors moi, je le comprends. Il n'y a pas que lui qui est perdu. Je crois que mes parents sont perdus. Moi-même, des fois, je suis un peu perdue, mais vraiment très, très heureuse.
Et puis aussi heureuse de te retrouver, Stéphane, et de retrouver les auditeuristes avec cet épisode de la rentrée.
Les changements au travail
[Stéphane] C'est vrai que ça peut être déstabilisant, mais en même temps, les transitions professionnelles, les changements, les nouveaux boulots, c'est une réalité de toutes les personnes.
Ce n'est pas juste les pasteurs. Toutes les personnes à notre écoute, je suis pas mal convaincue, elles ont connu ou elles connaîtront beaucoup de changements de carrière, de boulot, de couple.
Ça fait partie des choses normales de la vie, mais on dirait que c'est un petit peu plus difficile pour les pasteurs. On dirait que les gens aiment bien nous mettre comme dans une case.
Toi, tu es pasteur à tel endroit, puis toi, tu es pasteur à un autre endroit, et on peut être là pendant 10, 15 ans, et les gens sont surpris qu'il y ait un changement.
Tandis que pour monsieur et madame, tout le monde qui nous écoute, oui, il y en a qui demeurent dans la même boîte pendant 10-15 ans, mais il y en a plusieurs qui changent et on ne se casse pas la tête avec ça.
Les transitions professionnelles
[Joan] Ça me touche ce que tu dis parce qu'on a quitté vraiment une communauté qui était devenue une famille en Alsace, la paroisse Sous les Platanes, Grafenstaden, et on a eu droit à beaucoup de louanges, de prières, d'accompagnement pour cette transition.
Et parmi les prières, il y avait aussi des prières qui étaient un petit peu des prières comme dans les psaumes, des prières un peu de lamentation.
Au moment de nous envoyer, certains ont eu besoin de laisser monter un cri vers le Seigneur et de dire « Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi tu nous les enlèves? On ne comprend pas, pourquoi est-ce que ça s'arrête? »
C'est compliqué de comprendre les plans de Dieu.
Et puis, en même temps, moi, je me disais, c'est beau de lancer ce cri vers Dieu. Et je trouve que cette confiance, elle est édifiante.
Mais d'un autre côté, nous, on est des pasteurs. On est restés neuf années dans cette place. Je comprends tout à fait le cri vers le ciel. Et d'un autre côté, je me dis, notre vocation à nous, c'est d'être un peu en itinérance, d'être un peu en mouvement, en déplacement. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de métiers, en fait, où il y a du turnover.
Je me rappelle l'une des réunions scolaires pour l'une de mes filles où le chef d'établissement a dit, « Écoutez, on va se mettre tout de suite d'accord. Là, on va parler des options, des options scolaires pour cette année. Mais maintenant, en fait, tout peut servir. »
En fait, on n'est plus dans une époque où tu rentres dans une boîte et puis on te fait la fête d'au revoir pour la retraite 43 ans après ou quoi. On est dans une époque où vos enfants, en fait, ils vont changer peut-être dix fois de poste.
Et donc, si là, ils font une option scolaire qui ne vous semble pas nécessaire ou importante, vous n'en savez rien, parce qu'ils vont avoir un itinéraire professionnel très varié, très changeant.
Et moi, ça m'a fait du bien, tu vois, qu'il y ait ce grand temps de culte et de prière à l'Église. Et j'aimerais bien savoir, moi, les auditeurs, les auditrices, comment est-ce qu'ils et elles vivent leur temps de transition.
Les transitions volontaires et involontaires
[Stéphane] Et il y a les transitions voulues, et il y a des moments où ce qu'on est, pour prendre une expression que j'aime bien, expulsé de notre zone de confort.
Quand je pense à des transitions voulues, je suis retourné aux études à 30 ans pour faire ma théologie. J'avais un emploi, bon, ce n’était pas une grande carrière, ce n’était pas spectaculaire, mais j'avais un boulot. L'argent rentrait, tout allait bien.
Et j'ai laissé ça derrière moi pour devenir pasteur parce que c'est ce que je ressentais comme appel.
C'est sûr que lorsque j'ai partagé ça avec des gens avec qui j'avais mon travail avant de rentrer aux études, ils étaient surpris. « Qu'est-ce que c'est ça? C'est complètement différent de ce que tu fais. » « Oui, mais c'est une autre facette de moi-même. On a plusieurs côtés dans notre personne,
Mais il y a aussi les moments où on perd notre emploi parce qu'on se fait congédier, parce que la boîte ferme, parce qu'on est obligé de fuir son pays.
Il y a ces transitions-là qui amènent plus de douleurs, avoir l'impression de perdre quelque chose.
Oui, on peut toujours dire, ah, mais il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent devant soi, il y a de nouvelles façons de voir les choses, mais il y a ce côté-là, un peu de douleur, un côté d'être peut-être un peu victime, dans le sens que ce n'est pas soi qui prend pleinement la décision.
Il y a ces deux côtés-là au niveau des transitions et comment on navigue ça et comment on réagit aux transitions des autres. Joue un peu là-dedans, il faut avoir un peu de tact.
Les transitions dans nos vies personnelles
[Joan] Et puis, c'est important de se donner du temps pour les transitions.
Et parfois, comme tu dis, on n'a pas le temps. En fait, parfois, on subit des choses de plein fouet pour lesquelles on n'est pas prête, je pense. Et puis, là, je mets un traumavertissement.
Je pense à l'une de mes meilleures amies dont le mari était certes très malade. Ça, c'est vrai, il était très malade.
La possibilité, l'éventualité d'une fin de vie était régulièrement évoquée par les médecins, mais à aucun moment on ne lui a dit qu'il pouvait mourir d'une crise cardiaque à cause des différents médicaments qu'il prenait.
C'est une éventualité à laquelle elle n'était pas prête, elle n'était pas préparée plus précisément. Et cette crise cardiaque lui est tombée dessus.
Et elle n'a pas eu le temps de s'y préparer du tout, contrairement à tout ce qu'on lui avait dit sur les soins palliatifs qui lui auraient donné du temps finalement.
Et en l'occurrence, je me rends compte combien, en proportion gardée, cet été, la direction d'Église a décidé de me donner deux mois de remplacement en paroisse, de me laisser prendre des congés un peu longs, de me laisser prendre du temps pour le déménagement.
Tout ça, ça a été bienfaisant et ça m'a aidée aussi à faire les différentes transitions entre les postes, entre les régions, entre les cures ou les presbytères. Et c'est un privilège d'avoir du temps, c'est un privilège.
Et je crois que je vais me souvenir toute ma vie de ce temps qui m'a été donné pour aller mieux, pour me reposer. Vraiment, ce mot, la reposer, il est important, je trouve.
J'espère que moi-même, le jour où j'aurai l'occasion de donner du temps à quelqu'un, je me rappellerai qu'on m'en a donné aussi.
L’importance des temps d’arrêt
[Stéphane] Je t'écoute et ça me fait penser à cette traversée du désert des Hébreux.
Une des façons qu'on nous a expliqué ça, c'est que ça ne prend pas 40 ans de marcher d'Égypte à la terre promise, mais il a fallu 40 ans pour que les gens acceptent de laisser aller une identité pour laisser place à une autre identité.
Et ce qui est quelque chose de positif là-dedans, aussi dans cette histoire, c'est que malgré toutes les pérégrinations, les erreurs, les détours, Dieu était toujours là.
Et lorsqu'on arrive à des endroits dans nos vies où on a l'impression qu'on traverse un désert.
Moi, j'ai dû abandonner un poste pastoral malgré moi. Tout ce temps-là, entre deux postes pastorales, qui a duré environ presque 18 mois, j'ai souv
Où en sommes-nous sur le plan de l'unité de l'Église après de plusieurs siècles d'existence et de nombreux accord oecuménique? Et si nos différences étaient une forme de complémentarité pour un même message.
Dans ce dernier épisode de la troisième saison, Joan et Stéphane expliquent la différence entre des communautés rigides et robustes et reconnaissent que tous et toutes appartiennent à la même Église de Dieu et sont unis dans le Christ.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Helena Lopes, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, quelle est la place de l'unité dans l'Église?
Bonjour Stéphane! Bonjour Joan! Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
D'abord, merci Stéphane d'avoir accepté qu'on prenne ce thème pour le dernier épisode de notre troisième saison Question de Croire.
Déjà trois ans! C'est fou!
L’unité de qui?
La première semaine du mois de mai, j'ai pu bénéficier d'une retraite qui est aussi une formation au monastère de Bose qui se trouve en Italie, tout ou proche de la frontière avec la Suisse; c’est un monastère mixte femmes-hommes et aussi œcuménique.
Bon, il y a majoritairement des catholiques, mais il y a quelques représentants et représentantes d'autres confessions.
On a reçu des enseignements par Frère Luciano sur le thème de l'Esprit-Saint. Alors moi j'aime bien titiller un petit peu, on a vu l'Esprit-Saint dans la vie de foi, la Bible, l'Église…
À un moment donné on avait le droit de poser des questions sur tout ce qu'on voulait.
Alors je lui ai posé la question, oui, et l'unité de l'Église alors? Parce que finalement, est-ce que l'Esprit-Saint permet l'unité de l'Église? Qu'est-ce qu'on fait à propos des conceptions sur l'Esprit-Saint dans l'unité de l'Église? Je lui ai dit, « quid » de l'unité de l'Église?
Il m'a répondu comme ça, avec son style italien un petit peu direct, il parle un peu fort aussi. Il a dit « l'unité de qui? L'unité de quoi? L'unité pourquoi? »
Ça m'a vraiment fait rire parce que je suis vraiment d'accord avec frère Luciano. Quand on nous dit de façon un peu rapide Il faut œuvrer pour l'unité de l'Église.
Ça ne se fait pas parce qu'il y a l'unité de l'Église. On parle de l'unité de qui, de quoi et l'unité pourquoi?
Le rêve de l’unité de l’Église
Eh oui, pourquoi? Très bonne question. Pourquoi devrait-on être absolument unis et qu'est-ce que ça veut dire être unis?
Je crois qu'il y a un fantasme qu'au début tout le monde était uni et que c'est au cours des siècles que les chrétiens se sont divisés en différentes Églises, en différents mouvements.
Mais lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, J'ai l'impression que la division s'est installée 30 secondes après que Jésus est parti.
Il y a les affrontements Pierre et Paul. On entend parler de super apôtre. On entend Paul dire moi je vous ai baptisé dans le Christ, un tel vous a baptisé au nom d'Apollo.
Je crois qu’il y a une espèce de rêve, un fantasme, un peu irréaliste, qu'il faut absolument être un, être ensemble, sinon on ne suit pas le message du Christ.
Et ce qui sous-tend souvent ça, c'est « il faut être ensemble de ma façon ».
Je me souviens lorsque je recevais l'enseignement religieux dans ma jeunesse catholique romaine, on avait cette image d'un arbre qui partait d'un tronc commun et il y avait plusieurs branches.
Mais le tronc commun c'était la bonne Église, c'était l'Église catholique romaine et les branches c'était les protestants.
J'ai remarqué le sous-texte là-dedans est « il faut qu'ils reviennent au bercail pour cette unité ».
Ce n'est pas « nous avons à créer une nouvelle association, une nouvelle Église ». C'est « il faut recréer cette Église… qui est en parenthèse la nôtre ».
Les menaces à l’unité
Pour ma part, j'ai souvent entendu « Si on fait ceci ou cela, ça œuvrera contre l'unité de l'Église. »
Par exemple, pendant longtemps, c'est ce qu'on a pensé des couples mixtes catholiques protestants. Dans la région dont je suis originaire, en Alsace, j'ai déjà pu entendre des personnes me raconter ce genre de témoignages.
« Oui, on est un couple mixte. Au début, on ne voulait pas nous marier, c'était interdit. Le curé a dit que j'allais être excommuniée parce que je me mariais avec un protestant. Et puis en plus, on nous a dit que ça allait détruire l'Église. »
Et j'ai beaucoup entendu ça aussi, il y a une dizaine d'années, concernant les bénédictions de couples de même genre. Cela allait détruire l'Église. Cela allait apporter le péché dans l'Église. Mais, le pire, cela allait œuvrer contre l'unité de l'Église.
Par exemple, les accords œcuméniques qu'on a catholiques-protestants, les accords qu'on a avec des évangéliques, voilà.
Le fait qu'il y ait une ouverture aux réalités de vie des gens, par exemple le fait de tomber amoureux de quelqu'un qui ne soit pas directement de ton réseau social confessionnel, qui ne soit pas du même genre que toi, ce soit forcément une menace contre l'unité de l'Église.
Et pourtant, ce que j'ai appris pendant mes études de théologie, c'est que si la caractéristique de l'unité de l'Église, c'est de la rendre rigide, une Église forte comme ça, rigide, hermétique en quelque sorte, imperméable, elle ne pourra pas résister au séisme.
Alors moi, je ne suis pas une grande spécialiste en urbanisme, en architecture, mais si j'ai bien compris, le principe même des immeubles qui résistent au séisme, comme au Japon, c'est qu'ils ne sont pas rigides, ils sont robustes. Pas pareil en fait.
Donc ça nous amène à réfléchir à une façon d'avoir des Églises, des communautés qui soient robustes, mais finalement pas rigides.
Reconnaître que nous appartenons tous et toutes à la même Église de Dieu
Je t'écoute. J'ai l'impression que ceux et celles qui défendent ces positions-là se sentent peut-être un peu fragiles.
Je vais te donner un exemple. Lorsque j'ai changé d'Église, ma mère en a parlé à des amis autour d'elle. Et une de ses amies a dit, mais c'est donc bien dommage, c'était l'un de nos meilleurs, il était pour devenir un prêtre.
La réaction, ça n'a pas été, ah, quelle bonne nouvelle. Stéphane a trouvé une place où il se sent confortable, où il va pouvoir trouver sa place pour être dans la grande Église de Dieu.
Si on a l'impression qu'on n'est pas assez solide, on a l'impression que tout ce qui est différent, tout ce qui n'est pas dans mon cercle que je peux contrôler, c'est une attaque, c'est une menace.
L'Église de Dieu n’est pas la mienne et toutes les possibilités peuvent rejoindre plus de personnes.
Alors pourquoi ne peut-on pas célébrer une personne qui trouve sa place, qui aime peut-être plus tel aspect de la foi ou tel autre aspect de la foi, au lieu de dire ben faut que je la garde dans mon Église, il faut que je la garde dans ma petite paroisse.
Je pense qu'il faut quelque part faire confiance que ce qui existe correspond probablement au plan de Dieu, jusqu'à une certaine limite naturellement.
Une Église complémentaire et plurielle
C'est beau ce que tu dis de considérer l'Église comme un grand ensemble qui serait complémentaire, pluriel, divers.
On en a fait l'expérience ici, dans la communauté méthodiste dans laquelle je vis depuis presque un an, puisque pour le Mercredi des cendres, on a proposé une célébration sur le temps du midi.
La ministre Erika Stalkup, qui s'occupe ici de beaucoup des célébrations, était dehors, en habit pastoral. Elle avait une coupelle avec dedans une sorte de cendre, mais plutôt une cendre sous forme un peu de... Comment est-ce qu'on pourrait dire? De crème, voilà. Quelque chose qu'on puisse appliquer tout doucement.
Et puis j'ai pris sa place parce qu'elle est allée préparer l'église. Et on a eu la grande surprise de voir arriver beaucoup plus de monde que ce qu'on croyait. On croyait qu'on serait deux ou trois, et figure-toi qu'on a presque été dix. Je ne sais pas si tu imagines. On a triplé les effectifs.
Tout ça parce que le mercredi des cendres de cette année a été extrêmement populaire dans l'Église catholique, qu'un office a été déplacé ou annulé, je ne sais pas, mais en tout cas les gens ont remarqué qu'il n'y avait pas l'office de midi qui était annoncé et ils ont cherché sur Internet et l'Église la plus proche, c'était la nôtre.
Et je me suis trouvée toute contente de me dire qu'on se rend service entre Églises, on ne se vole pas les gens, on se rend service. Quand les uns ou les autres doivent renoncer à faire ce qu'ils ou elles avaient prévu pour des raisons sûrement matérielles, humaines, qui s'expliquent, on est là, on est fidèles à notre appel et on peut se suppléer les uns les autres.
On ne vole rien, on fait partie de la même Église, l'Église du Christ.
La différence entre unité et uniformité
Je trouve que nos institutions et beaucoup de personnes à l'intérieur de ces institutions ont de la difficulté à faire la différence entre unité et uniformité.
On peut être uni et différent. On n'a pas besoin d'être exactement pareil. Même dans nos paroisses, on a des gens qui ont des opinions différentes, qui ont des philosophies différentes, mais qui se retrouvent et qui sont capables de travailler ensemble.
Ça, c'est l'unité. On n'a pas besoin d'être pareil.
La même chose s'applique entre différentes Églises, entre différents courants religieux. On peut reconnaître qu'on a des objectifs communs, qu'on a des aspirations qui se rejoignent et qu'on peut apprendre à vivre avec nos différences et même les célébrer.
C'est difficile parfois de faire passer ce message-là parce que j'ai l'impression que pendant trop longtemps, comme l'exemple que t
Pourquoi devenir pasteur?
Malgré le déclin de l’Église chrétienne en Occident, plusieurs hommes et femmes choisissent encore de devenir pasteurs. Vocation ou métier atypique? Servir ou être servi par sa communauté? Chacun et chacune doivent trouver leur voie.
Dans cet épisode Joan et Stéphane reçoivent Quentin Beck, pasteur suffragant de l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel. Ensemble, ils réfléchissent sur les raisons qui les ont conduits vers le ministère et les attentes envers les pasteurs de nos jours.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Marek Studzinski, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, pourquoi devenir pasteur?
Bonjour Stéphane. Bonjour, Joan, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous accueillons Quentin Beck. Quentin est un apprenti pasteur, comme moi un petit peu encore. Bonjour. Bonjour, Joan, bonjour Stéphane. Bonjour aux auditeurs et auditrices.
Quentin, tu nous viens de Neuchâtel et tu nous raconteras un petit peu plus tard pourquoi devenir pasteur. Exactement, c'est ça. J'ai 27 ans et depuis peu, j'exerce le ministère.
Est-ce que les femmes pasteures existent?
Comme anecdote pour débuter, j'aimerais dire que je viens d'une région en Alsace où il y a encore une petite prégnance de luthéranisme, un petit peu aussi, bien sûr, de communautés réformées, mais essentiellement des communautés luthériennes.
Généralement, lorsqu'on est en paroisse et qu'on est pasteur, les jeunes savent de quoi il s'agit. Ils ont l'habitude, ils ont déjà rencontré des pasteurs ou ils ont entendu parler de ça, notamment des femmes pasteurs. Ça fait quand même un moment qu'il y a des femmes pasteurs.
Et j'ai eu la surprise en arrivant dans le canton de Vaud, où le catéchisme est sectorisé, c'est-à-dire que certains professionnels de l'Église s'en occupent et plus nécessairement tous les pasteurs, je suis allée à la rencontre de jeunes dans un camp et j'ai dit que j'étais pasteur.
Là, j'ai vu qu'ils me regardaient d'un drôle d’air. Il y en a un qui me dit « Mais finalement, si les femmes peuvent être pasteurs, (visiblement, c'était un petit peu nouveau pour lui, mais il avait l'air tout à fait OK) pourquoi on ne dit pas pasteuresse?
La raison derrière la volonté de devenir pasteur
C'est très intéressant, ces questions, parce que souvent, on suit une voie et pour la majorité des gens, on n'y pense pas trop. On prend une profession parce qu'on aime quelque chose, on a eu quelqu'un qui nous a influencés.
Mais pour être pasteur, mon expérience est que j'ai eu à expliquer, je ne sais pas combien de centaines de fois, mon appel au ministère, pourquoi je voulais être pasteur, au point où je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris?
On ne veut pas avoir n'importe qui. Mais toujours cette question, au point où, une fois, j'ai googlé « Pourquoi devenir pasteur? » Et la première réponse que j'ai eue, c'est « Comment devenir riche? » Je n'exagère pas là. Donc, j'avais ma réponse. C'était pour le pognon. Et toi, Quentin, pourquoi es-tu devenu pasteur? Pour l'argent aussi, exclusivement. Ah, c'est bon! Impeccable!
Un parcours de foi
C'est aussi une question qu'on me pose souvent. C'est vrai que les gens s'interrogent quand on dit qu'on est pasteur, surtout que j'ai 27 ans et je n'ai pas forcément la tête à laquelle les gens s’attendent lorsqu'ils s'imaginent un pasteur. C'est une question à laquelle j'ai aussi dû répondre maintes et maintes fois.
Mais voilà, je crois que j'ai voulu devenir pasteur parce que lors de mon catéchisme, j'ai vu autour de moi des gens qui avaient une foi forte, qui vivaient des choses avec Dieu et je voyais des gens qui changeaient dans leur comportement, dans leur façon d'être.
Je venais d'une famille pas forcément très pratiquante où la foi n'avait pas une grande place. Et du coup, je me sentais un peu à part là-dedans. Je ne comprenais pas trop et en même temps, j'étais attiré, ça me posait des questions. Et je me suis dit, il faut que je grandisse dans ma foi, et pour ça je me suis lancé dans les études de théologie.
Si quelqu'un se pose des questions, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de se lancer dans des études de théologie, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Et voilà, donc ma rentrée dans le monde de la théologie ne se faisait pas en vue du ministère, mais en vue de grandir dans ma foi.
Je suis passé par la faculté catholique de Fribourg. Durant ce bachelor en théologie, on a beaucoup parlé de l'incarnation de Dieu, d'un Dieu qui se fait homme, qui se fait être humain et qui vient vers nous, qui vit des émotions, qui rigole, qui pleure, qui mange, qui meurt aussi.
Il y a tout cet aspect-là. C'est quelque chose où je me suis dit: ce Dieu qui se fait proche de nous, qui nous comprend, qui nous ressemble, c'est quelque chose dont j'ai envie de témoigner autour de moi. Je dirais que c'est là qu'il y a eu le début de cette vocation, le commencement de cette vocation pour le ministère.
Après, il y avait plein d'autres choses qui me retenaient. Je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez introverti. Il m'a fallu passer par-dessus certaines choses. Je me retrouve un peu dans l'histoire de Moïse en Exode IV, qui n'a pas envie d'aller parler aux autres parce qu'il a de la peine à s'exprimer. Je m'identifiais aussi là-dedans.
En Église, j'ai eu des moments, des espaces où on m'a permis de m'exprimer, où on m'a écouté, on m'a permis d'être moi-même, et où j'ai aussi pu expérimenter, parler devant les gens, témoigner de qui j'étais, de ce que je croyais, de ma foi.
C'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir permettre aussi aux autres, et je dirais que c'est un peu ces éléments-là qui ont fait qu’après mes études en théologie, je me lance dans le ministère pastoral.
Les pasteurs qui nous influencent durant notre jeunesse
J'aime bien ce témoignage, notamment cette idée que l'Église est un lieu où on peut être soi-même. Et je trouve que c'est plutôt encourageant.
Moi, de mon côté, j'ai cette certitude en moi depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Je me rappelle que j'étais en train de faire un jeu, et puis je me disais, mais au fait, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Enfin, je me vois dans quoi?
J'avais deux parents travailleurs sociaux, très à gauche, très engagés pour le monde. Et je voulais aussi un métier qui fasse sens, et où on soit là au nom d'une cause supérieure, et finalement, où on serve les autres.
Et je connaissais le mari de ma marraine, qui était un pasteur totalement engagé dans le travail social auprès des jeunes dans la rue. Et je me suis dit, moi, je vais faire le travail que fait Jean-Michel.
Ce n'est qu'après que j'ai découvert que c'était très, très, très anecdotique, qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. En fait, mon modèle à moi, hyper à gauche, hyper punk, hyper avec les marges.
En plus, ce qui est un petit peu dommage, a posteriori je regrette un peu, c'est que je me suis dit je vais devenir pasteur parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres métiers d'Église. Après, j'ai expérimenté tous les autres métiers d'Église : catéchète, diacre, dans la sphère missionnaire, etc., et je me suis vraiment éclatée aussi.
Je suis contente que maintenant cette diversité des ministères existe et qu'on en parle beaucoup plus aux jeunes. Sinon, il y a un risque de cléricalisme, de pastora-centré, qui n'est pas bénéfique pour l'Église, en fait, et qui limite aussi, en termes de projection, les lieux où on se sent à l'aise pour exercer un ministère.
Un ministère pour tous et toutes
Lorsque les gens pensent à quelqu'un qui travaille pour l'Église, on pense à un pasteur parce que je crois qu'il y a cette idée justement du pasteur masculin, le prêtre qui est en avant, qui parle avec sa grosse voix grave et enseigne les bonnes réponses. Et pourtant, le ministère, c'est tellement plus large.
Moi, je suis de ceux qui croient que nous sommes tous et toutes appelés au ministère. Le défi, c'est de trouver le bon ministère qui nous correspond.
Il y a des gens qui ont une facilité de parler en public, comme moi. Il y a des gens qui font de la musique. Il y a des gens qui accompagnent des personnes malades. Ce sont tous des ministères. On pourrait quasiment dire tous des pasteurs.
Je sais que ça peut choquer un peu parce qu'on a l'impression que « pasteur », ce n'est pas une appellation d'origine contrôlée. Mais je me demande dans les yeux de Dieu, les titres… j'ai l'impression que ce n'est pas si important.
C'est le ministère qu'on fait. Je pense qu'on a justement cet appel-là de trouver ce qu'on peut faire avec tous les dons, tous les talents qu'on a reçus de l'Esprit.
Suivre son appel
Moi, cette idée de ministère qui s'adresse à tout le monde me parle beaucoup.
Pour l’examen de consécration que j'ai passé il y a deux semaines, j'ai dû préalablement envoyer une lettre qui exprimait mes envies et justement les raisons de mon engagement.
Et j'ai insisté sur le fait que c'est avant tout mon ministère à la suite du Christ, en tant que chrétien qui se place dans ce ministère pastoral, mais ce qui est à la source, c'est ce ministère baptismal, ou ce ministère qui nous vient de notre envie de nous mettre à la suite du Christ.
Voilà le ministère pastoral dans lequel je m'engage actuellement, un ministère assez traditionnel, où justement je suis un peu ce pasteur masculin, alors j'essaye de pas trop enseigner, de ne pas être trop moralisant.
Mais c'est la forme à laquelle je me sens appelé et il y a une diversité des mi
Nous avons parfois l’impression que le climat actuel est anxiogène. Les crises se succèdent et nous ne savons plus comment y répondre.
Dans cette épisode, Joan et Stéphane prennent le temps de réfléchisse sur l’état de notre monde et explorent différentes avenues qui nous sont offertes pour demeurer sain d’esprit.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Sander Sammy, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, comment survivre dans le climat actuel?
La tentation d’offrir des trucs pour survivre aux crises actuelles
Un jour, quand mes trois enfants étaient toutes petites, la période la plus épuisante de ma vie, (et d'ailleurs je fais un clin d'œil à toutes celles et ceux qui se retrouvent dans cette situation maintenant), je m'en étais ouverte à un prof de la fac de théologie que je connaissais.
Il était du côté catholique, mais on était ensemble dans plusieurs projets de réflexion théologique œcuménique. Il m'avait donné un précieux conseil. Écoute bien Stéphane, ça peut te servir.
Il était allé en retraite spirituelle dans je ne sais quel monastère formidable, sûrement avec une très belle vue et puis régulièrement des offices. Il m’avait expliqué qu'il était un peu pressé par les différentes tâches académiques et les problèmes liés à sa paroisse, parce qu'il était aussi prêtre en paroisse.
Et puis, tiens-toi bien, une de ces personnes consacrées dans la vie du monastère lui avait donné le truc et astuce suivant : « quand je mange, je mange, quand je marche, je marche, quand je lis, je lis ». Il lui avait donc conseillé de ne faire qu'une chose à la fois et de la faire bien et en pleine conscience.
Alors, un peu épatée, j'avais regardé ce monsieur de plus de 45 ans, célibataire, prêtre, prof de fac, qui me disait ça à moi.
Et j'avais dit, écoute : quand je mange, je donne à manger à quelqu'un. Quand je marche, je pousse une poussette et je tiens quelqu'un d'autre par la main. Quand je parle au téléphone, une autre personne m'interrompt tout le temps et me parle constamment. Et quand je dors, quelqu'un décide de ne pas dormir et donc je ne dors plus.
C'est un petit peu la même chose maintenant; il y a un climat particulièrement difficile et des fois quand je scrolle sur Instagram ou autre et que je vois des tas d'astuces : mettre les jambes contre le mur, faire de la méditation et tout, je repense à ces bons conseils qu'on peut donner aux gens pour aller bien, alors que c'est le chaos total autour d'eux.
Les crises qui prennent trop de place dans nos vies
Oui, je trouve qu'il y a une certaine sagesse dans le conseil que tu as donné dans le sens d'essayer de ne pas trop se faire envahir et que le contexte actuel prenne toute la place dans nos vies. Mais en réalité, c'est difficile parce que le climat actuel a des répercussions partout dans tout ce qu'on fait.
Au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes au Canada dans cette crise avec les tarifs d'importation exportation avec les États-Unis. Les États-Unis sont quand même le premier partenaire commercial du Canada.
On peut dire, bon, c'est une crise, les marchés fluctuent et tout et tout, mais ça a des répercussions à l'épicerie. Il y a des gens qui sont soit à la retraite ou qui planifient leur retraite. Toutes ces variations de marché, ça a un impact réel. Il y a des gens qui perdent leur emploi.
Donc, c'est facile de dire ah, j'élimine ça dans ma tête, je me concentre sur moi-même et ma petite chose. Mais c'est difficile de dire ça à quelqu'un qui a peur de perdre son emploi, qui se demande comment il-elle va faire pour nourrir ses trois enfants.
Ça peut être très envahissant, ça peut être très angoissant. Et on en parle un peu, mais on a très peu de choses à offrir pour aider ces personnes-là.
Que peut faire l’Église dans le climat actuel
Finalement, nous, d'un point de vue de l'Église, d'un point de vue des religions, comme tu dis, qu'est-ce qu'on a à offrir ?
C'est vrai que j'étais assez surprise la première fois qu'une stagiaire avec laquelle j'ai parlé il y a quelques années, une stagiaire que j'avais dans mon staff dans une Église à Strasbourg, m'a parlé très franchement de ses problèmes de santé mentale.
Et c'était un peu la première fois dans un contexte d'Église en France; elle venait un petit peu de l'extérieur puisqu'elle faisait un stage plutôt orienté, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était un peu secrétariat ou quelque chose comme ça.
Elle en parlait super librement, là où finalement c'était très, très, très rare dans mon milieu d'Église d'origine qu'on parle de santé mentale. D'ailleurs, on a consacré tout un épisode avec l'ami Olivier sur ces questions-là.
D'un autre côté, ces derniers temps, je me suis rendu compte qu’il y a beaucoup de bon dans le fait de pouvoir poser des diagnostics, quelque chose qui permet aux gens de comprendre certaines de leurs réactions, certaines de leurs pseudo-inadéquations avec les situations.
En même temps, je me demande si, par certains aspects, ça ne nous rajoute pas un poids supplémentaire, dans le sens où on se dit « bon, moi j'ai eu le diagnostic de ci ou ça, ou bien moi je me sens comme ceci, et donc je n’arriverai pas à faire ça, ou ce n’est pas pour les gens comme moi, ou alors si on aménage, je ne sais pas, je n’y arriverai pas ».
Avant, on avait un peu cette espèce d'utopie qu'avec un peu de bonne volonté, on arrivait à tout faire. Et maintenant, on est presque parti dans l'autre sens, on se dit que tout est devenu si compliqué qu'on ne va probablement pas réussir à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète aussi par bout.
Du coup, en Église, je trouve que ce qui pourrait devenir de plus en plus notre force, c'est d'être accessible à tous et à toutes, d'avoir des activités qui peuvent parler à un maximum de personnes, avoir des lieux où tu peux choisir ou de parler ou de te taire, de t'asseoir sur un banc ou de t'allonger sur un banc.
On pourrait finalement développer encore plus le fait qu'on peut être des lieux de refuge, qu'on peut être des sanctuaires dans lesquels peuvent se vivre un certain nombre de choses et d'interactions, peu importe finalement nos besoins, nos spécificités, nos diagnostics.
J'espère que comme ça, on arrivera à contribuer à quelque chose d'un peu plus sain dans le climat actuel. Je me rappelle que finalement, Jésus avait des fois un petit comportement autistique, si on y pense un peu.
Après, je ne veux pas faire un diagnostic sauvage sur Jésus, mais quand d'un seul coup il disait aux uns et aux autres « j'en peux plus, je suis sursaturé d'informations, je vais me mettre là-bas, là-bas, où on me fout la paix ».
Quand il prend cette décision ultra radicale d'aller au désert, on sent vraiment qu'il est en surstimulation et qu'il a besoin qu'on lui foute la paix, qu'on lui laisse un grand espace devant lui. Dans nos sociétés, on a de plus en plus de mal à couper.
Je suis la première à être sur les réseaux sociaux, je suis la première à m'intéresser à plein de choses. Récemment, j’ai vu un documentaire qui rapportait que certains jeunes passent jusqu'à 12 heures par jour sur les réseaux sociaux; 12 heures ! Peut-être que mes filles en font un peu partie, j'espère que non.
Alors bien sûr, il y a aussi les gamers qui font quand même aussi des trucs d'interaction sociale. Ce n’est pas juste scroller. Il y a toutes sortes de façons d'être sur Internet ou les réseaux sociaux. Il n'y en a pas qui sont meilleures ou moins bonnes, il y a juste différentes façons d'y être.
Et quelles sont nos possibilités de nous couper un peu de toute cette agitation du monde? Moi, j'ai tendance à espérer que dans les Églises, on cultive ce genre de choses.
J’ai beaucoup d'admiration pour mes collègues qui partent trois, quatre, dix heures en forêt avec des enfants, avec des jeunes, avec des adultes et qui leur proposent de couper. Il me semble que c'est ce qu'on a à offrir.
Prendre soin de soi
Certaines personnes s'attendent à ce que les Églises soient ce lieu de résistance au climat actuel. Oui, peut-être. Mais en même temps, un peu comme tu l’as soulevé, il faut prendre soin de soi.
L'exemple que j'utilise souvent, c'est ce qu'on appelle ici les aidants naturels; ces personnes qui prennent soin de parents âgés ou d'enfants qui ont des problèmes spécifiques, ce qu'ils font par amour, mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie.
Et on leur dit : si vous vous épuisez, on n'aura pas seulement entre guillemets un problème, mais deux problèmes. On va avoir une personne en perte d'autonomie et une autre personne en épuisement. Donc, il faut faire attention à soi pour ne pas se brûler.
Et c'est vrai qu'on est constamment confronté à des problèmes qui semblent immenses, qui semblent trop gros pour nous, ça peut être décourageant. On peut se demander, mais moi, je ne suis qu'une seule personne. Comment puis-je changer la façon dont les systèmes internationaux fonctionnent?
Peut-être une façon, c'est de revenir à soi, un peu comme tu dis. J'ai arrêté d'écouter les téléjournaux parce que c'était trop difficile émotivement, et arrêté d'avoir des conversations avec des gens qui ne sont pas là pour échanger, mais pour débattre et gagner un argument, des gens, ce que j'appelle, endoctrinés.
Souvent on dit, ah, il faut garder les canaux de communication ouverts avec les gens différents. Peut-être, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'être en contact avec des gens nocifs, des gens toxiques, des gens qui ne veulent rien savoir de nos points de vue qui sont juste là pour régurgiter la propagande
Notre réputation est déterminée par plusieurs facteurs. Notre genre, notre âge ou notre rôle dans la société influencent la perception des autres à notre sujet. Les personnes croyantes n’y échappent pas.
Dans cet épisode, Joan et Stéphane abordent de front l’influence du genre sur la réputation des gens, abordent quelques histoires bibliques et se questionnent sur la volonté des Églises de gérer leur réputation publique.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de name_-gravity, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Les Églises accordent beaucoup d’importance à l’enseignement de la foi aux enfants. Qu’en est-il pour les adultes? Doit-on continuer à accepter les notions apprises à l’enfance ou peut-on laisser la place au doute pour développer une foi plus mature?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane reçoivent Jean-Baptiste Frémond de l’Église évangélique régionale du canton de Vaud. Ensemble, ils partagent leurs expériences d’accompagner des jeunes et des adultes dans leurs cheminements de foi et explorent quelques pistes pour approfondir sa foi tout au long de sa vie.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Jessica Mangano, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Bonjour! Bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, comment développer une foi mature? Bonjour Stéphane. Bonjour Joan. Et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
Aujourd'hui, on a avec nous Jean-Baptiste Frémont. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane, bonjour Joan, bonjour tout le monde. Bonjour.
L’adolescence et le rejet de la foi
Jean-Baptiste, tu te présenteras en cours d'émission. Peut-être que tu diras un mot qui tu es lorsque tu prendras la parole en premier.
Mais j'aimerais commencer cette émission avec la question de la développer une fois mature, en quelque sorte, avec le bénéfice qu'on peut avoir lorsque nos enfants nous déclarent certaines choses.
Et donc, je me souviens qu'avec mon mari, à un moment donné, je ne sais pas, on devait prier à table ou je ne sais pas lire la Bible, enfin on faisait un petit rituel quotidien biblique. Et notre fille aînée, de façon très décidée, nous dit « Je ne crois pas en Dieu. Et alors? »
Et c'est là que c'est un petit test pour la foi. Est-ce que ta foi est assez mature pour supporter l'idée que quelqu'un en pleine préadolescence vienne comme ça te challenger devant ses deux petites sœurs, qui n'en loupaient pas une miette évidemment? Comment tu réagis?
Tu réagis de façon un petit peu explosive, tu lui dis « là maintenant on lit la Bible, tais-toi »?
Et c'est super rigolo parce qu'il y a eu un long regard entre mon mari et moi. Tous les deux, on a avalé notre salive, on a dit « D'accord, et maintenant, on va chanter un chant de Taizé ».
Et puis, la dite demoiselle, on l'a déjà reçue à Question de Croire pour le podcast. Maintenant, elle est en étude de théologie et finalement, elle a fait sa boucle.
Parfois, développer une foi mature, c'est aussi à un moment donné ne pas croire en Dieu. Et puis, développer une foi mature, c'est aussi être parent d'enfant qui ne croit pas en Dieu.
Très bonne anecdote, parce que nous vivons ça à la maison. Mon fils, à 15 ans, nous a déclaré qu'il ne croyait ni en Dieu, ni en religion, ni en tradition. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qui reste, mais bon, on accueille.
Mais toi, Jean-Baptiste, parle-nous un peu peut-être de qui tu es et qu'est-ce que ça dit pour toi développer une foi mature?
Le doute qui renforce la foi
Alors moi, en ce qui concerne la foi, je suis fils de pasteur, donc ça a été présent dans ma vie depuis ma naissance. Et tout le long de ma vie, j'ai évolué avec cette foi.
Et je dois dire qu'à l'âge de vos enfants, moi aussi il m'arrivait bien souvent de dire à mes parents que je ne croyais absolument pas en Dieu et tout ce qui va avec. Mais à mon sens, c’est une étape qui fait absolument partie du développement de la foi, dans le sens que si la foi étant quelque chose de très vivant, le doute fait forcément partie de cette dernière.
Il n'y aurait rien de pire qu'avoir un enfant qui ne pose aucune question sur sa foi, qui ne fait que suivre bêtement ce qu'on lui a appris au catéchisme.
Donc, à mon sens, la foi est pavée de doute, et c'est le doute qui fait qu'on peut se renforcer dans notre foi, mieux la comprendre, mieux se l'approprier. Donc ça ne m'étonne pas du tout que vos enfants vous fassent des petites crises ou des petites déclarations du genre.
Corriger ou accueillir le doute
Mais c'est vrai que finalement... ça joue un peu de là où on est issu pour les questions de foi, c'est-à-dire que parfois je parle avec des personnes qui viennent de milieux dans lesquels le doute n'a pas sa place.
Et quand ces personnes ont des doutes, on leur donne des instructions un petit peu coaching, du style prie plus, lis plus ta Bible, fait ceci, fait cela, comme si la solution ne se trouvait que dans des pratiques correctives.
Le doute se corrige avec des pratiques qui s'apparentent à la foi et qui finissent par habitude, par discipline, par devenir de la foi en quelque sorte. C'est marrant, c'est comme des programmes de musculation spirituelle.
Et nous, dans les milieux littéraux réformés, on vient plutôt de cultures dans lesquelles on a assez relax sur les questions de doute. On en a souvent parlé dans ce podcast, mais on pense souvent à nos collègues très, très libéraux qui disent oui.
La résurrection de Jésus, bon là par exemple hier je parlais avec une collègue qui m'a dit que l'un de ses devoirs de théologie, il y a déjà plusieurs décennies, un prof lui a dit vous remplacez à chaque fois que vous avez mis Jésus est ressuscité, vous mettez Jésus a été réanimé.
Voilà, tu peux aussi faire des études de théologie, traverser des années d'enseignement de théologie avec des profs tellement libéraux qui vont gommer la résurrection et c'est ok. C'est ok dans le sens où ça fait partie des possibilités du paysage luthéro-réformé.
Remettre des principes religieux reçus à l’enfance pour développer la foi
Je reviens à une de mes marottes sur la différence entre la religion et la foi. Dans ces mouvements de correction, dans ces mouvements de donner les bonnes réponses, j'y vois la religion, un système structuré, un système normalisé.
Mais la foi, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'un peu plus fluide. La foi, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Il y a des hauts, il y a des bas.
Et je crois qu'il faut accepter de se mettre au défi. On reçoit de l'enseignement et à travers les aléas de la vie, Il arrive parfois qu'il faut réévaluer ses positions, il faut se demander est-ce que ça tient encore.
Et, si je peux utiliser un mot que nos amis évangélistes adorent, parfois il faut déconstruire sa foi.
Donc, il faut être capable de se remettre en question et se remettre en question n'est pas un signe de faiblesse, mais un désir d'aller peut-être un peu plus loin.
On a cet enseignement qu'on reçoit en étant enfant, mais lorsqu'on grandit, On commence à se poser des questions. Je vais vous donner un exemple.
Dans le monde anglo-saxon, en Amérique du Nord, l'histoire de l'Arche de Noé, c'est très important pour l'enseignement des enfants. C'est les petites chansons, les animaux qui montent deux par deux dans l'Arche et c'est tellement beau.
Mais il arrive un moment où ce qu'on réfléchit que Dieu élimine l'humanité et la création, sauf la famille de Noé. Et si on commence à avoir un peu d'imagination, on dit mais toutes ces personnes-là, quoi, ils se sont noyés. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais ça a eu une réception ultra négative.
Mais il faut commencer à réfléchir sur peut-être un Dieu qui a voulu exterminer la création. Qu'est-ce que ça dit Dieu? Qu'est-ce que ça dit nous?
C'est tout un pan de questions qui ouvre. Ça ne veut pas dire nécessairement que Dieu est un tortionnaire, est un génocidaire, mais ces questions-là nous permettent d'approfondir notre foi, d'explorer un peu plus loin que les belles petites réponses qu'on a reçues à notre enfance.
La complexité de la Bible
Ça nous amène finalement à la complexité de la Bible et à ses différentes strates d'écriture.
C'est vrai que l'un des points forts, je trouve, des études de théologie, c'est quand on nous explique comment la Bible a été assemblée, qu'il y avait tous ces manuscrits, qu'il faut toujours faire des choix dans les manuscrits, ces choix du reste.
Lorsqu'on va par exemple dans le Novum Testamentum, dans les versions en grec, et qu'en bas on a la paracritique, et qu'on comprend que tel moment, mais qu'on en a déduit que c'était celui-ci, qu'on comprend que sur cette péricope, ce passage biblique, il y a au moins trois ou quatre options, mais qu'on a gardé l'option qui semble faire le plus de sens, etc.
Une fois qu'on a reçu ce cours-là, et une fois qu'on est appelé aussi à naviguer dans la paracritique et à voir finalement si on arrive à faire des nouvelles traductions de la Bible en prenant d'autres alternatives qui existent aussi dans les manuscrits.
On est obligé de décoller d'une vision littéraliste de la Bible. On doit finalement quelque part rendre grâce que ce texte soit arrivé jusqu'à nous, et puis rendre grâce aussi qu'il y a eu des gens pour faire des choix avant nous, même parfois que c'est des mauvais choix, et puis les traducteurs et traductrices bibliques, les réviseuses bibliques.
Mais heureusement qu'on a ces gens-là qui ont ce corps de métier qui nous permet de redécoller un peu de certaines habitudes qu'on a apprises de lecture de la Bible qui maintenant ne font plus tellement sens.
Et cette distance fait grandir. Pour moi, c'est ça une foi mature, c'est de se dire cette Bible, je l'aime. Ces textes me structurent et c'est surtout le fait de les lire en communauté qui me structure.
Mais c'est aussi un livre très complexe et je dois à certains moments me rendre devant la complexité de la composition de ce livre.
La Bible : un livre vivant qui résonne toujours aujourd’hui
Je suis tout à fait d'accord, et même au-delà de juste la simple traduction qui aurait pu être différente, je pense qu'il est essentiel aussi de rappeler que la Bible est un livre ém
Les Églises sont souvent associées aux questions de justice sociale et à la protection des personnes vulnérables. Quel est le coût émotionnel et spirituel associé à toujours dénoncer les injustices? Quelle est la ligne entre prendre la parole et se protéger?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane partagent quelques expériences de dénonciation d’injustices et abordent la délicate question des mouvements militants dans notre société.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Clay Banks, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Existe-t-il quelque chose après la mort ou est-ce que notre existence se termine à notre décès? Cette grande question hante l’humanité depuis des millénaires.
Dans cet épisode, Joan et Stéphane constatent que nous ne possédons pas de réponses définitives devant ce grand mystère et explorent les principes théologiques, bibliques et pastoraux qui nous guident dans cette quête de sens.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Tharva Tulsi, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Transcription:
Bonjour! Bienvenue à Question de croire qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Bonjour Stéphane. Bonjour Joan. Bonjour à toutes les personnes qui sont à l'écoute.
Les points de vue différents sur la vie après la mort
Moi je viens d'un courant religieux ou une tradition confessionnelle, une dénomination, enfin voilà, tous les mots peuvent être utilisés... dans laquelle on ne parle pas beaucoup de ça. On ne parle pas beaucoup de ce qu'il y a dans l'après. À priori, ça va être quelque chose de plutôt bien, plutôt sympa, et surtout, il y aura beaucoup de paix, ça, c'est sûr, ce sera un royaume de paix. J'en étais restée un peu à ça, quelque part, on ne sait pas où, comment ou quoi, mais hyper paisible. Puis un jour, en parlant avec une amie qui est théologienne aussi, qui est religieuse et qui a un arrière-fond évangélique, elle me dit qu'elle ne comprend pas du tout les veufs et les veuves qui se remarient. Vraiment elle ne comprend pas; elle trouve que ça ne fait pas sens d'un point de vue biblique. J'essaie de comprendre un peu parce que j'ai l'impression que les réformateurs se sont mariés avec des veuves et puis voilà, je suis un peu perdue. Elle me dit « mais tu comprends dans la Bible, finalement, comment feront les veufs et les veuves qui se sont remariées? Puisque d'après la Bible, on va tous être réunis dans le royaume, dans le paradis, dans l'au-delà. Finalement, les couples vont se reformer. Mais si tu t'es remariée quand tu es veuf ou veuve, ça n'a pas l'air OK, quoi, par rapport à la Bible ». Moi, je n'avais jamais pensé à ce genre de contingence. C'est là que j'ai découvert que plein de gens se posaient des questions. C'est malheureux, c'est vrai, mais tu perds un doigt. Est-ce qu'après la résurrection des morts, tu retrouveras ce doigt ou pas ? Alors, il y a plein de théories. On aura un corps parfait, on sera dans un état en quelque sorte de perfection et de béatitude. Et donc, du coup, est-ce que les relations amoureuses font partie d'un état de béatitude et de perfection? Oh là, tu ne peux pas savoir! Je n'avais jamais entendu parler de ça et d'un coup, j'avais tellement d'idées dans ma tête!
Le grand mystère de la vie au-delà de la mort
C'est vrai que c'est une des grandes questions de l'humanité. En tant que chrétien, on nous a enseigné qu'il y a quelque chose d'autre. On attend la grande résurrection, le jugement dernier, diront certains. Mais c'est un mystère. Lorsqu'on parle de mystère religieux, on arrive souvent à un niveau qu'on ne peut pas comprendre avec notre cerveau. Ça va au-delà de notre capacité d'imaginer quelque chose. Qu'est-ce que sera cette vie après la mort? On ne sait pas. Il n'y a personne qui est revenu. Bon, on peut dire Jésus, mais... Et je crois que c'est ça le défi. De croire en quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut surtout pas démontrer, et d'essayer de conceptualiser ça, c'est très dur.
Serons-nous les mêmes après la résurrection?
Alors bien sûr, je suis allée un peu chercher des passages bibliques, et c'est vrai qu'il y a Romains 8, 11 : « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Voilà, d'après ce passage, si on en fait une compréhension purement littéraliste, ce qui n'est pas vraiment l'habitude de notre podcast, il faut le dire, eh bien finalement, cette même puissance d'amour rendra la vie à nos corps mortels. Après, est-ce que rendre la vie, c'est redonner exactement la même vie? Est-ce que rendre la vie, c'est nous faire faire la même chose après la Résurrection que ce qu'on a fait avant lors de notre existence terrestre? Comme tu dis, c'est un mystère et j'ai l'impression que les interprétations sont ouvertes, en fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça angoisse les chrétiens et les chrétiennes, si ça les empêche d'avancer dans leur foi. Si ça crée de l'angoisse, il faut qu'on puisse y répondre.
L’incapacité de prouver une vie après la mort
Souvent, j'ai entendu des personnes dire que la religion, c'est un peu comme une béquille pour endurer notre monde parce qu'on nous promet quelque chose de beau, qui a un sens et qu'on va être récompensé au-delà de notre vie terrestre. Mais en même temps, je dis que ça peut être épeurant parce qu’on n'a pas de définition de ce que sera cette vie éternelle, cette vie au-delà de la vie. Et du coup, si ce n'est pas plaisant, on peut être triste pendant longtemps. Du coup, je préfère ma vie terrestre à ma vie au-delà de la mort. Ça peut être complètement angoissant. Donc je ne trouve pas ça nécessairement rassurant de ne pas avoir de réponse claire. Et je comprends qu'il y ait des gens qui veulent savoir, qui vont voir leur pasteur, leur leader d'Église qui lui disent : « Peux-tu me prouver qu'il y a quelque chose au-delà de la vie, au-delà de la mort? Peux-tu me garantir ce que c'est? » Et si on est moindrement honnête, on ne peut pas dire oui, je peux te garantir qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas dire que c'est ceci ou cela.
Peut-on communiquer avec les personnes mortes
Je dois reconnaître que j'ai souvent de la réticence lorsqu'on me parle de démarches consistant à aller voir des personnes qui déclarent avoir cette capacité, ce don de dialoguer avec le monde immatériel, avec celles et ceux qui ne sont plus là, si ce n'est dans nos souvenirs, nos pensées, les traces qu'on a laissées sur terre. Et puis pourtant je comprends, quand on perd quelqu'un, peut-être brusquement, qu'on a beaucoup aimé et avec qui on aurait encore beaucoup de choses à partager. Parfois il y a aussi des interrogations sur comment la personne est morte, est partie, a disparu. Il se trouve que certaines personnes disent avoir cette possibilité d'entrer en contact avec eux. Alors je rentre dans une forme d'empathie, de compassion, de compréhension. Je me dis que pastoralement, c'est tout ce qui nous est demandé en quelque sorte, d'acter le fait que c'est très dur, la mort, le deuil, la séparation, et qu'il y a des moments où en plus ça se passe trop vite. Ce besoin de béquille, toujours autour de la mort.
La recherche de signes d’une vie au-delà de la mort
J'ai grandi dans la tradition Catholique romaine qui accorde une place importante à l'intercession des saints. Parfois, je me demande justement quelle est la différence entre ça et quelqu'un qui fait du spiritisme. Je crois que les gens ont besoin de signes, pour s'accrocher parfois. Tu parles de deuil. Ça me fait penser... Après la mort de mon père, ma mère a invité, pour le repas, certains des frères et sœurs de mon père. Après qu'ils se soient quittés, ma mère m'a raconté qu'il y a eu comme une fluctuation au niveau de l'électricité. Les lumières se sont éteintes et allumées très rapidement. Elle y a vu un signe que mon père était heureux de ça. Après quoi, en tant que bon théologien formé, je vais voir ma mère et lui dire non, non, non, non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est n'importe quoi, ce n'est pas une bonne foi. C'était un signe, qu'elle a perçu, elle, qui l'a aidée dans son processus de deuil. Étant donné que, justement, on ne le sait pas, peut-être que c'est elle qui a raison et que c'est nous qui avons tort. Je pense qu'il y a une certaine forme d'humilité là-dedans : accepter que peut-être nous n'avons pas la bonne réponse. Peut-être que c'est plus complexe ou plus simple qu'on ne l’aimerait.
Ressentir la présence après leur mort
C'est difficile d'avoir justement ces conversations-là avec les gens lorsqu'on veut prouver ou rejeter quelque chose. Je reviens à la Bible et on lit dans le passage de 1 Corinthiens 15 : 49, que nous aurons un corps semblable au corps ressuscité de Jésus. Finalement, Jésus, après sa résurrection, leur a dit de le toucher et de le regarder manger. On voit que ce n'était pas simplement un esprit. On a comme exemple de la résurrection ce double passage terrestre de Jésus, avant et après sa résurrection. On se dit que c'est un petit peu le modèle qu'on a, donc il est probable que notre corps aussi ressuscite d'une façon ou d'une autre. Il y a énormément de théories millénaristes; à un moment donné je m'y étais intéressée et j'avais même trouvé un tableau qui décrivait les différentes convictions selon les Églises de comment ça s'organisera, en fait, quand il y aura l'Armageddon. C'est très complexe et à la fois très subtil. Tout ça nous montre qu'on a besoin de savoir ce qui se passera après. Je reviens à des discussions pastorales que tu as eues, toi aussi Stéphane. Je pense à l'un de mes paroissiens qui aimait beaucoup contredire et qui est maintenant décédé à Winterthur. Il venait aux activités paroissiales parce que c'était en français et qu'il se sentait seul. Mais lui, ce qu'il aimait, c'était être là pour donner du grain à moudre. Il aimait bien poser des questions. Et puis, il avait compris que ça m'amusait beaucoup. On était allés manger ensemble plusieurs fois. Un jour, il me dit, je pense que tu va
Dans notre monde occidental, est-ce qu’être gentil est le synonyme de faiblesse ou une force subversive? Comment nos interprétations de la Bible influencent-elles notre compréhension de la gentillesse?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane essaient de comprendre les liens entre le genre et la notion de gentillesse et plongent au cœur d’expressions et de passage bibliques pour élargir notre compréhension de ce concept.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Tom Parson, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Transcription:
Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, doit-on toujours être gentil? Bonjour Stéphane. Bonjour Joan, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
Faire les choses gentiment
Alors Stéphane, on va commencer gentiment à enregistrer le podcast. Ça, tu vois, cette expression, “gentiment”, c'est une expression vaudoise. Je la connaissais un petit peu d'avant, mais je ne l'avais jamais utilisée aussi fréquemment.
Et je dois reconnaître que j'ai mis un certain temps à bien la saisir, tout simplement. Dans une réunion d'Église, on t'interpelle et on te dit: peux-tu gentiment... faire ceci, dire cela, etc. Du coup je me dis, mais est-ce qu'il/elle voulait dire qu'avant, je n'étais pas gentille?
C’est possible aussi, ce n'est pas très grave; mais je découvre qu'ici ce gentiment, ça veut dire tranquillement, tout doucement, progressivement, bientôt. C'est simplement une façon de mettre les gens en route vers ce qu'on aimerait bien qu'ils ou qu'elles fassent. Que dis-tu, toi, de cette expression « gentiment »?
Gentil : l’attribut des femmes?
On n'a pas d’équivalent, mais quelque part, je ne suis pas surpris que ce genre d'expression existe dans les Églises, parce qu'il y a une perception que lorsqu'on est chrétien, justement, on est gentil, on ne veut pas brusquer, on ne veut pas provoquer.
C'est un peu l'image de la tranquillité, on ne veut pas faire de vagues. Et pourtant, il y a des gens qui revendiquent, il y a des gens qui provoquent les choses, mais on est un peu dans cette mentalité. Je ne suis pas surpris.
“Gentiment”, je pense que c'est répandu dans tout le canton de Vaud, mais ce qui m'a surpris, c'est sa récurrence en Église. Comme tu le dis, ça va aussi avec ce souhait d’avoir une attitude tranquille, qui ne froisse pas, qui ne brusque pas.
Pour moi, c'est un peu un attribut; cette notion d'être gentil, c'est un attribut féminin qui est lié au “care”. Je me rappelle que j'étais devenue un peu dingue, parce qu'il n'y a même pas dix ans, il y avait une enquête dans Réformes, (je salue les lecteurs et lectrices de Réformes), pour essayer de réfléchir au ministère pastoral: femmes, hommes, quelle différence? Je crois qu'on en a parlé dans un autre podcast.
Ce qui était dit quand même, c'était que pendant longtemps, on attendait des femmes qu'elles soient gentilles, qu'elles soient douces, qu'elles soient dans le “care”, qu'elles prennent soin, parce que ce sont des attributs plus féminins que masculin.
Ça fait du bien à l'Église quand il y a des femmes salariées comme ça en position de leadership qui prennent soin des autres. J'avoue que, du coup, ça ne me rend pas toujours très très réceptive à cette notion de gentillesse.
Est-ce une faiblesse d’être gentil?
C'est vrai que la gentillesse est associée à une certaine faiblesse. Ce n'est pas masculin. Et on voit ça ici en Amérique du Nord, une espèce de ressac du féminisme et l'affirmation d'une masculinité que plusieurs appellent toxique. Il faut être fort, il faut être déterminé.
Ça me fait penser à cette histoire datant d’une vingtaine d'années: un ordre religieux féminin avait investi ses avoirs pour faire du développement de projets sociaux et elles se sont fait frauder. Qu'est-ce que tu veux dire par « se faire frauder » ? Ça, je crois que je ne connais pas.
Essentiellement, il y a un promoteur qui est arrivé et qui est parti avec l'argent. Ces religieuses-là ont voulu poursuivre certains intervenants qui ont été négligents. J'ai entendu une entrevue où la personne disait: « Bon, les petites religieuses vont faire leur carême, là, puis elles vont prendre leur trou, et puis tant pis pour elles. »
Cette idée que parce qu'on est femme, qu’on est dans les ordres religieux, on est une espèce de carpette sur laquelle on peut passer… on s'attend à ce que des personnes religieuses se couchent devant la confrontation.
Et pourtant, on a dans la Bible et dans l'histoire de la chrétienté des tonnes et des tonnes d'histoires de femmes fortes, puissantes, qui ont fait des choses, mais qui n'étaient pas faibles, qui n'étaient pas le cliché de la femme gentille.
C'est vrai que j'ai un peu cette difficulté dans le monde chrétien, une méfiance envers les femmes puissantes; effectivement je trouve qu'il y a beaucoup de femmes dans la Bible qui sont puissantes, beaucoup de femmes qui osent, qui sont audacieuses.
C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup valorisé en milieu chrétien, mais j'ai l'impression que c'est dans la société en général.
Être gentil comme des brebis
Je vais commencer notre bataille de versets bibliques; je vois dans notre document partagé que tu as prévu un certain nombre de versets, mon cher collègue. Alors, je vais commencer notre bataille du jour. Il y a un verset biblique qui me permet toujours de le mettre en parallèle avec tous les versets sur la gentillesse et la douceur.
Je pense que c'est important qu'il y ait des versets sur la douceur et la gentillesse. Mais ces versets-là, pour moi, ne peuvent pas se lire sans entendre aussi Jésus nous dire quelque chose dans l'oreille.
Et donc on y va: on est en Matthieu 10. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Oui, les brebis, c'est gentil, c'est mignon. On m’a jamais vu des brebis faire grand chose de méchant, éventuellement charger quelqu'un si tu t'approches de leurs petits, mais bon voilà. Alors que les loups, ça n’est pas très gentil.
Soyez donc prudents comme des serpents. On a une notion de prudence. Encore que les serpents ne sont pas seulement prudents, ils peuvent aussi être assez territorial.
Et ensuite, on a ce « et … » comme les colombes. Alors là, comment est-ce qu'on traduit ce mot-là « akéraios »? Parce que c'est en grec tout ça. On peut traduire par « simple », par « candide », par « pur ». Peut-être d'autres mots que vont nous envoyer des auditeurs ou auditrices.
Et en fait, ce « a », c'est « non », donc quelque chose qui n'est pas. Qui n'est pas quoi? Qui n'est pas mélangé, qui est intact. Voilà, il y a cette négation devant un verbe et on comprend que c'est “ce qui n'est pas mélangé”. Eh bien, sais-tu comment je l'entends? Je l'entends comme le mot « entier ».
« Soyez donc prudents comme les serpents ». OK. Un appel à la prudence. Et « entiers comme les colombes ». Des colombes, c'est tout blanc, ce n’est pas mélangé. Voilà, des colombes blanches.
On comprend la métaphore. Il y a cette notion de “je suis entièrement qui je suis”, et j'aime bien. Pourtant, être entière, pour l'instant, ce n’est pas une qualité qui est unanimement appréciée.
Bienheureux les gentils
On dit souvent: soyez vous-même, soyez authentique, mais pas cet aspect de votre personnalité. Et je crois qu'il y a des moments où il faut monter au front, il faut dénoncer, il faut charger et confronter les autorités, l'Empire, et ainsi de suite, parce qu'on doit dire, ah non, ça, ça ne va pas. C'est inacceptable la façon dont tel groupe est traité.
Mais il y a d'autres moments où montrer de la compassion, c'est important aussi. Ça peut être perçu comme de la gentillesse d'être là pour l'autre et ça fait partie de l'expérience humaine. Mais pourquoi l’un est-il plus valorisé que l'autre?
Dans notre bataille de passages bibliques, ce qui m'est revenu, c'est le discours sur la montagne de Jésus: bienheureux, bienheureuse les doux, les bons.
Et lorsqu'on pense que le but était de provoquer les gens, de renverser les attentes, de dire vous pensez que les meilleurs, les personnes qui vont réussir, ce sont les gens qui sont violents. Non.
Ce sont les gens qui vont avoir de la compassion, qui vont être bons, qui vont exprimer et vivre ça; ces gens-là vont entrer dans le royaume de Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de puissant justement, ce n’est pas un signe de faiblesse que de choisir la bonté, de choisir la gentillesse plutôt que la violence et l'exploitation.
Être gentil peut être subversif
C'est vrai qu'être gentil, ça peut être subversif. Par exemple, quand je vivais à Zurich, on m'avait prévenu que ce n'est pas seulement la mendicité qui est interdite, mais c'est aussi de faire l'aumône. Donc les deux aspects, demander de l'argent ou en donner, étaient formellement interdits.
Je me disais parfois, si je vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, je vais peut-être quand même essayer de l'aider, même si c'est formellement interdit.
C’est incroyable combien il peut y avoir d’arguments. On m'a sorti tellement d'arguments sur le fait que c'est mieux que ce soit interdit, parce que, vois-tu, comme ça, les gens vont chercher de l'aide aux bons endroits, et puis les gens qui sont très occupés ne sont pas dérangés, et puis en même temps ça évite aussi des tas d'incivilités sur la place publique. Moi, je comprends.
L'effet que ça m'a fait quand je suis arrivée à Lausanne: il y avait quelqu'un qui faisait de la mendicité pas très loin de chez moi et une dame s'est arrêtée et a dit à la mendiante: « Oh vous êtes là, ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas vue, est-ce que je peux vous faire un câlin?»
Et cette dame qui
De nos jours, toutes les Églises désirent être inclusive. Est-ce vraiment le cas? Existe-t-il une limite à cette inclusivité? Court-on un danger de perdre des membres à trop ouvrir nos Églises?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane partagent leurs expériences personnelles d’inclusion et d’exclusion et réfléchissent ensemble sur les raisons et les difficultés derrière cette quête.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
En 2008, j’ai rendu visite à ma famille dans le Midwest parce que c'était le mariage de ma cousine. Ma tante, qui a immigré depuis l'Espagne, la France, en bref, l'Europe, il y a déjà un bon bout de temps, elle m'a proposé de demander à l'une de ses meilleures amies que j'aille au culte. Moi, j'avais déjà deux petites mômes, je lui ai dit, je ne vois pas comment on va faire. Elle me dit, ah, t'inquiète, cette copine-là, Beth, elle a un minibus. Donc là arrive une mamie avec déjà plein d'enfants dans le minibus. Moi, je mets les deux miennes dans le minibus rempli, je me dis, OK, cool. Ça a donné la tonalité, si tu veux, de cette visite. C'était dans une communauté unie presbytérienne méthodiste. Donc bon, c'est un peu ta came, il faut dire, dans le Midwest, donc pas trop trop loin non plus. Et on arrive sur place. Déjà, je suis un peu surprise parce que c'est une communauté qui a en plus une école. Mais ça, c'est des trucs qu'on voit dans les milieux luthériens allemands, donc je fais OK. Quand on entre, il y a une énorme banderole qui dit « Stop the torture » ou « End torture », un truc comme ça. Je fais « Ah ouais, contre la torture », ça aussi, c'est pas mal. Et puis, quand je m'installe, je pose poliment la question, comme j'étais assez inquiète de toutes ces questions à ce moment-là, je dis au mari de Beth: « Est-ce que vous avez un peu d'ouverture envers les personnes gays ? » tu vois, j'essaye un peu. Le gars me dit « Ah, ben, oui, enfin, normal, quoi ! » Je fais: pardon? Il me dit « Oui, le responsable du programme jeunesse, ben voilà, il est là; son mari, c'est le chef de chœur; comme vous allez le voir, la pasteure est lesbienne, enfin bon !» Ils ont l'air assez détendus là-dessus. Et puis le gars me regarde et me dit, avec pas mal de gravité: « mais ça c'est réglé, tu vois. Notre vrai souci actuellement, c'est qu'il y a un home de personnes handicapées vraiment pas loin, c'est l'église qui l'a fondé à une autre époque. Et ils n'arrivent pas tous à venir au culte. Je regarde autour de moi, je vois quand même pas mal de personnes âgées, pas mal de familles aussi, puis des gens en chaise roulante ». Alors je lui dis « Ah bon ? » Il me dit « Ben oui, on n'a pas d’ascenseur adapté aux lits médicalisés ». Et là je me dis « OK!!». En fait, voilà mon objectif de toute une vie, tu vois. Depuis ce moment-là, j'ai su que... Enfin, pour moi, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, allez, va avec la force que tu as. Un, tu n'arriveras jamais aussi vite à ce genre d'interrogation. Deux, tu as de la marge. Trois, tu sais qu'ils y arrivent. Donc toi, tu peux faire du plus petit. Ce n'est pas grave, mais va avec la force que tu as.
Ça ressemble un peu à mon contexte où la quête d'inclusion est presque une fin en soi. La question est toujours: qui n'est pas inclus. Il y a une question très légitime en milieu d'église. En même temps, je crois que c'est impossible de tout faire pour toutes les personnes parce qu'on n'a pas des ressources illimitées, on n'a pas une ressource de bénévoles illimitées, on n'a pas des ressources monétaires illimitées. Donc, dans notre monde imparfait, on doit faire des choix; parfois, peut-être, entre guillemets, se spécialiser. Nous, on est capable de faire ça, mais notre paroisse sœur, peut-être à un kilomètre, est capable de faire autre chose. Et l'ensemble de la communauté d'Église peut rejoindre tout le monde. Mais il y a cette idée qu'il faut absolument, à tout prix, inclure tout le monde au lieu de se demander quelles sont les barrières, comment on peut avancer, comment on peut évoluer, comment on peut s'améliorer. Non, c'est la perfection immédiatement et cela met beaucoup de pression parce qu'on est souvent à se taper dessus, se dévaloriser. Oui, mais on n'est pas bon pour ci. Oui, mais on n'est pas bon pour ça. Au lieu de dire, ces huit choses-là, on est très inclusif. Ça, on peut le célébrer. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Puis, on peut s'améliorer. C'est un processus, l'inclusion.
Pour moi, j'ai observé qu'il y a deux écueils dans tout ce qui est projet d'église inclusive, sachant que ça a longtemps été au cœur de mon ministère et que j'ai essayé de lire, de me documenter, d'aller visiter des églises. Il y a l'écueil de “j’ai cette spécificité, donc quand je vais dans cette église qui se dit inclusive, elle doit avoir réfléchi à ma spécificité”. Et ça, c'est un gros écueil parce j'ai un cerveau limité, j'ai un temps limité comme tu l'as dit, puis des fois j'ai des centres d'intérêt limités. Donc, il y a des éléments qui vont m'échapper. Et si on veut que ça s'améliore sur cet élément-là, ce serait vraiment hyper important que tu viennes avec ta spécificité. Et puis, s'il t'en reste, de la patience, de la pédagogie, un petit peu d'humour aussi, parce qu'il y a toujours des moments où ça va coincer et c'est un peu l'humour qui va nous sauver. Le deuxième écueil, c'est: “ça ne me concerne pas, donc je m'en fous”. Moi, je suis valide, il y a trois marches, j'y pense jamais, je m'en fous. Moi, j'entends bien, donc si les autres n'entendent pas bien, je m'en fous. Moi, je ne suis pas queer, qu'on marie ou pas les couples de même genre, je m'en fous. Ce sont les deux écueils que j'ai pu observer. Et parfois, même à l'intérieur des petites communautés inclusives, tu peux trouver ces deux écueils. Et la difficulté, c'est qu'en fait on part un peu du principe qu'il y a des gens, on ne sait jamais trop qui, qui vont trouver des solutions à tous les problèmes. Et bien ces gens-là, ils n'existent pas. Et ce n'est certainement pas les ministres ni les animateurs d'église qui vont trouver toutes les solutions à tous les problèmes. Donc ça demande une dose un peu forte à la fois d'utopie, de patience, de pédagogie et d'humour. C'est tout un ensemble de choses. Et puis, comme tu dis, l'inclusion, c'est vaste, c'est large. Donc, dès le départ, c'est hyper important d'ouvrir le spectre, de dire, voilà, on va essayer de réfléchir à l'inclusion au sens large, et en même temps, il faut sortir de la toute-puissance. On n’est le sauveur et la sauveuse de personne. On n'est pas omniscient, on ne comprend pas tout, on va se planter.
Et nous sommes qui nous sommes ! Moi, par exemple, je suis un homme cis, caucasien, 55 ans, hétérosexuel. Quoi, hétéro? Hétéro! Je veux être un bon allié. C'est d'apprendre comment se comporte un allié. Ce n'est pas de parler au nom des autres, c'est mettre en évidence les autres, peut-être servir d'interprète culturel, parfois, ou de médiateur.
Une anecdote pour toi. Il y a quelques années, j'ai été invité à participer au défilé de la fierté ici à Ottawa en tant que pasteur. Tu as des photos pour le prouver? Non, moi je vais avoir une photo. Oui, j'ai des photos, je voudrais te l'envoyer. Mais ma question était toujours, mais qu'est-ce que je veux faire là? Oui, j'appuie la cause totalement, mais je me sentais à quelque part comme une fraude, parce que pas vraiment membre des communautés LGBTQIA+. Donc, comment être un bon allié, comment appuyer la cause sans voler l'attention, c'est quelque chose qui parfois bloque des personnes. Comment être un bon allié dans tout ça? Comment faire la promotion de l'inclusivité sans usurper l'identité des autres?
Moi aussi, en tant qu'alliée, j'ai à la fois une chance, une bénédiction et une difficulté. Alors ce qui fait ma chance, ma bénédiction, c'est qu'à partir de l'âge de 12 ans, mon père s'est mis en couple avec mon beau-père, Peter, et que d'un côté, il y avait ma maman qui m'élevait dans le foyer qu'on avait à Lémoine, la moitié de la semaine, et l'autre moitié de la semaine, j'étais élevée par mon père et Peter. Et Peter a toujours été un excellent éducateur, notamment parce qu'il était prof de langue, donc c'était parfait. Je faisais mes devoirs avec lui, voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours été très attentif à mon bien-être. Donc, véritablement, j'ai l'impression d'avoir été élevée dans un milieu homoparental, quoi, tout à fait. Et donc, du coup, quand j'ai constaté que les personnes queers n'avaient pas les mêmes droits que les personnes non queers ou bien jugées non queers, ça m'a semblé vraiment important de m'impliquer dans cette cause, d'autant que j'avais trois enfants et que je ne savais pas ce qu'elles allaient devenir elles-mêmes, en fait. Et puis, à un moment donné, j'ai été jugée comme trop visible. En fait, ce qui a fait mon moteur, c'est-à-dire d'être leur fille, eh bien, après, c'est devenu un petit peu mon plus grand défaut, en quelque sorte, parce qu'à certains moments, on me disait « mais tu n'es qu'une alliée » ou « toi, tu es une alliée ». Je me disais « tiens, c'est bizarre, à la base, je le vivais hyper positivement, c'était en quelque sorte ma fierté d'être alliée. Et puis là, c'est une petite connotation négative. Et pourtant, le plus facile dans ma vie, ça aurait été de ne pas m'exposer, tu vois. J'aurais pu choisir cette facilité-là, ce n’est pas parce que tu es fidèle que tu dois t'exposer. Ce serait une injonction et ce serait vraiment dégueulasse. Mais moi, ça m'a été impossible, il fallait que je fasse ce que j'avais à faire, parce que j'avais le sentiment qu'on empêchait des personnes d'avoir accès à l'évangile. Alors vo
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok... Les Églises peuvent diffuser leurs messages sur plusieurs médias sociaux. Mais comment le faire d'une manière éthique? Peut-on dissocier une plateforme de ses propriétaires?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane expliquent les défis des institutions d'Église à utiliser efficacement les médias sociaux, réfléchissent sur les difficultés et les possibilités de cet outil, et présentent les endroits où il et elle se trouvent.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Dole777, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Le sacrement du baptême est reconnu par la grande majorité des Églises chrétiennes. Pourtant, plusieurs questions subsistent. Est-ce que tous les baptêmes sont valides? Qui peut être baptisé? Une Église peut-elle être rebaptisée?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane décrivent les différents rites associés à ce sacrement et se questionnent sur le sens de ce geste.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250
Spotify: https://open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Tamara Govedarovic, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Même s'il est l'une des trois personnes de la Trinité, l'Esprit-Saint demeure un concept difficile à cerner pour plusieurs croyants. Qui est cet Esprit? Quel rôle peut-il jouer dans notre vie de foi?
Dans cet épisode, Joan et Stéphane explorent des passages bibliques et racontent des expériences personnelles au sujet du Saint-Esprit et essaient d'aller au-delà des clichés pour identifier sa présence dans nos vies.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250/
Spotify: open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj/
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Oliver Hihn, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Les handicaps, les maladies chroniques et les enjeux de mobilités sont des réalités de notre monde. Pourtant, les Églises semblent souvent être mal à l'aise devant cette réalité. Dans cette épisode, Joan et Stéphane reçoivent Étienne Lesage, pasteur de l'Église Unie du Canada. Ensemble, ils réfléchissent à nos comportements qui excluent les gens et explorent de nouvelles manières d'aborder ce thème.
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250/
Spotify: open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj/
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Zachary Kyra Derksen, unsplash.com. Utilisée avec permission.
Plusieurs Églises moussent un modèle familial traditionnelle comme la Sainte Famille. Pourtant, il existe plusieurs types de famille dans la Bible. Même Jésus semble avoir choisi sa famille. Quel message envoie-t-on aux familles « différentes »?
Site internet: https://questiondecroire.podbean.com/
ApplePodcast: podcasts.apple.com/us/podcast/question-de-croire/id1646685250/
Spotify: open.spotify.com/show/4Xurt2du9A576owf0mIFSj/
Contactez-nous: questiondecroire@gmail.com
Notre commanditaire: L'Église Unie du Canada Moncredo.org
* Musique de Lesfm, pixabay.com. Utilisée avec permission.
* Photo de Josue Michel, unsplash.com. Utilisée avec permission.