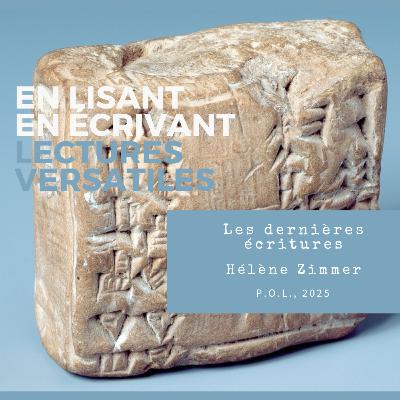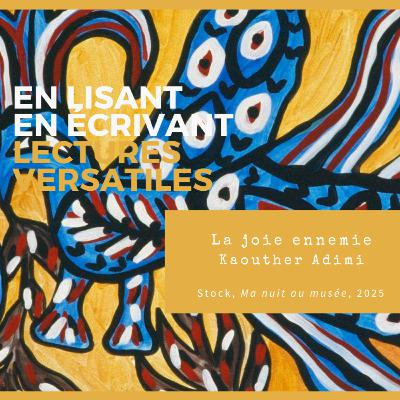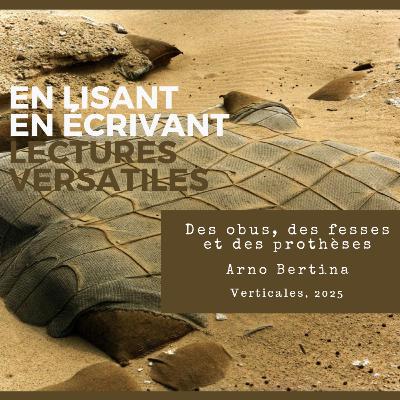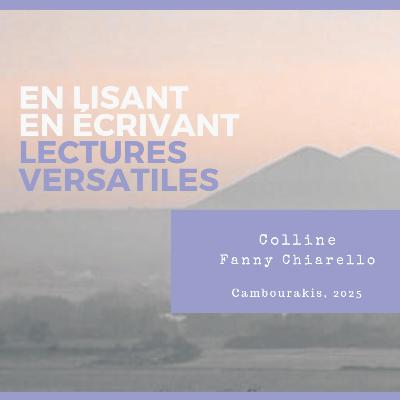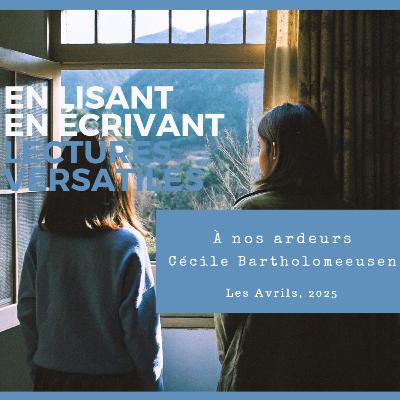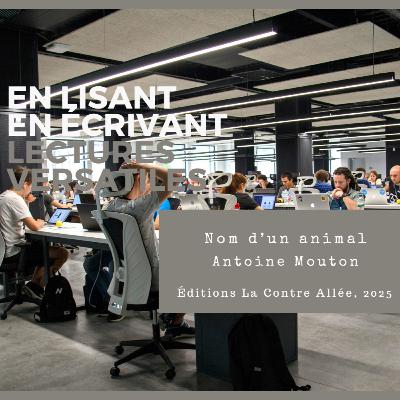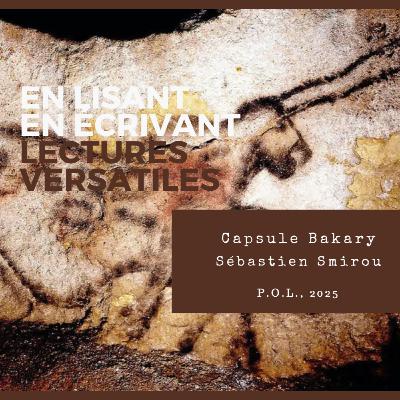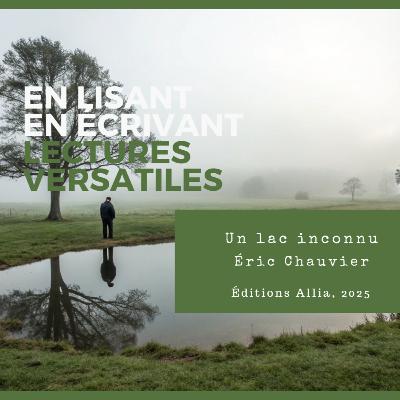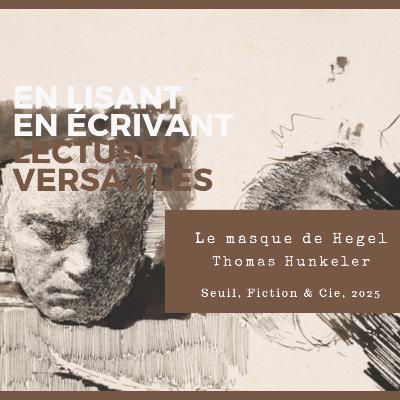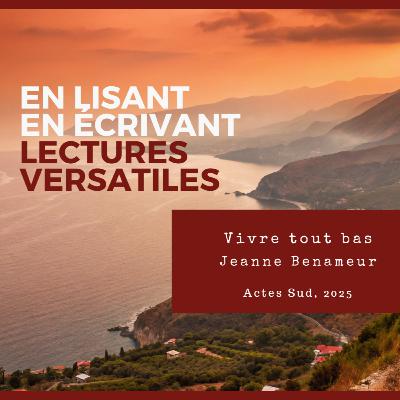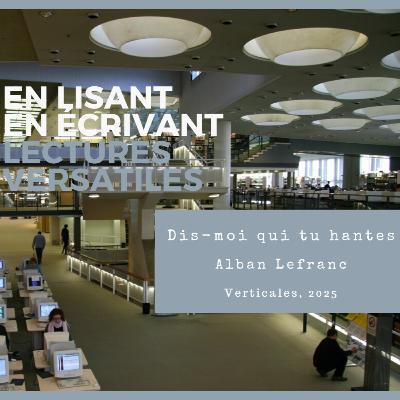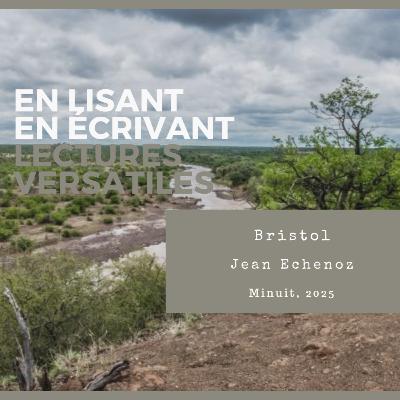Discover en lisant en écrivant
en lisant en écrivant

142 Episodes
Reverse
Professeure de français, Cassandre choisit de remplacer les classiques scolaires qu’elle a l’habitude de faire étudier à ses élèves, par un livre qui décrit l’état alarmant de la planète. Lorsqu’une de ses élèves tente de se suicider, Cassandre est alors accusée de harcèlement moral et traduite en justice. Son procès occupe le centre du récit. On y croise l’enseignante, ses avocats, ceux de la partie adverse, mais aussi un scientifique désabusé qui a participé à l’écriture du livre. Les vies de ces personnages, déjà fragiles, résonnent étrangement avec le chaos écologique qui les entoure. Ce roman choral mêle critique sociale, réflexion sur l’école et méditation sur la catastrophe climatique. L’écriture, vive et parfois ironique, met en parallèle l’effondrement intime des personnages et celui du monde tout en interrogeant la possibilité de transmettre et de continuer à vivre dans un contexte de fin annoncée.Les dernières écritures, Hélène Zimmer, P.O.L., 2025
Le roman s’ouvre sur une demeure abandonnée pendant vingt ans, renfermant objets, photos mutilées et traces de plusieurs générations. À partir de cette maison, l’écrivain remonte le fil d’une histoire familiale marquée par deux guerres mondiales, la vie paysanne et les destins brisés de plusieurs femmes. On croise Marie-Ernestine, musicienne empêchée par un mariage imposé, Marguerite, figure rebelle et humiliée à la Libération, ou encore les hommes partis au front et revenus détruits. En ravivant ces existences oubliées, Mauvignier tente de comprendre l’ombre que ce passé a fait peser sur les siens, jusqu’au suicide de son père en 1983. Le roman est à la fois enquête intime, fresque historique et méditation sur la mémoire transmise par les silences autant que par les récits. Avec son écriture minutieuse et vibrante, l’auteur redonne chair à des vies effacées et fait de cette maison un lieu hanté où s’entrelacent drame familial et mémoire collective.La maison vide, Laurent Mauvignier, Les éditions de Minuit, 2025
Le livre de Kaouther Adimi est le récit d’une nuit passée à l’Institut du monde arabe face aux œuvres de la peintre algérienne Baya. Ce qui commence comme un dialogue avec l’art se transforme en plongée intime dans la mémoire de l’autrice. Baya, révélée très jeune par ses toiles éclatantes, incarne pour Adimi une force de vie et de résistance, miroir de son propre rapport à l’Algérie. Le récit mêle la trajectoire de l’artiste et l’enfance de l’écrivaine dans les années 1990, marquées par la décennie noire. Alors que sa famille choisit de rentrer au pays malgré la menace terroriste, la jeune Kaouther vit la peur au quotidien. Elle enquête aujourd’hui sur cette période, questionne ses proches et confronte souvenirs et images familiales. Ce texte explore ainsi les liens entre art, mémoire et histoire collective, montrant comment la création peut devenir refuge, éclairage et libération face aux ombres du passé.La joie ennemie, Kaouther Adimi, Stock, Collection Ma nuit au musée, 2025
Dans un hôtel près de Tunis, quelques années après la révolution, des femmes en convalescence après des opérations de chirurgie esthétique, leurs corps et leurs visages recouverts d’hématomes et de bleus, côtoient des rescapés de la guerre en Libye, gravement blessés, mutilés, défigurés. Ces femmes augmentées (en guerre contre elle-même, l’acceptation de leur physique) se confrontent à ces hommes diminués. « La chirurgie n’est pas une façon d’éteindre le feu qu’allume en nous le regard des autres, c’est sans doute la trace de cette violence. » Le récit se forme autour de plusieurs personnages, dans la multiplicité des voix qui se font écho, dont le face-à-face souligne une même fragilité : celle d’exister dans le regard et le désir des autres. « Des grimaces, de la laideur, des corps qui se contorsionnent, qui hurlent en essayant de sourire ».Des obus, des fesses et des prothèses, Arno Bertina, Verticales, 2025
Fanny Chiarello dépeint Coline, une adolescente marginale, entre colère et lucidité, vivant dans une ancienne ville minière du Nord de la France, qui fuit un quotidien miné par la désindustrialisation et la condescendance des clichés de classe. Isolée, végane, lesbienne, elle trouve refuge sur les terrils, écoutant Jamila Woods et inventant un dialogue intérieur libérateur, dénonçant la domination, l’exploitation, la confusion des valeurs, et la perte de sens. Grâce à une écriture incisive, une langue inventive et drôle, Fanny Chiarello capte la révolte et la tendresse d’une jeunesse ultra-consciente de sa situation. Colline invente un langage de survie, un monde parallèle pour résister, révélant la puissance vitale de l’imaginaire face au mensonge collectif.Colline, Fanny Chiarello, Cambourakis, 2025
Dans Le passé à venir, l’anthropologue Tim Ingold nous invite à reconsidérer la notion de génération. Un processus continu au lieu d’une succession de strates temporelles. Il rejette par exemple la notion d’héritage qui ne peut pas être considérée comme un transfert statique de biens ou de connaissances, il lui préfère le concept de « perdurance ». Les vies humaines se tissent ensemble telles les torons d’une corde, garantissant ainsi la cohésion, la transmission et l’évolution. Tim Ingold ne soutient pas la conception moderne du progrès linéaire, il nous encourage plutôt à redonner de l’importance au vivant, à la coopération entre générations et à des formes de savoir qui perdurent dans le temps. Il prône une éducation axée sur le dialogue, et une nouvelle manière d’habiter le monde, plus sensible, plus humaine, plus durable.Le passé à venir : Repenser l’idée de génération, Tim Ingold, traduit de l’anglais par Cyril Le Roy), Seuil,Collection La Couleur des idées, 2025
Cécile Bartholomeeusen revient, à travers le récit intime du deuil de son amie d’enfance, libre et intensément connectée à la nature, sur le lien profond qui les unissait. Face à l’effondrement écologique et à l’indifférence du monde, cette amie décide de se suicider. Entre hommage, méditation poétique et réflexion politique, l’autrice explore également la fragilité humaine, la mémoire et la puissance de l’écriture face à l’absence. À travers des fragments mêlant ses souvenirs à de nombreuses citations et références scientifiques ajoutées en marge du récit, l’autrice fait revivre dans les mots celle qui fut pour elle un repère. Ce roman bouleversant interroge ce qu’il reste à sauver, dans le monde comme en soi, quand l’irréversible s’impose.À nos ardeurs, Cécile Bartholomeeusen, Les Avrils, 2025
Ce récit hybride mêle témoignages, expériences personnelles et fragments poétiques, dans une réflexion sensible et pleine d’humour sur l’absurdité du monde du travail. Antoine Mouton revient également sur sa relation à son père, s’interroge sur son nom comme sur son origine. « Quand on me demande d’où je viens, je réponds : d’enfance. » Il agence les mots entre eux, pointe leurs accords leurs écarts et leurs égarements. « Je porte le nom d’un animal commun, qui ne doit sa survie qu’à la domestication, et dont la seule qualité reconnue est de se laisser exploiter. » Et voilà le travail. Une œuvre critique, entre ironie douce et gravité contenue. Une parole libre et originale. « Un poème comme une cicatrice qui rétablirait le contact même fugace entre le monde et soi. »Nom d’un animal, Antoine Mouton, Éditions La Contre Allée, 2025
Ce livre fragmentaire explore le Pacifique comme un espace mental, poétique et politique plutôt qu’un lieu géographique. À travers un « voyage en canapé », l’autrice interroge l’inaccessibilité physique et symbolique de l’océan, devenu surface de projection des fantasmes, des catastrophes et des dominations. Le récit mêle critique de la colonisation, des ravages nucléaires, du capitalisme extractiviste et observation ironique de notre monde numérique, passif et vampirique. Le texte navigue par rebonds et pas de côté, entre observations géopolitiques, fictions, écologie et méditations sur le langage. Refusant toute structure linéaire, Cécile Portier propose une dérive littéraire où l’océan, comme l’écriture, devient fluide, éclaté, imprévisible, miroir instable des tensions humaines et planétaires.Pourquoi Pacifique, Cécile Portier, Les Éditions L, 2025
Le roman de Sébastien Smirou retrace en six chapitres les derniers jours de Bakary qui transforme sa chambre en une capsule temporelle, destinée à témoigner de son existence à d’éventuels survivants. Le récit fragmentaire, tout entier contenu dans un espace clos, mêle introspection, souvenirs et obsessions morbides. Replié sur lui-même, Bakary construit un autel à sa solitude. Il y consigne pensées, souvenirs et hallucinations, hanté par ses parents. Il convoque ses héros imaginaires, ses objets quotidiens (un appareil photo, un frigidaire, un autoportrait, une licorne, la maquette d’une chambre de deux amoureux qui se donnent la mort), qui à leur tour racontent son histoire. Dans une langue lyrique et hantée, le récit explore la fascination pour la mort, les frontières entre réalité, fantasme et mémoire, affirmant une forme d’existence dans l’effacement.Capsule Bakary, Sébastien Smirou, P.O.L., 2025
Ce livre regroupe deux textes de Claude Favre qui se font écho. Temps mêlés confronte éclats du présent et réminiscences personnelles, tandis que Membres fantômes entremêle trois voix (publique, intime et poétique). Écriture de l’urgence et de la lucidité blessée, ses textes refusent l’apathie ambiante, les postures esthétisantes ou les silences complices. Claude Favre y affronte de plein fouet guerres, exils, ravages écologiques, et les fait entrer dans le langage. Elle écrit depuis un trop-plein du réel, une saturation d’horreurs où la poésie demeure pourtant un espace de résistance, de vérité, voire de consolation. Sa voix, radicale et dissidente, en colère, refuse de détourner le regard. Un appel vibrant à une parole vivante, risquée, essentielle, qui engage le corps, le souffle, et rend à la poésie sa puissance d’agir.Membres fantômes / Temps mêlés, Claude Favre, LansKine, 2025
Dans Le cours secret du monde, Hugues Jallon dresse un panorama déroutant de figures marginales ou influentes, ésotéristes, gourous, ingénieurs illuminés, agents doubles, spécialistes du développement personnel, pour explorer les zones troubles où l’occultisme, l’économie et le pouvoir s’entrelacent. À travers un montage d’anecdotes, d’extraits et de réflexions, il interroge le capitalisme comme système ésotérique, construit sur des promesses opaques et des récits à décrypter. Derrière les histoires singulières de ces « chercheurs de vérité » se dessine une logique du secret devenu norme. Le livre, constitué d'une juxtaposition d’éléments différents, nourri de colère et d’humour noir, évolue comme un labyrinthe mental où la lucidité politique flirte avec la paranoïa. Hugues Jallon y esquisse une critique du monde contemporain et un appel à rompre avec ses injonctions absurdes.Le cours secret du monde, Hugues Jallon, Verticales, 2025
Bassoléa, c’est la voix d’une jeune femme « mise au vert » contre son gré. En colère contre le monde et ses absurdités, elle trouve refuge dans une véranda sous terre. Là, elle contemple champignons, bactéries, racines, protozoaires. Elle respire enfin. Curieuse, elle cherche « à traduire dans le monde des humains l’art de vivre des microbes. » Ce monologue haletant, à la croisée du récit initiatique et d’une forme de manifeste écopoétique, critique frontalement notre société du tout-travail, destructrice du vivant, et imagine un corps recyclable, sans trace, en célébrant l’élan vital d’une jeunesse en quête d’alternatives. De sa fureur naît un enthousiasme contagieux, une curiosité pour ce qui pousse, pour ce qui échappe à l’ordre dominant. Un chant vibrant, une parole libre, incarnée, profondément vivante.
Éric Chauvier propose une méditation dense et poétique sur l’histoire de l’humanité. Depuis l’émergence de la bipédie jusqu’à l’ère de l’intelligence artificielle, il retrace les grandes étapes du progrès humain : la maîtrise du feu, l’apparition du langage, l’invention de l’agriculture, le développement des technologies modernes. À travers ce récit épuré et philosophique, l’auteur interroge notre rapport au temps, à la finitude et au progrès. Chaque avancée est perçue comme une tentative de conjurer l’angoisse de la mort, un effort pour dominer l’incertitude inhérente à la condition humaine. Mais ces progrès nous apaisent-ils réellement ? En explorant cette quête illusoire d’un dépassement de soi, l’auteur invite à une réflexion profonde sur notre destin collectif et sur ce que signifie véritablement être humain.Un lac inconnu, Éric Chauvier, Éditions Allia, 2025
Un Carré de Poussière explore la manière avec laquelle la philosophie occidentale s'est construite contre certains corps et certaines matières. Entre exploration poétique, témoignage personnel et enquête existentielle, le livre dénonce les violences genrées, les mécanismes de domination et les silences de l'histoire. Olivia Tapiero refuse toute assignation définitive en cherchant à déconstruire radicalement les cadres philosophiques et historiques de notre perception du réel. Elle instaure, dans ce poème qui pense, une nouvelle forme de connaissance et de relation au monde. Une exploration radicale du langage et du corps, un refus de l’effacement et de l’oubli. Un carré de poussière, Olivia Tapiero, Éditions du commun, 2025
Thomas Hunkeler mène une enquête littéraire et historique sur le masque mortuaire du philosophe allemand qui est conservé aux Archives littéraires allemandes de Marbach, près de Stuttgart. À partir d’une lettre d’André Breton à Paul Éluard mentionnant son existence, il interroge son authenticité et sa signification. Thomas Hunkeler révèle la fascination pour ces objets funéraires, tout en proposant une histoire parallèle du surréalisme. Entre mythe et réalité, ce masque s’avère trace du défunt aussi bien que projection de ceux qui l’observent. Dans cette mise en récit d’un essai, entre érudition et esprit d’investigation, Thomas Hunkeler éclaire un pan méconnu du rapport des avant-gardes à la mort et à l’héritage des figures intellectuelles, tout en s’attachant à montrer la « dimension collective de la poétique du masque mortuaire ».Le masque de Hegel, Thomas Hunkeler, Seuil, Collection Fiction & Cie, 2025
Jeanne Benameur donne une voix à une femme silencieuse, recluse au bord de la mer, à l'écart d'un village de pêcheurs, portée par un chagrin plus grand qu’elle la mort de son fils, le vide laissé par cette disparition. Sans jamais la nommer, elle nous la fait reconnaître : Marie, la mère de celui qui n’était pas seulement son fils. Ici, pas d’iconographie figée ni de parole divine, mais une femme incarnée, qui écrit, lit, et se reconstruit. À travers une prose lumineuse et sensorielle, l’autrice tisse un récit d’émotions et de résilience, où chaque geste, chaque rencontre, esquisse un chemin de renaissance. Dans la douceur du ressassement et le murmure des vagues, ce roman ouvre un espace de liberté, d'acquiescement au monde.
Le roman d’Alban Lefranc dont le titre souligne que notre nature se révèle à travers les relations que nous choisissons, explore la figure de Julien Mana, écrivain assassiné en 2022, à travers les témoignages de sept personnes qui l’ont côtoyé. Chaque voix révèle une facette différente du personnage : les ambitions littéraires, les relations tumultueuses, le charisme autant que les failles de cet être contrasté, autodidacte brillant, instable, en proie à des pulsions incontrôlées. Son premier livre,La Vision dans l’île, une histoire d’obsession et d’errance, semble refléter sa propre quête existentielle. Le roman se construit comme un puzzle, où chaque témoignage éclaire différemment l’identité insaisissable de cet auteur fictif, entre talent brut, contradictions et autodestruction.Dis-moi qui tu hantes, Alban Lefranc, Verticales, 2025
Dans son premier roman, Clothilde Salelles nous plonge dans le
quotidien d’une famille des années 90, en banlieue parisienne. À travers les yeux d’une enfant, on découvre un univers où le silence est pesant, les nuits troublées, et le père, reclus dans son bureau ou absent, une figure aussi fascinante qu’insaisissable. Les mots eux-mêmes deviennent des énigmes, entre ce qui est dit et ce qui reste tabou. Avec une écriture mêlant poésie et suggestion, l’autrice explore, avec une acuité presque fantastique, la mémoire, les non-dits, et l’impact du langage sur nos vies. Le récit s’articule autour d’un drame central, évoqué mais jamais nommé. Un roman sensible et troublant sur les liens familiaux et la manière dont on se construit face à l’absence et aux silences.
Nos insomnies, Clothilde Salelles, Collection L’arbalète, Gallimard, 2025
Bristol de Jean Echenoz s’ouvre sur une scène intrigante : un
inconnu dégringole du cinquième étage d’un immeuble parisien. C’est le point de départ d’une série de péripéties aussi cocasses qu’imprévisibles. Au centre de ce tourbillon narratif, Robert Bristol, réalisateur, s’apprête à adapter un best-seller au cœur de l’Afrique australe. De Paris à Bobonong, en passant par Nevers, Echenoz entraîne le lecteur dans un périple empreint d’humour et d’élégance, peuplé de personnages excentriques. Le roman oscille entre vaudeville, comédie et
mystère, mêlant aventures, amours contrariées et rebondissements inattendus, avec la précision stylistique et l’esprit décalé qui caractérisent l’auteur depuis plus de 40 ans.
Bristol, Jean Echenoz, Minuit, 2025