Discover Assez parlé, le podcast qui donne envie d'écrire de l'école Les Mots
Assez parlé, le podcast qui donne envie d'écrire de l'école Les Mots
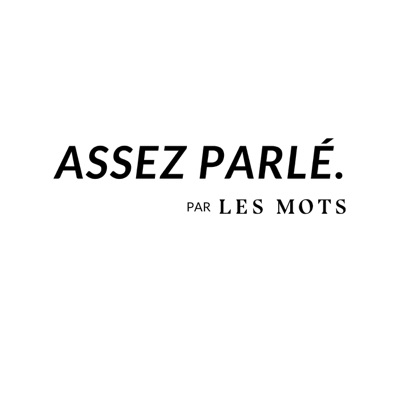
Assez parlé, le podcast qui donne envie d'écrire de l'école Les Mots
Author: Assez parlé par l'école d'écriture Les Mots
Subscribed: 257Played: 3,710Subscribe
Share
© Elise Nebout
Description
Assez parlé, le podcast où les écrivains se livrent. Pourquoi se sont-ils lancés dans l'écriture ? Qui sont les écrivains d'aujourd'hui ? Où écrivent-ils ? Les Mots leur pose la question !
“Écrire” : un acte divin, ineffable, inspiré ? A l’école d’écriture Les Mots, on tourne ce verbe dans tous les sens, et on pose toutes les questions, même les plus “sacrées”. On considère que l’écriture s’exerce, se raconte, se transmet, se chante, se dit, s’écrie. Dans le Podcast “Assez parlé”, on veut entendre les écrivains nous raconter leur quotidien et nous donner envie d’écrire. Le mythe de l’écrivain silencieux, on en a assez parlé. Aujourd’hui, ce sont eux que nous voulons entendre. Non pas les écrivains fantasmés, mais ceux que nous croisons dans nos ateliers d’écriture tous les jours et qui - on vous le promet ! - adorent bavarder pendant des heures en répondant aux questions qu’on ne leur pose jamais. Comment écrivent-ils ? Pourquoi ? A qui ? Depuis quand ? A quelle heure s’y mettent-ils ? A quel endroit ? A quoi ressemble leur livre avant d’être un livre ? Quelles voix tournent dans leur tête au moment où ils se mettent à leur table de travail ? Et comment ces voix, ces mots qui se bousculent dans leur cerveau deviennent-ils des histoires, récits, des nouvelles, des scenari ? Comment ont-ils débuté ? Continué ? Quelles ont été leurs plus grandes difficultés ?
Elsa Flageul, David Thomas, Alice Zeniter, Yannick Haenel, Chloé Delaume, Agnès Michaux, Philippe Honoré… chaque mois, nous rencontrons les écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle, ceux qui animent les ateliers d’écriture de l’école Les Mots, pour les interroger sur leur parcours et leur pratique d’écriture. Une précieuse collection d’entretiens pour connaître les joies, les doutes, les dessous de la vie d’écrivain et pour réveiller le désir d’écrire !
Les Mots : Apprendre et s'inspirer auprès d'écrivains reconnus partout dans le monde (https://lesmots.co).
Les Mots est une école d'écriture qui permet la transmission du savoir entre écrivains et personnes désireuses de progresser dans l'art d'écrire. Depuis son lancement, l'école a accueilli plus de 2500 participants et constitué un réseau de plus de 100 auteurs reconnus dans leur domaine, de Yannick Haenel à Isabelle Sorente, de Charles Pépin à Alice Zeniter. Heureux hasard de l’histoire, l'école se trouve dans une rue qui porte le nom d'un célèbre poète italien, la rue Dante, dans le quartier historique de la transmission littéraire à Paris, le quartier latin.
Depuis que nous avons ouvert nos portes, plus de 10 000 participants ont suivi nos ateliers. Certains pour leur épanouissement, d’autres pour acquérir des compétences rédactionnelles utiles dans leur profession, d’autres enfin parce qu’ils avaient un projet de livre en tête. Plus de 80 de nos anciens « élèves » ont été publiés à ce jour. Et tous ont pris plaisir à écrire !
Au micro, la talentueuse Lauren Malka, collaboratrice de l'école depuis plusieurs années :
Journaliste et autrice, Lauren Malka interroge les écrivains dans la presse, à la radio, dans les festivals et à la télévision depuis 10 ans et n’a toujours pas épuisé toutes ses questions !
Diplômée du CELSA, formée à la littérature, à la philosophie et inspirée par son époque, elle chronique chaque mois dans les pages « livres » (entre autres) du Magazine Causette. En 2018, elle y a aussi publié sa première nouvelle de fiction. Le reste du temps, elle écrit un film-documentaire sur l'histoire de France à travers ses pratiques culinaires, anime des émissions de radio, et organise les événements littéraires de plusieurs institutions, salles de concerts (Ground Control, La Bellevilloise) et festivals. Jusqu'en 2017, elle a coordonné l'émission « Au Fil des mots », présentée par Christophe Ono-dit-Biot sur TF1.
Elle a signé deux livres : « Les journalistes se slashent pour mourir. La presse face au défi numérique » (Robert Laffont, 2016) et « Le Goût de la philosophie » (Mercure de France, 2019).
“Écrire” : un acte divin, ineffable, inspiré ? A l’école d’écriture Les Mots, on tourne ce verbe dans tous les sens, et on pose toutes les questions, même les plus “sacrées”. On considère que l’écriture s’exerce, se raconte, se transmet, se chante, se dit, s’écrie. Dans le Podcast “Assez parlé”, on veut entendre les écrivains nous raconter leur quotidien et nous donner envie d’écrire. Le mythe de l’écrivain silencieux, on en a assez parlé. Aujourd’hui, ce sont eux que nous voulons entendre. Non pas les écrivains fantasmés, mais ceux que nous croisons dans nos ateliers d’écriture tous les jours et qui - on vous le promet ! - adorent bavarder pendant des heures en répondant aux questions qu’on ne leur pose jamais. Comment écrivent-ils ? Pourquoi ? A qui ? Depuis quand ? A quelle heure s’y mettent-ils ? A quel endroit ? A quoi ressemble leur livre avant d’être un livre ? Quelles voix tournent dans leur tête au moment où ils se mettent à leur table de travail ? Et comment ces voix, ces mots qui se bousculent dans leur cerveau deviennent-ils des histoires, récits, des nouvelles, des scenari ? Comment ont-ils débuté ? Continué ? Quelles ont été leurs plus grandes difficultés ?
Elsa Flageul, David Thomas, Alice Zeniter, Yannick Haenel, Chloé Delaume, Agnès Michaux, Philippe Honoré… chaque mois, nous rencontrons les écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle, ceux qui animent les ateliers d’écriture de l’école Les Mots, pour les interroger sur leur parcours et leur pratique d’écriture. Une précieuse collection d’entretiens pour connaître les joies, les doutes, les dessous de la vie d’écrivain et pour réveiller le désir d’écrire !
Les Mots : Apprendre et s'inspirer auprès d'écrivains reconnus partout dans le monde (https://lesmots.co).
Les Mots est une école d'écriture qui permet la transmission du savoir entre écrivains et personnes désireuses de progresser dans l'art d'écrire. Depuis son lancement, l'école a accueilli plus de 2500 participants et constitué un réseau de plus de 100 auteurs reconnus dans leur domaine, de Yannick Haenel à Isabelle Sorente, de Charles Pépin à Alice Zeniter. Heureux hasard de l’histoire, l'école se trouve dans une rue qui porte le nom d'un célèbre poète italien, la rue Dante, dans le quartier historique de la transmission littéraire à Paris, le quartier latin.
Depuis que nous avons ouvert nos portes, plus de 10 000 participants ont suivi nos ateliers. Certains pour leur épanouissement, d’autres pour acquérir des compétences rédactionnelles utiles dans leur profession, d’autres enfin parce qu’ils avaient un projet de livre en tête. Plus de 80 de nos anciens « élèves » ont été publiés à ce jour. Et tous ont pris plaisir à écrire !
Au micro, la talentueuse Lauren Malka, collaboratrice de l'école depuis plusieurs années :
Journaliste et autrice, Lauren Malka interroge les écrivains dans la presse, à la radio, dans les festivals et à la télévision depuis 10 ans et n’a toujours pas épuisé toutes ses questions !
Diplômée du CELSA, formée à la littérature, à la philosophie et inspirée par son époque, elle chronique chaque mois dans les pages « livres » (entre autres) du Magazine Causette. En 2018, elle y a aussi publié sa première nouvelle de fiction. Le reste du temps, elle écrit un film-documentaire sur l'histoire de France à travers ses pratiques culinaires, anime des émissions de radio, et organise les événements littéraires de plusieurs institutions, salles de concerts (Ground Control, La Bellevilloise) et festivals. Jusqu'en 2017, elle a coordonné l'émission « Au Fil des mots », présentée par Christophe Ono-dit-Biot sur TF1.
Elle a signé deux livres : « Les journalistes se slashent pour mourir. La presse face au défi numérique » (Robert Laffont, 2016) et « Le Goût de la philosophie » (Mercure de France, 2019).
28 Episodes
Reverse
Qu’est-ce qu’une écriture engagée ? Les écrivain(e)s actuel.les affrontent cette question de façon plus brûlante qu’auparavant. Non seulement parce que la presse les encourage à prendre position dans les débats de société. Mais aussi parce que la figure de l’écrivain.e engagée, tombée en disgrâce après les années 1970, reprend ses lettres de noblesse ces jours-ci. Il ne s’agit pas seulement d’intervenir dans les débats, mais aussi de chercher des formes littéraires qui remettent en question l’ordre établi et aident à envisager le monde d’après. Qu’en pensent les écrivain(e)s qui animent des ateliers à l’Ecole Les Mots ? S’agit-ils, selon eux.elles, d’injonctions à s’engager ? Se sentent-ils écrivain(e)s ? Ou y perçoivent-ils une urgence incontournable face aux grandes questions que notre société traverse ? Dans cet épisode, nous posons la question à Louise Browaeys, Belinda Cannone, Emmanuelle Favier, Grégory Le Floch, Denis Michelis. Cinq écrivain(e)s que nous avons choisi(e)s parce que leurs œuvres nous inspirent un lien fort à la notion d’engagement - parfois, et c’est ce que révèle cet épisode, à leur corps défendant !Ecrivain(e)s qui interviennent dans cet épisode : Louise Browaeys, autrice de trois romans : La Dislocation, en 2020 (HarperCollins), Fais Battre ton tambour, en 2022, (HarperCollins) et La Reverdie en 2023 aux Editions de La Mer Salée.Belinda Cannone, romancière et essayiste. Ses livres les plus récents sont des essais : “Le Nouveau Nom de l'amour”, Stock, 2020, Petit éloge de l'embrassement, Gallimard, coll. « Folio 2 euros », 2021 et un recueil de nouvelles “Le vis-à-vis, nouvelles érotiques”, éd. La Pionnière, 2023Emmanuelle Favier, romancière, poétesse, dramaturge et nouvelliste. Elle est autrice de trois romans parus chez Albin Michel “Le Courage qu'il faut aux rivières” (2017), puis “Le Livre de Rose”, paru en 2023 aux éditions Les Pérégrines. Elle vient de faire paraître aussi sa traduction de “La Mégère apprivoisée” de Shakespeare, aux Belles Lettres.Grégory Le Floch, auteur de quatre romans : “Dans la forêt du hameau de Hardt” (Éditions de l'Ogre) paraît en 2019, “De parcourir le monde et d’y rôder chez Christian Bourgois, roman qui remporte les Prix Décembre, Wepler et Transfuge Découverte. “Gloria, Gloria”, Christian Bourgois Éditeur, 2023. Et “Éloge de la plage” aux éditions Rivages. Il gagne aussi en 2023 le prix Sade pour son roman Gloria, Gloria.Denis Michelis, auteur de “La chance que tu as” chez Stock en 2014, “Le Bon Fils” (2016), “État d'Ivresse” (2019) et “Encore une Journée Divine” (2021) en cours d’adaptation au théâtre. En janvier 2024, il publie “Amour Fou” chez Noir sur blanc.Crédits :Création et réalisation : Lauren Malka. Montage : Lauren Malka Mixage : avec la collaboration de Thomas Aguettaz Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Romancière et autrice de fictions radio sur France Culture, Sophie Lemp tient en équilibre sur un fil littéraire, nostalgique et cadencé sur lequel elle nous entraîne depuis son tout premier roman, “Le Fil” (Editions de Fallois, 2015) - un livre construit à partir de sa correspondance réelle avec sa grand-mère. En 2023, elle achève deux projets très personnels et cruciaux pour elle : d’un côté l’écriture d’une fiction audio sur l’un des cinéastes-bonnes fées qui s’est penché sur son berceau d’écrivaine, Jacques Demy - dans ce podcast, elle cite d’ailleurs d’autres cinéastes, écrivain.es, musicien.nes ont participé à sa vocation : Barbara, Claude Sautet, mais surtout Annie Ernaux avec qui elle entretient une forme d’amitié littéraire unique et précieuse. Et en parallèle, elle publie l’un de ses romans les plus intimes “La Fille que tu étais” (Herodios Editions, 2023) sur les amitiés quasi-amoureuses, passionnées et douloureuses de l’adolescence. Dans cet épisode, elle parle de la place que cette période occupe dans ses pensées, dans ses carnets et sous sa plume. Lorsqu’elle écrit, nous explique-t-elle, c’est dans le corps de la fille qu’elle était à l'époque qu’elle replonge immanquablement, sans le décider. On la suivrait jusqu’au bout de son île, à pas feutré, en suivant le fil de sa plume délicate, mi-triste mi-entraînante, sans hésiter.
En 2024, Sophie Lemp projette de travailler les voix d’Annie Ernaux sous la forme d’une création audio et de poursuivre ses ateliers d’écriture à l’Ecole Les Mots : “Trouver sa voix” et “Ecrire la vie”.
Extrait lu dans l’épisode
“Le Fil” de Sophie Lemp (Editions De Fallois, 2015)
Autres oeuvres citées dans l’épisode
“La fille que tu étais” de Sophie Lemp (Editions Herodios Editions, 2023)
“Les miroirs de Suzanne” de Sophie Lemp (Allary Editions, 2019)
“Leur séparation” de Sophie Lemp (Allary Editions, 2019)
“Jacques Demy, éclats d’une vie” de Sophie Lemp sur France Culture (2023)
“Billie Hollyday night and day” de Sophie Lemp sur France Culture (2016)
“L’événement” d’Annie Ernaux adapté par Sophie Lemp sur France Culture (2011)
Crédits pour l’épisode 26
Création et réalisation : Lauren Malka. Montage : Lauren Malka Mixage : avec la collaboration d’Anne Astolfe Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Maison Dīcēs. Direction générale : Elise Nebout.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Pour Eric Faye, le “réel” est un tremplin à destination de son imagination ! Les rebonds l’emmènent vers des nouvelles, des romans, des récits de voyage, parfois des essais… Impossible de savoir à l’avance ce que lui réserve sa création. Ce qui est sûr, c’est qu’il danse avec elle depuis qu’il est un enfant.
Dans cet épisode, un hors-série enregistré en public sur la prestigieuse scène du Centre Pompidou, dans le cadre de la quatrième édition du Festival “Effractions” consacrée au thème du “Réel”, le romancier Eric Faye nous raconte sa façon singulière d’inviter le “réel” dans chacun de ses romans. Après trente-cinq livres à travers lesquels il alterne entre des fables quasi-fantastiques, souvent inspirées de faits divers et des non-fictions, Eric Faye vient de publier un roman largement inspiré de sa propre vie “Il suffit de traverser la rue” (Seuil, 2023). Dans ce roman, il est question d’un journaliste d’agence de presse, écrasé par la folie productiviste du monde contemporain, qui rêve de devenir ce qu’il est déjà au fond de lui : un écrivain. Eric Faye nous raconte sa double-vie à l'époque où il était journaliste et écrivain. Il explique la conquête de liberté que représentait, pour lui, l’écriture de chacun de ses romans avant d’être publié. Il se rappelle de la difficulté de trouver sa musique intérieure au moment où le brouhaha du réel l’envahissait. Il revient aussi sur son enfance, les premières histoires qu’il a inventées parce qu’il était frustré de ne pas pouvoir les lire. Et puis, ce premier manuscrit de plus de cinq-cent pages tapées à la machine à écrire, avec la gravité que représentait la “frappe” comparée à ”l’illusion du provisoire” que l’on ressent face à l’ordinateur. Il nous dévoile aussi une partie de son “musée personnel” composé de ce manuscrit inédit, mais aussi de lettres de refus d’éditeurs, parfois les mêmes qui ont participé à saluer son œuvre des années plus tard ! Lauréat du grand prix de l’Académie française pour Nagasaki, du prix des Deux Magots pour Le gardien du phare, auteur d’une oeuvre aussi prolifique que cohérente, qui a marqué un grand nombre de lecteur.rices contemporain.e.s, Eric Faye continue de se promener, le nez au vent, dans ce réel qui le dérange mais qui ne l’empêche pas de rebondir encore et toujours vers d’autres recoins de son imagination.
Extrait lu dans l’épisode
“Il suffit de traverser la rue” d’Eric Faye (Le Seuil)
Crédits pour l’épisode 25
Création et réalisation : Lauren Malka.
Montage : Lauren Malka
Mixage : avec la collaboration d’Anne Astolfe
Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand
Identité graphique : Maison Dices.
Direction générale : Elise Nebout. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans cet épisode, un hors-série enregistré en public sous la forme d’une masterclass suivie d’exercices d’écriture à l’école Les Mots le 18 janvier 2023, Serge Joncour est interrogé sur son parcours depuis ses premiers écrits d'enfance jusqu'à son dernier roman.
À l'époque où il cherchait sa vocation, Serge Joncour a exercé tous les métiers possibles - maître-nageur, livreur de journaux, cuisinier, rédacteur-publicitaire.... Mais il n'a jamais réalisé son rêve ultime : devenir nageur de combat ! Le voici donc écrivain. Mais pourquoi cela ? Comment en est-il arrivé là ?
Dans cet épisode, un hors-série enregistré en public sous la forme d’une masterclass suivie d’exercices d’écriture à l’école Les Mots le 18 janvier 2023, Serge Joncour est interrogé sur son parcours depuis ses premiers écrits d'enfance jusqu'à son dernier roman, en passant par ses nombreux succès (prix Femina 2022, Landerneau, Interallié... adaptations au cinéma, traductions dans plus de quinze langues), ses doutes, ses renoncements, ses "pressentiments". Il lui arrive de répondre à certaines de ces questions. Mais la plupart du temps, il procède par digressions sinueuses, tours et détours oulipiens autour de la grande question qui le préoccupe ce soir-là : comment peut-il finir sa trilogie ? Sur quelle scène finale peut-il dire adieu aux personnages avec lesquels il vient de passer quatre ans de sa vie ?
Y est-il parvenu ? La réponse est en partie dans cet épisode et en partie dans son prochain roman, la suite de Nature humaine, Chaleur humaine, en librairie en septembre 2023 (Flammarion). On compte sur vous pour ne pas manquer ces deux rendez-vous !
Crédits pour l’épisode 24
Création et réalisation : Lauren Malka
Montage : Lauren Malka
Mixage : avec la collaboration d’Anne Astolfe
Musique : “Machine à écrire”
Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand
Identité graphique : Nina Jovanovic
Direction générale : Elise NeboutHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Poétesse d’expression française, essayiste, romancière, traductrice née au Japon et installée en France depuis 25 ans, Ryoko Sekiguchi parle d'écriture comme d'un nouveau met qu'elle s'apprête à déguster. Le plaisir et la légèreté semblent à chaque fois se renouveler. Pendant son enfance, elle considérait qu’elle ne parviendrait jamais à écrire car elle ne se sentait pas capable d’ « inventer d'histoires ». Elle imaginait un lapin mais le laissait aussitôt de côté car elle ne savait pas où l’emmener. Alors pour assouvir sa soif littéraire (et retrouver tous ces lapins abandonnés !), elle pensait devenir bibliothécaire.
A 16 ans, Ryoko Sekiguchi découvre que l’on peut inventer des mondes sans forcément commencer par "il était une fois". La voilà donc poétesse et très vite primée par un jury de poésie pourtant peu ouvert d’esprit avec les femmes de lettres.
Autrice d'une vingtaine de livres en français et en japonais, elle a aujourd'hui imposé sa voix comme la poétesse et écrivaine de langue française la plus reconnue pour écrire, sublimer et penser les langues, les cuisines et les parfums du monde ! Ses thèmes de prédilection sont la gastronomie, la poésie, les voyages, les mots et les êtres. Son dernier livre, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent vient de paraître chez Folio.
Dans cet épisode, un hors-série enregistré en public sous la forme d’une masterclasse suivie d’exercices d’écriture à l’école Les Mots le 22 septembre 2022, elle raconte son étonnant parcours, de Tokyo à Paris en passant par Beyrouth, son rapport aux langues qui lui donnent l’impression d’habiter d’autres corps que le sien, son rapport aux villes, aux odeurs, aux goûts mais surtout aux voix des êtres (et parfois des choses) avec lesquelles elle tisse ce qu’on appelle en japonais le “kikigaki”, une littérature de l’écoute (un terme intraduisible en français). La conversation si joueuse, parfois fantasque et profonde sur son rapport à l'écriture a été suivie d’exercices créatifs auxquels les personnes présentes ont pu se prêter.
Livres cités pendant l’épisode
Cassiopée Péca, 1993
Calque, P.O.L, 2001.
Ce n'est pas un hasard, Chronique japonaise, P.O.L., 2011.
L'Astringent, éditions Argol, coll. Vivres, 2012.
Manger fantôme, Argol, coll. Vivres, 2012.
Le Club des gourmets et autres cuisines japonaises, P.O.L, 2013.
Fade, Les ateliers d'Argol, coll. Paradoxes, 2016.
Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va, P.O.L, 2018.
961 heures à Beyrouth (et 321 plats qui les accompagnent), P.O.L., 2021
Crédits pour l’épisode 23
Création et réalisation : Lauren Malka.
Montage : Lauren Malka
Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand
Identité graphique : Nina Jovanovic.
Direction générale : Elise Nebout.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Elle est entrée par ici, elle ressortira par là ! En un mot, elle est imprévisible. Autrice jeunesse multi-primée en France et au Royaume-Uni, poétesse, Clémentine Beauvais est aussi enseignante-chercheuse à l’université de York (Grande-Bretagne), brillante essayiste et traductrice de grandes écrivaines anglophones comme Sarah Crossnan, Christina Rossetti, Audre, Lordre, Maya Angelou et … J. K. Rowling ! Cling ! Mais quelle tour de magie nous réserve-t-elle encore ?
Publiée pour la première fois à 21 ans, Clémentine Beauvais a trouvé le temps très long avant cette première parution. Et pour cause. Ses manuscrits étaient prêts depuis très longtemps. Dans cet épisode, elle raconte les premiers romans qu’elle a adressés aux maisons d’édition, à seulement 9 ans, accompagnés de lettres rédigées à la main : “Cher éditeur, voici mon premier livre, il est super !”. Elle revient sur les premiers retours d’éditeur.rice.s, les rencontres qui ont fait évoluer son rapport à l’écriture, à la noirceur, à la satire, à la légèreté et à la poésie. Et elle nous parle de sa conception de la littérature jeunesse et de l’incompréhension si fréquente dont celle-ci fait l’objet.
A l’école Les Mots, Clémentine Beauvais anime régulièrement un atelier d’écriture à distance sur le thème “Ecrire l’enfance”, un sujet qui la passionne et sur lequel elle s’est, comme elle dit, "trituré la cervelle” depuis très longtemps.
En novembre 2022, elle enfilera sa casquette de chercheuse pour publier “Ecrire comme une abeille” chez Gallimard, un essai documenté, impressionnant d’érudition, qui se déguste comme un bonbon d’intelligence, pour s’interroger, entre autres, sur le rôle des parents dans le vaste monde imaginaire que créent les enfants.
Extrait lu dans l’épisode :
“Décomposée” de Clémentine Beauvais (L’iconopop)
Crédits pour l’épisode 22 :
Création et réalisation : Lauren Malka.
Montage : Noémie Sudre
Musique : “Machine à écrire”
Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand
Identité graphique : Nina Jovanovic.
Direction générale : Elise Nebout.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans cet épisode, Emmanuelle Bayamack-Tam revient sur ses “lectures omnivores”, ses premiers travaux d’écriture qui ne se réduisaient pas aux journaux intimes d’adolescente mais constituaient déjà de vraies fictions. Elle raconte sa rencontre avec le grand éditeur Jérôme Lindon...
Emmanuelle Bayamack-Tam ressemble à un personnage de fiction. On l’imagine bien, en forçant à peine le trait, jouer son propre rôle au cinéma : celui d'une écrivaine reconnue, aussi altière et tranchante que sa plume, sur laquelle des étudiant.e.s pourraient se pencher pour rédiger leurs travaux universitaires. Elle expliquerait aux un.e.s et aux autres, comme dans ce podcast, la façon dont elle fait vivre ses personnages mutants et travaille ses obsessions romanesques depuis l’enfance.
Autrice de 12 romans sous son nom et de 4 autres signés du pseudonyme Rebecca Ligheri, Emmanuelle Bayamack-Tam construit une œuvre exigeante et extravagante, qui transgresse les codes, et ne craint jamais de déranger le lecteur, voire de le transformer. L’un de ses derniers romans, “Arcadie” (POL), met en scène une adolescente de 14 ans, Farah, qui grandit dans une communauté libertaire au sein d’un lieu situé en zone blanche, nommé “Liberty house” et se lance dans une enquête très personnelle sur son identité sexuelle. On retrouve dans ce livre ce qui fait la singularité d’Emmanuelle Bayamack-Tam. Une audace subversive, un mélange d’érudition et d’humour familier et surtout une façon unique de questionner le corps, le genre, la monstruosité et la normalité.
Dans cet épisode, l’écrivaine revient sur ses “lectures omnivores”, ses premiers travaux d’écriture qui ne se réduisaient pas aux journaux intimes d’adolescente mais constituaient déjà de vraies fictions. Elle raconte sa rencontre avec le grand éditeur Jérôme Lindon, à 17 ans, dans des circonstances terriblement intimidantes. Nous ouvre les coulisses de sa création, en décrivant précisément ses systèmes de brouillon et son rapport, de plus en plus assumé à deux piliers essentiels de sa liberté d’écriture : d’une part le pseudonyme et d’autre part, l’emprunt.
En juin 2021, Emmanuelle Bayamack-Tam avait animé à l’école Les Mots une masterclass en tandem avec le jeune romancier Hugo Lindenberg sur le thème “faire vivre ses personnages”. Elle en a tiré une autre masterclasse sur le même thème que vous pouvez visionner en replay à tout moment. https://lesmots.co/atelier/masterclass-faire-vivre-ses-personnages-avec-emmanuelle-bayamack-tam
Extrait lu dans l’épisode
“Arcadie” d’Emmanuelle Bayamack-Tam (POL) Page 14
Crédits pour l’épisode 21
Création et réalisation : Lauren Malka. Montage : Noémie Sudre Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans l'épisode 20 d'Assez parlé, Agnès Martin-Lugand raconte le rythme de ses journées d’écriture entre le mois de septembre de chaque année et les vacances d’été. Elle se confie également sur la manière dont ses personnages s’installent progressivement dans son esprit, dans sa vie jusqu’à se déployer et exister presque réellement comme des membres de la famille à part entière !
Comment fait-elle ? C’est la question qui revient le plus souvent dans les articles de presse concernant Agnès Martin-Lugand. A-t-elle une recette d’écriture qui assure le succès ? Romancière préférée des Français depuis bientôt dix ans, Agnès Martin-Lugand n’a qu’une réponse à cette question : elle ne veut rien savoir aux mystères de la fiction. Elle écrit les yeux fermés, en ne sachant rien de ce que lui réservent ses personnages dont elle découvre toute l’histoire en l’écrivant.
Dans cet épisode, Agnès Martin-Lugand revient en détails sur l’écriture de “La Datcha” (Michel Lafon), son neuvième roman écrit pendant le confinement et paru en mars 2021. Écrivaine aussi imprévisible que disciplinée, elle raconte le rythme de ses journées d’écriture entre le mois de septembre de chaque année et les vacances d’été. Elle explique de quelle façon ses personnages s’installent progressivement dans son esprit, dans sa vie jusqu’à se déployer et exister presque réellement comme des membres de la famille à part entière dont elle discute avec son mari ! Ancienne psychologue clinicienne, elle nous raconte aussi la façon très singulière (et psychanalytique) dont elle fait advenir la parole de ses personnages, parfois en les questionnant, en les bousculant et parfois en cherchant simplement la musique qui leur correspond.
En avril 2021, Agnès Martin Lugand avait animé à l’école Les Mots une masterclass sur le thème “Ecrire en musique” avec la journaliste et écrivaine Adeline Fleury. Elle avait évoqué la place de la musique dans sa quête d’inspiration mais était aussi revenue sur sa propre expérience des ateliers d’écriture au moment de se lancer dans son premier manuscrit. Pour apprendre avec elle et d’autres écrivain.e.s à se lancer, à écouter et à faire advenir l’imprévisible fiction, écoutez les précieux conseils d’Agnès Martin-Lugand dans ce podcast et surveillez les masterclass de l’école Les Mots. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises !
Extrait lu dans l’épisode:
“La Datcha” d’Agnès Martin-Lugand (Michel Lafon) Page 33
Crédits pour l’épisode 20:
Création et réalisation : Lauren Malka.
Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand
Identité graphique : Nina Jovanovic.
Direction générale : Elise Nebout. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Pour la saison 2 d’Assez parlé, nous avons ouvert nos discussions sur l’écriture non plus seulement aux écrivain.e.s mais aussi aux éditeur.rice.s. Une façon de vous encourager encore et toujours à écrire et pourquoi pas à aller au bout de vos manuscrits en connaissant de mieux en mieux les personnes qui pourraient un jour vous dire “oui” !
Lola Nicolle est éditrice. En janvier 2021, elle a lancé, avec l’éditrice Sandrine Thévenet, une nouvelle collection de littérature française très attendue dans le milieu, Les Avrils, aux éditions Delcourt. Croisant récits littéraires et romans, cette collection s’est distinguée dès son lancement en publiant d’emblée deux premiers romans ("Les grandes occasions" d'Alexandra Matine et "Le premier homme du monde" de Raphaël Alix), un choix audacieux au milieu d’une rentrée pour le moins morose. En mai 2021, Les Avrils ont publié le premier roman d’Isabelle Boissard, “La fille que ma mère imaginait” qui a la particularité d’avoir été écrit en partie dans l’enceinte de l’école Les Mots ce qui nous a évidemment comblé de joie ! Désormais partenaires de l’école, Lola Nicolle et Sandrine Thevenet reçoivent régulièrement des manuscrits coups de cœur envoyés par notre comité de lecture à leur attention.
Dans cet épisode, Lola Nicolle raconte comment elle, qui n'aimait pas l'école et se sentait inadaptée dans le monde où elle vivait, est devenue éditrice. Elle se rappelle comment la littérature et le théâtre sont devenus ce qu'elle appelle des “safe space”, lieux de sécurité qui lui ont sauvé la vie. Elle revient, avec émotion, sur tous les moments de son parcours, les embûches scolaires, les révélations, les découvertes, les premières expériences professionnelles, les grandes rencontres... Ecrivaine et poète, Lola Nicolle se retrouve, à moins de trente ans et au tout début d'un parcours déjà étonnant, autrice d’un recueil de poésie ("Oiseaux de passage" aux éditions Blancs Volants), d’un roman ("Après la fête" aux Escales) - bientôt deux ! - et co-directrice d'une collection littéraire enthousiasmante.
En août 2021, les éditions Les Avrils se concentrent sur un premier roman “Les Garçons de la cité-jardin” signé Dan Nisand. Ce que cherchent les deux éditrices, Lola Nicolle et Sandrine Thevenet, aujourd’hui ? Trois ingrédients de départ : un style, une histoire, un propos. Mais surtout des surprises, des enthousiasmes et des écrivains "en travail". Alors vos carnets, à vos claviers, écrivez (pour le plaisir avant tout) et si vous êtes prêt.e.s, envoyez vos manuscrits à l’école Les Mots qui, entourée de ses éditeur.rice.s partenaires, fera tout son possible pour les faire fleurir.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Geneviève Brisac révèle les blessures de son enfance, la difficulté de “montrer” ce qu’elle écrivait. Elle rend hommage à toutes les écrivaines qui l’ont entourée, accompagnée - Virginia Woolf, Marina Tsvetaïeva, Flannery O'Connor - qui l’ont aidée à chercher une “phrase souple, drôle, mélancolique” dans laquelle elle se sentait elle-même.
Écrivaine, essayiste, autrice de plus de trente récits personnels (dont "Week-end de chasse à la mer"), essais féministes éclairants, livres pour enfants, Geneviève Brisac a aussi été critique littéraire au Monde pendant plus de vingt ans, autrice de fictions sonores à France Culture et éditrice chez Gallimard. Normalienne et agrégée de lettres, diplômée de philosophie, cette ancienne enseignante revient dans plusieurs livres son enfance, ses origines arméniennes, la difficulté de son rapport à sa mère (“Chagrin d’aimer”), ses combats et engagements en faveur des vulnérables (“J’attends de voir passer un pingouin”) et des femmes écrivaines à qui elle doit beaucoup (“Sisyphe est une femme”).
Dans cet épisode, l’écrivaine et éditrice à la carrière exceptionnelle révèle les blessures de son enfance, à l’époque où elle vivait dans l’ombre de sa mère écrivaine aussi et entourée de son “gang de soeurs”, la difficulté de “montrer” ce qu’elle écrivait. Elle rend hommage à toutes les écrivaines qui l’ont entourée, accompagnée - Virginia Woolf, Marina Tsvetaïeva, Flannery O'Connor - qui l’ont aidée à chercher une “phrase souple, drôle, mélancolique” dans laquelle elle se sentait elle-même. Elle raconte, avec une drôlerie épatante, les efforts et sacrifices qu’elle a dû faire pour attirer le seul regard qui comptait pour elle : celui de ses parents. Et la révolte intérieure qui lui a dicté un grand nombre de ses livres engagés . A la fin de l’épisode,elle nous lance un défi d’écriture qui promet de nous régaler (à tous les points de vue !).
En 2021, les éditions de l’Olivier rééditent une version poche de “Petite”, à l’occasion des trente ans de la maison d’édition. En 2019, Geneviève Brisac a publié “Sisyphe est une femme”, une version revue et augmentée du livre “La Marche du cavalier”, dans lequel elle cherchait à “remettre à l'honneur ces grandes écrivaines, nos aînées, celles à qui nous devons la force et le courage d'écrire ce que nous voyons”. A l’automne 2022, Geneviève Brisac publiera une lettre adressée à Virginia Woolf dans la collection “Les Affranchis” chez Robert Laffont.
Extrait lu dans l’épisode
“Sisyphe est une femme” de Geneviève Brisac (L’Olivier) Pages 10 à 12
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Découvrez Agnès Michaux se dévoiler par bribes, en commençant par révéler les détails - en apparence anecdotiques mais essentiels - qui composent son quotidien de romancière : ses grigris, ses rituels, ses superstitions.
Romancière et traductrice, Agnès Michaux a écrit ses premiers livres à 24 ans, en parallèle de ses débuts de de chroniqueuse sur France Inter et Canal +. Depuis, elle a publié près de 20 livres en 20 ans. Pourtant, elle n’estime être devenue écrivaine “de métier” que récemment. Comment sa pratique a-t-elle évolué depuis ce changement ? Quel rapport entretient-elle avec ses écrits passés et quel regard porte-t-elle sur aujourd’hui sur ce “métier” si solitaire et singulier ?
Dans cet épisode, Agnès Michaux se dévoile par bribes, en commençant par révéler les détails - en apparence anecdotiques mais essentiels - qui composent son quotidien de romancière : ses grigris, ses rituels, ses superstitions. Habitée par son roman en cours, elle nous invite progressivement à entrer dans son œuvre en ouvrant devant nous le grand album de famille des personnages qui la compose et qui renferme ses secrets de fabrication ! Après cette visite guidée, elle accepte de rembobiner la pellicule pour nous raconter son enfance solitaire, les premières lectures qui ont nourri son imaginaire et les poètes qu’elle a considérés comme des frères. A la fin de l’épisode, elle lance un défi d’écriture qui risque de vous faire regarder votre “chez vous” d’une toute autre manière.
En février 2021, Agnès Michaux a publié le tome 2 de sa série “La Fabrication des chiens 1899” (Belfond). Le tome 3, en cours d’écriture, qui racontera la suite des aventures de Louis Daumale et de son chien en 1909, paraîtra courant 2022.
* Précision : Nous présentons nos excuses pour les bruits de travaux en fond sonore en espérant qu’ils ne perturbent pas trop votre écoute !
Extrait lu dans l’épisode
“La fabrication des chiens - 1899”. Tome 2 pages 294-295
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Lionel Davoust raconte la première fois qu’il a été fasciné par le pouvoir magique de l’écriture. Il revient sur toutes les embûches et surtout, il partage avec nous quelques uns des outils, découverts au fil de ses recherches et rencontres, qui lui ont permis de renouer avec cette passion et d’en faire son métier.
Comment un biologiste marin, spécialiste des cétacés, devient-il écrivain à temps (archi-)plein ? Par quel virage à 180 degrés un jeune homme d’une vingtaine d’années décide-t-il d’abandonner une prometteuse carrière de chercheur scientifique pour se consacrer entièrement à l’invention de mondes futuristes dans le genre littéraire qu’on appelle “l’imaginaire” ? Lionel Davoust, auteur d’une trentaine de nouvelles, de près de dix livres de science fiction (dont trois sagas !) et lauréat du prix Imaginales en 2009 (avec “L’Île close”) n’est pas devenu écrivain du jour au lendemain. En bon biologiste, il a calculé sa trajectoire, étudié les plans, mesuré les risques avant de "plonger".
Dans cet épisode, il raconte la première fois qu’il a été fasciné par le pouvoir magique de l’écriture. Il revient sur toutes les embûches qui, adolescent, l’ont empêché de retrouver ce super-pouvoir auquel il avait goûté dans l’enfance. Et surtout, il partage avec nous quelques uns des outils, découverts au fil de ses recherches et rencontres, qui lui ont permis de renouer avec cette passion et d’en faire son métier. Grand lecteur d’essais théoriques signés par des écrivains, chercheurs, psychiatres américains, hongrois, canadiens... sur la productivité, le développement de la créativité et sur l’apprentissage technique de l’écriture, Lionel Davoust livre ici des conseils précis pour s’organiser, mener à terme ses projets mais aussi pour libérer la partie du cerveau qui doit se consacrer au “flow” de l’écriture.
Quelques références à noter :
“Flow” (En anglais : "Flow : The Psychology of Optimal Experience".dans lequel Mihaly Csikszentmihalyi, psychologue hongrois (dont nous écorchons le nom dans l’épisode !) décrit l’état psychologique de grand bonheur dans lequel on se trouve lorsque l’on plonge entièrement dans une activité (Editions Harper and Row, New York)
«S'organiser pour réussir” (“Getting things done”) sous titré “L’art de l’efficacité sans stress” de David Allen (théoricien américain de la productivité) qui délivre des conseils pour accomplir ses missions, s'acquitter de sa charge de travail sans se laisser déborder par elle (Leduc S. éditions)
“Ecriture. Mémoire d’un métier”, livre incontournable de Stephen King sur l’art d’écrire
Les mois qui viennent, Lionel Davoust publiera deux livres auxquels il tient beaucoup : le cinquième et dernier tome de sa série de fantasy épique intitulée “Les Dieux sauvages” (éditions Critic). Et un essai réunissant ses conseils d’écriture : “Comment écrire de la fiction ?”, à paraître aux éditions Argyll en mai 2021.
A la fin de l’épisode, Lionel Davoust vous lance un défi et vous propose un rendez-vous (à ne pas louper) !
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Marie Robert peut philosopher sur tout. Puisque pour elle, la philosophie “parle de nous”. Mais elle n’a que très rarement évoqué son rapport à l’écriture. Dans ce podcast, elle nous raconte comment l’envie d’écrire lui est apparue pour la première fois...
Marie Robert est philosophe, écrivaine et depuis très peu de temps romancière ! L’hiver 2020, elle a publié son tout premier roman sous le titre “Le voyage de Pénélope, une Odyssée de la pensée” chez Flammarion. Depuis bientôt six ans, elle partage chaque jour de courtes narrations philosophiques qui saisissent et réveillent ses très nombreux lecteurs et lectrices sur une page Instagram nommée “Philosophy is sexy”. Sacré titre !
Interrogée régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux à propos de sujets aussi passionnants que l’enfance, l’existence humaine, l’éducation, la sagesse, l’amour, la transmission… Marie Robert peut philosopher sur tout. Puisque pour elle, la philosophie “parle de nous”. Mais elle n’a que très rarement évoqué son rapport à l’écriture. Dans ce podcast, elle nous raconte comment l’envie d’écrire lui est apparue pour la première fois, en s’adressant à une petite souris imaginaire à qui elle prenait soin d’écrire chaque jour. Elle nous parle de sa passion pour l’enfance, ce lieu de toutes les découvertes et des premiers vertiges. Elle nous fait revivre son émerveillement pour la philosophie au moment des premières dissertations. Et oui, car Marie s’est prise de passion pour cet exercice ! Elle remplissait des dizaines de doubles pages après avoir discuté de ses sujets avec son grand frère. Plus tard, ce même grand frère, Guillaume Robert, deviendra son éditeur. Elle nous raconte de quelle façon ce nouveau lien s’est tissé et les doutes qu’elle a traversés avant de publier ses premiers livres. Surtout, elle nous dit à quel point il est important pour elle de passer de l’oralité à l’écrit, de l’échange d’idées, d’énergie et de rires à la concentration solitaire qui permet de ne pas “trahir sa pensée”.
A la fin de cet épisode, Marie Robert propose un exercice d’écriture philosophique. L’occasion de sentir à quel point, comme Marie le dit, “la philosophie vit en nous !”.
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Rencontre avec une éditrice pour encourager tous ceux qui écrivent ou le désirent !
Pour la saison 2 d’Assez parlé, nous avons décidé d’interroger non plus seulement des écrivaines et écrivains mais aussi éditeur.rice.s. Une façon de vous encourager encore et toujours à écrire et pourquoi pas à aller au bout de vos manuscrits en connaissant de mieux en mieux les personnes qui pourraient un jour vous dire “oui” !
Marie Eugène est éditrice. Elle a récemment pris la direction du domaine fiction française chez HarperCollins France — filiale créée en 2016 - notamment en créant la collection littéraire “Traversée”. Elle fait partie, depuis l’été 2020, des éditeur.rice.s partenaires de l’école Les Mots qui reçoivent régulièrement des manuscrits sélectionnés pour eux parmi ceux écrits par les aspirant.e.s écrivain.e.s de l’école.
Dans ce podcast, elle nous fait vivre, avec passion et émerveillement, toutes les étapes de son initiation au métier d’éditrice. Quelles émotions de lecture l’ont amenée à se passionner pour les livres, à former et à affiner son goût littéraire, d’abord comme lectrice, puis comme étudiante rêvant d’abord de travailler chez Vogue comme Carrie Bradshaw puis dans une maison d’édition ! Elle revient sur les rencontres et découvertes qui l’ont amenée à découvrir toutes les facettes de ce métier si méconnu : la lecture de manuscrits bien sûr, la recherche de nouveaux auteurs et d’autrices, l’accompagnement jour après jour de l’auteur dans son écriture, mais aussi la commercialisation, la communication... l’art de donner envie ! Elle raconte ce qu’elle a appris auprès du grand éditeur Jean-Marc Roberts, ancien directeur des éditions Stock dont le décès en 2013 a laissé de nombreux écrivains et éditeurs orphelins.
En janvier 2021, Marie Eugène publie le premier roman de Carine Hazan “jean-jacques” et le deuxième d’Aurélie Jeannin “Les Bordes”. Ce qu’elle cherche aujourd’hui ? Continuer de découvrir de jeunes auteur.rice.s comme elle s’est toujours efforcée de le faire. Et elle prévient d’ores et déjà qu’elle surveillera de près sa boîte aux lettres en guettant tout particulièrement les textes envoyés par le service manuscrit de l’école Les Mots. Donc à vos carnets, à vos claviers, écrivez !
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Passionnée d’Histoire, de psychanalyse et de transmission familiale, Olivia Elkaïm nous ouvre les secrets de création de ses romans !
Journaliste et romancière, Olivia Elkaïm est connue à l’école Les Mots pour remuer les émotions de tous les participants, âmes sensibles ou non ! Dans un atelier d’Olivia, d’après ce que disent toutes les personnes qui y ont participé, on pleure ! On passe du rire aux larmes, immanquablement.
Dans ce podcast, elle nous fait traverser les moments les plus intenses de sa vie d’écrivaine, ses joies et ses peines. Elle raconte ses premiers souvenirs de lecture et d’écriture, sa quête de silence au milieu d’une famille méditerranéenne bruyante, sa passion (et sa boulimie !) pour la littérature classique, la première fois qu’elle a envoyé un manuscrit à celui qui allait devenir, plus tard, son éditeur, la façon dont les sujets de ses romans se sont imposés à elle, sans qu'elle sache immédiatement pourquoi, la difficulté d’être femme, mère et écrivaine à la fois… une difficulté qui se révèle, en filigrane, le fil rouge de toute son œuvre.
Passionnée d’Histoire, de psychanalyse et de transmission familiale, Olivia Elkaïm nous fait entrer dans son univers peuplé de personnages historiques, profonds et joyeux et elle nous ouvre les secrets de création de son tout dernier roman, le plus personnel de tous, “Le tailleur de Relizane” (Stock, 2020) pour lequel l’école Les Mots a joué un rôle crucial !
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout.
Extrait lu dans l’épisode : “Le tailleur de Relizane” (Stock, 2020) (pages 31,32)Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Selon Martin Winckler, il faut concevoir l’écriture comme un jeu de construction, un “artisanat artistique”. Dans ce podcast, il nous raconte la façon dont il a découvert, vers l’âge de 18 ans, “ses” vocations : la médecine, l’engagement politique et l’écriture.
Médecin, romancier et essayiste militant, Martin Winckler se dit avant tout “artisan de l’écriture” et considère que rien ne peut se faire sans un travail minutieux, sincère et patient. Depuis son premier roman en 1989, “La vacation” jusqu’à ses plus récents en passant par “Le Choeur des femmes”, “Abraham et fils”, ses essais engagés sur la santé ou encore son best-seller “La maladie de Sachs”, (POL), tous ses livres sont régulièrement applaudis par la critique et le public dans le monde entier.
Depuis 2018, il anime à l’école Les Mots un atelier d’écriture sur le thème “Écrire : de l’expérience à la fiction”. A travers cet atelier mené à distance depuis Montréal, où il est installé, il accompagne, en ligne, des “artisans écrivants”, comme il les appelle, dans l’accouchement de leurs textes.
Dans ce podcast, il nous raconte son premier souvenir d’écriture à 10 ans, son rapport particulier aux journaux intimes et surtout la façon dont il a découvert, vers l’âge de 18 ans, “ses” vocations : la médecine, l’engagement politique et l’écriture. Non pas chacune leur tour, mais toutes en même temps en tirant de ses révoltes d’étudiant le sel de son inspiration. Influencé par la littérature américaine mais surtout par son maître français George Perec, Martin Winckler insiste dans ce podcast sur l’amusement dont il faut savoir faire preuve pour concevoir l’écriture comme un jeu de construction, un “artisanat artistique”.
En septembre 2020, il a publié deux livres simultanément : “C’est mon corps“ (L’Iconoclaste), qui dénonce la médecine actuelle, en particulier pour ce qui concerne la santé des femmes ; et “Atelier d’écriture” (POL), qui réunit ses réflexions et conseils sur la fabrique de “l’écrivant”. Il y évoque bien sûr, pour notre plus grand plaisir, son expérience à l’école Les Mots.
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout.
Extrait lu dans l’épisode
“Ateliers d’écriture. De l’expérience à la fiction” suivi de “Histoires en l’air Martin Winckler (POL, septembre 2020) (pages 120, 121)Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans cet épisode, Claudine Londre revient sur son enfance, sa passion précoce pour la poésie, raconte toutes les étapes, lectures, expériences et rencontres qui l’ont encouragée à oser l’impossible pour elle, à savoir écrire un roman.
Avec Claudine Londre, le Podcast “Assez parlé” continue de s’intéresser à celles et ceux, de plus en plus nombreux.se.s, que nous appelons les “Mots publiés” à savoir les participants d’ateliers de l’école Les Mots qui sont allés au bout d’un manuscrit et qui ont réussi le faire paraître.
Poète depuis l’enfance, mais aussi plasticienne, créatrice d’installations singulières, de sculptures en papier et en tissu souvent ornés de textes, Claudine Londre a toujours été convaincue qu’elle n’écrirait jamais de roman. Sa passion à elle, c’était la forme courte, le rapprochement de deux mots qui “produisent des étincelles”. Oui mais voilà, en France, la poésie n’est pas vraiment la bienvenue et fait rarement l’objet de publications. Claudine Londre, de son côté, n’est pas du genre à dire “jamais” ni à rester sur ses acquis. Elle a donc décidé de dépasser ses peurs, d’affronter ses limites et de s’inscrire à des ateliers d’écriture, notamment à l’école Les Mots et de participer à “La Rencontre”, système mis en place par l’école pour rencontrer des éditeurs. C’est ici, au 4 rue Dante, qu’elle a osé passer le pas et faire lire son premier manuscrit à l’une des romancières dont elle avait suivi les ateliers et qui l’inspirait le plus : Chloé Delaume, devenue quelques semaines plus tard son éditrice.
Dans cet épisode, elle raconte ce choc qu’a représenté pour elle la publication. Elle revient aussi sur son enfance, sa passion précoce pour la poésie, raconte toutes les étapes, lectures, expériences et rencontres qui l’ont encouragée à oser l’impossible pour elle, à savoir écrire un roman.
En mars 2020, Claudine Londre a publié “L’ombre de ma mère”, sous la tutelle de Chloé Delaume aux éditions du Seuil. A travers ce conte fantastique, drôle et poétique, qui raconte les déambulations d’une femme cherchant à se débarasser - à proprement parler - de l’ombre de sa mère défunte qui ne la quitte pas d’une semelle, Claudine Londre révèle son imaginaire et montre qu’une jeune poète peut aussi devenir romancière.
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout.
Extraits lus dans l’épisode
“L’ombre de ma mère” de Claudine Londre (Seuil, mars 2020) (pages 41-42)Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
A l’occasion de la parution de son nouveau livre, “La Naissance d’un père” chez Allary, Alexandre Lacroix, co-fondateur de l'école Les Mots revient sur l’importance centrale dans sa vie de son rapport à la paternité ainsi que son rapport quotidien à l’écriture depuis l’âge de 6 ans. Une histoire qui ressemble à une fable.
Comment Alexandre Lacroix, qui a co-fondé en 2017 l’école Les Mots, a-t-il pu, en seulement 20 ans, publier près de vingt romans et essais, quatre albums pour enfants, plusieurs centaines d’articles journalistiques et entretiens philosophiques, tout en dirigeant un journal (Philosophie Magazine) et en devenant, environ tous les quatre ans, père d’un nouvel enfant ? Nous lui avons enfin posé la question !
Dans cet épisode, enregistré à l’occasion de la parution de son nouveau roman, “La Naissance d’un père” (en août 2020 chez Allary), il revient sur l’importance centrale dans sa vie de son rapport à la paternité. Il se rappelle aussi de sa première expérience d’écriture qui lui apparaît aujourd’hui comme une foudroyante prémonition et nous raconte avec quelle détermination il a travaillé à devenir écrivain. D’une voix tranquille, déroulant une pensée limpide et inspirante, ce philosophe-essayiste-romancier aux nombreuses responsabilités nous explique comment s’organisent ses journées, son rapport quotidien à l’écriture depuis l’âge de 6 ans et nous apprend de bonnes nouvelles sur l’avenir de l’école Les Mots.
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout.
Extrait lu dans l’épisode
“La Naissance d’un père” d’Alexandre Lacroix (Allary éditions, 28 août 2020) (pages 57 à 61)Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Constance Joly-Girard nous montre que l’écriture peut s’installer dans notre vie, sans effort de discipline ni cérémonie et trouver une place qu’on n’a jamais cherché à lui assigner.
Avec Constance Joly-Girard, le Podcast “Assez parlé” ouvre une nouveau cycle d’épisodes consacrés à celles et ceux, de plus en plus nombreux.se.s, que nous appelons les “Mots publiés à savoir les participants d’ateliers qui sont allés au bout d’un manuscrit et qui ont réussi le faire paraître (ce qui, bien-sûr, est la plus belle récompense pour notre école !) ! Fidèle du 4 rue Dante, Constance a été particulièrement marquée par un atelier d’écriture, animé par l’écrivain Arnaud Delalande, dont elle parle dans ce podcast et pendant lequel elle a écrit les prémices de son premier roman. Paru peu de temps plus tard aux éditions Flammarion, sous le titre “Le matin est un tigre” (signé Constance Joly), ce livre a transformé une “éditrice-qui-n’écrira-jamais” en écrivaine-qui-ne-s’arrête-jamais.
Dans cet épisode, elle raconte le jour où une jolie première phrase lui est venue à l’esprit, à un moment où elle traversait une épreuve extrêmement difficile, et où, pour la première fois en 49 ans de vie, elle a ressenti le besoin de savoir ce qui se cachait derrière, notamment en poussant la porte de l'école Les Mots. Elle revient sur son enfance, cherche à comprendre ce qui, à l’époque, lui donnait tellement envie d’écrire tout en la freinant, à commencer par le regard mi-encourageant mi-intimidant de ses parents. Elle raconte tous les moments infimes et insaisissables qui ont jalonné la construction, lente, prudente et courageuse à la fois, de son tout premier récit et de sa vocation de romancière.
En janvier 2021, elle publiera un deuxième roman chez Flammarion sur l’histoire de son père qui a tardivement découvert son homosexualité et qui a fait partie des premières victimes du Sida. Sincère, émouvante et poétique, Constance Joly-Girard nous montre que l’écriture peut s’installer dans notre vie, sans effort de discipline ni cérémonie et trouver une place qu’on n’a jamais cherché à lui assigner.
Crédits
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic. Direction générale : Elise Nebout.
Extrait lu dans l’épisode
“Le matin est un tigre” de Constance Joly (pages 39-40)Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Julien Blanc-Gras raconte son goût pour la liberté dans la vie comme en écriture.
Julien Blanc-Gras - Depuis l’âge de 25 ans, l’écrivain-voyageur Julien Blanc-Gras traverse les latitudes pour raconter, dans des romans, des essais, des bandes-dessinées ou pour des reportages dans la presse, les vies qui peuplent notre planète. En juillet 2020, il animera son premier atelier d’écriture à l’école Les Mots sur le thème “Raconter le monde contemporain, avant tout une affaire de style”.
Avant cela, il a pris le temps, au lendemain du déconfinement et de la réouverture des parcs parisiens, de s’asseoir à l’ombre d’un arbre pour tout nous raconter. Dans ce podcast, il revient sur son enfance à Gap, la grande bibliothèque de ses parents coiffeurs amoureux des livres, son adolescence mais surtout, la première fois qu’il a goûté la liberté : ce premier grand départ à l’étranger qui a fait de lui un écrivain-voyageur. Il revient aussi sur l’aventure de la paternité, qui, comme le voyage et l’écriture, est devenu le secret de son optimisme. Avec une joie de vivre communicative, il nous offre une bouffée d’air frais !
Reporter (entre autres) pour la Revue Long Cours, le magazine de voyage Aller-retour et le magazine du Monde, romancier, documentariste, il est l’auteur d’une dizaine de romans ou récits, d’un essai, d’une bande dessinée et de nombreux reportages pour la presse. En mai 2020, il a signé son premier documentaire sur France 5 intitulé « Effondrement ? Sauve qui peut le monde », co-réalisé avec Alfred de Montesquiou. En juin 2020, son dernier roman “Comme à la guerre” sortira au Livre de Poche”.
Ses écrits alternent romans familiaux (In utero, Comme à la guerre) et récits de voyage nous menant en Amérique latine (Gringoland, Prix du Premier Roman de Chambéry), dans les îles du Pacifique (Paradis avant liquidation), au Groenland (Briser la glace, Prix Philéas Fogg) ou dans le monde entier comme dans Touriste ou Envoyé un peu spécial, son prochain récit qui paraîtra chez Stock en 2021.
Crédits
Création et réalisation : Lauren Malka. Musique : “Machine à écrire” Paroles : Louise Pressager / Musique Ferdinand Identité graphique : Nina Jovanovic Direction générale : Elise Nebout.
Extraits lus dans l’épisode
“Comme à la guerre” de Julien Blanc-Gras (pages 20-21)Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
























