Discover Les Femmes Sages
Les Femmes Sages
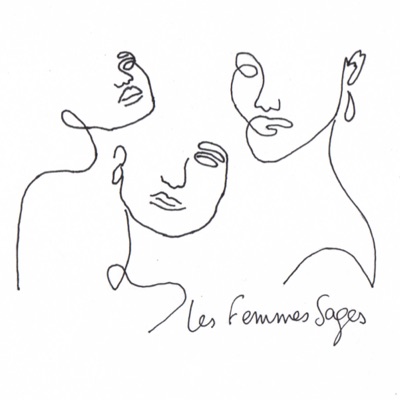
Les Femmes Sages
Author: Les Femmes Sages
Subscribed: 76Played: 978Subscribe
Share
© Geraldine Grenet
Description
Elles sont professionnelles de santé, chercheuses, militantes, patientes...toutes oeuvrent à leur façon en faveur d’une prise en charge globale de la santé des femmes. Ce podcast vise à leur donner la parole et mettre en lumière leurs expériences respectives.
Crédits
Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Noufissa Kabbou et Emmanuel Simula.
Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur Instagram (https://www.instagram.com/lesfemmessages/) et Facebook (https://www.facebook.com/lesfemmessages/?modal=admin_todo_tour). Un nouvel épisode chaque mois, en attendant prenez soin de vous!
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Crédits
Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet sur une musique originale de Noufissa Kabbou et Emmanuel Simula.
Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur Instagram (https://www.instagram.com/lesfemmessages/) et Facebook (https://www.facebook.com/lesfemmessages/?modal=admin_todo_tour). Un nouvel épisode chaque mois, en attendant prenez soin de vous!
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
45 Episodes
Reverse
Mettre le récit du patient au cœur de la relation entre soignant.e.s et soigné.e.s à travers la lecture attentive et l’écriture créative. Voilà ce que propose la médecine narrative. Développée aux États-Unis début des années 2000 par Rita Charon, médecin et passionnée de littérature, cette discipline trouve un écho en France depuis quelques années. Pour en parler, j’ai le plaisir d’accueillir Isabelle Galichon, docteure en littérature francophone, membre de l’Institut de médecine intégrative et complémentaire et cotitulaire de la chaire Médecine narrative du CHU de Bordeaux.Références /Charon R., Principes et pratique de médecine narrative, Sipayat, 2020Charon R., Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies, Sipayat, 2015Charon R., "Narrative Medicine: A Model for Empathy, Reflection, Profession and Trust", JAMA, 2001 Dossier de la revue Médecine et philosophie sur la médecine narrative en 2021 Galichon I., Micoulaud J.-A., "Vers une neurologie narrative", Pratiques neurologiques, 2022Bommier C., Tudrej B.V., Hervé C., « Narration médicale : un traitement prophylactique contre la souffrance du médecin ? », Ethics, Medicine and Public Health, 2019Goupy F., Le Jeunne C., La médecine narrative. Une révolution pédagogique ?, Med-Line Editions, 2018Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Le droit à l’IVG est à nouveau au cœur de l’actualité, avec son inscription historique dans la Constitution.Aujourd’hui, nous allons nous intéresser plus en détails aux actions de terrain du Planning Familial, en compagnie de Francesca Bonsignori, salariée au Planning familial de Strasbourg.Francesca nous parle des missions principales du Planning et des actions concrètes au niveau local, notamment en termes d'éducation à la sexualité et de prise en charge des violences sexuelles.Engagée au niveau national, elle revient aussi sur le programme "Handicap, et alors?" qui vise à promouvoir la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et à changer le regard social sur leur sexualité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Myriam Cayemittes est psychiatre à Strasbourg et présidente de l’association Paroles sans frontières qui soutient les personnes victimes de traumatismes, avec une approche interculturelle dans l’accueil de la parole de ces populations étrangères. Ensemble, nous avons parlé d’approche interculturelle en santé, de racisme en santé et de son impact sur la santé mentale.Références de l'invitée/Sur le concept d'intégration créatrice: Jean-Claude Métraux, La migration comme métaphore, La Dispute, 2011La santé autrement : ce que fait le racisme à la santé, Documentaire de Claire Richard, réalisé par Assia Khalid, La Série Documentaire, France Culture Discriminations : le no man’s land psychologique, par Rokhaja Diallo et Grace Ly, podcast Kiffe ta race, Binge Audio.Autres références/Priscilla Sauvegrain, « La santé maternelle des « Africaines » en Île-de-France : racisation des patientes et trajectoires de soins », Revue européenne des migrations internationales, 2012Isabelle Monfort, de l'ethnomédecine à l'invisible, podcast Radio Télévision SuisseHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Penser les droits reproductifs comme un tout. Voici ce à quoi nous invite Lisa Carayon, chercheuse en droit et maîtresse de conférence à l’Université Paris Sorbonne Nord, spécialiste en droit de la santé, de la famille et des migrations.
Dans cet épisode, nous revenons entre autres sur les avancées réalisées depuis la loi Veil et les obstacles qui perdurent aujourd’hui en matière d’accès à l’avortement en France.
/ Références /
Lisa Carayon, « Penser les droits reproductifs comme un tout : avortement, contraception et accouchement sous X en droit français », in Mon corps, mes droits ! L’avortement menacé ?, L. Brunet et A. Guyard-Nedelec, Mare Martin, 2019.
Réduction embryonnaire, réduction du droit des femmes
Tribune « Le Planning est là pour nous, soyons là pour lui ! »
Françoise Vergès, Le ventre des femmes, Albin Michel, 2017
Judith Jarvis Thomson, Pour une défense de l’avortement, Payot, 2023
Marie Mathieu, Laurine Thizy, Sociologie de l’avortement, La Découverte, 2023
Fatima Ouassak, La puissance des mères, La Découverte, 2020
Illustration @mathildeghekiere
Episode enregistré en mai 2023.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
On pourrait penser que la sexualité est un sujet de discussion légitime dans un cabinet de gynécologie. En effet, les gynécologues traitent la sphère intime des patientes et la plupart des diagnostics et interventions que les médecins gynécologues effectuent ont un impact direct ou indirect sur la sexualité des patientes.
Mais dans la réalité (et selon les études), les médecins gynécologues ne sont pas forcément à l’aise d’aborder le sujet de la sexualité en consultation, par manque de formation et de peur d’être intrusifs.ves. Les patientes, quant à elles, souhaiteraient en parler mais n’osent pas si elles
n’y sont pas invitées.
Pour ce nouvel épisode, j’accueille Leen Aerts. D’origine belge, Leen est gynécologue sexologue à Genève, spécialiste en pathologie de la vulve. Avec elle, nous parlons sexualité, sexualité après un cancer, sexualité et douleurs pelviennes chroniques, déroulé d’une consultation et suivi pluridisciplinaire.
Références /
Schweizer, A., L’abord de la sexualité en consultation gynécologique, Rev Med Suisse, 2017
Schweizer A. L’intégration de la sexualité en consultation gynécologique : discordances entre les perceptions des femmes et celles des gynécologues, Université de Lausanne, 2014.
GUYARD Laurence, « Sexualité féminine et consultation gynécologique : la part évincée du plaisir », Nouvelles Questions Féministes, 2010
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Béatrice Idiard-Chamois est sage-femme à l’Institut Mutualiste Montsouris depuis plus de 30 ans. En 2006, elle crée une consultation spécialisée parentalité handicap, qui sera suivie par une consultation gynécologie handicap en 2015. Dans cet épisode, elle nous parle du devenir mère avec un handicap, des spécificités et difficultés rencontrées dans le cadre de la grossesse et de
la parentalité et de la prise en charge gynécologique en milieu de vie ordinaire et en institution.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Il se caractérise par des troubles du cycle menstruel, une hyperpilosité et de l’acné. Le surpoids et l’infertilité font partie des complications.
A ce jour, il n’existe pas de traitement spécifique mais des recherches sont en cours pour mieux comprendre cette maladie qui touche une femme sur 10.
Pour en parler, j'accueille Clara Stephenson, patiente-experte et fondatrice du blog Les Natives et de l'entreprise Solence, deux initiatives qui visent à faire évoluer la prise en charge du SOPK.
/ Références
Les Natives
Association SOPK Europe
Vers une compréhension de l'origine du SOPK
SOPK_Inserm Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Femmes et hommes sont inégalement exposés aux violences familiales, conjugales, sexuelles tout au long de la vie, ce qui a des effets différenciés sur leur santé. C’est ce que révèle l’enquête VIRAGE - Violences et rapport de genre, réalisée en 2015 auprès de 15 000 femmes et 12 000 hommes de 20 à 69 ans résidant en France métropolitaine.
Claire Scodellaro est démographe, maîtresse de conférences à Paris I-Panthéon Sorbonne et directrice de l’Ecole des Hautes études en démographie. Elle a coordonné le chapitre violences et santé de l’enquête VIRAGE et nous en parle dans cet épisode.
Illustration @mathildeghekiere
Références/
Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et par les hommes, INED, 2020 Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
A partir des années 2000, les violences faites aux femmes, objet de lutte féministe, deviennent un problème de santé publique. Cette évolution va avoir notamment pour conséquence de responsabiliser les professionnel.le.s de santé dans la lutte contre les violences.
Une des raisons de cette évolution est la publication de l’ENVEFF, première enquête nationale sur les violences faites aux femmes. Membre de l’équipe ENVEFF, Marie-Jo Saurel traite alors des conséquences des violences sur la santé.
Dans cet épisode, elle revient sur la genèse de cette enquête tout en faisant le lien avec une enquête récente menée en Italie sur les violences conjugales envers les femmes pendant la pandémie Covid-19.
Marie-Jo Saurel est socio-épidémiologiste spécialisée en santé périnatale et chercheuse à l’INSERM (l’Institut national de la santé et de la recherche médicale) jusqu’en 2020.
Références de l'épisode/
- P. Romito, M. Pellegrini, L. Marchand-Martin, MJ Saurel-Cubizolles, L'impact des violences conjugales sur la santé psychologique des femmes, EMPAN, 2022
- Les violences envers les femmes en France: une enquête nationale, La Documentation française, 2003
Autres références/
- S. Haddad , L. Martin-Marchand , M. Lafaysse & MJ Saurel-Cubizolles, “Repeat induced abortion and adverse childhood experiences in Aquitaine, France: a cross-sectional survey”, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 2020
- M. N. A. Maciel, B. Blondel, MJ Saurel‐Cubizolles, “Physical Violence During Pregnancy in France: Frequency and Impact on the Health of Expectant Mothers and New‐Borns”, Maternal and Child Health Journal, 2019
- B. Lhomond, MJ Saurel-Cubizolles, “Orientation sexuelle et santé mentale : une revue de la littérature”, Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 2009
- B. Lhomond, MJ Saurel-Cubizolles, “Violence against women and suicide risk: The neglected impact of same-sex sexual behaviour”, Social Science & Medicine, 2006
- MJ Saurel-Cubizolles, B. Lhomond, “Les femmes qui ont des relations homosexuelles : leur biographie sexuelle, leur santé reproductive et leur expérience des violences”, Gynécologie Obstétrique & Fertilité, 2005
- Maryse Jaspard et al., “Reproduction ou résilience : les situations vécues dans l'enfance ont-elles une incidence sur les violences subies par les femmes à l'âge adulte ? ”, Revue française des affaires sociales, 2003
- C. Des Rivières-Pigeon, MJ Saurel-Cubizolles, P. Romito, “Psychological distress one year after childbirth. A cross-cultural comparison between France, Italy and Quebec”, European Journal of Public Health, 2003
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Lou Poll est sage-femme. Diplômé en 2013, la violence subie lors des études lui fait faire une croix sur son métier pendant 3 ans au cours desquels il construit sa pensée féministe et tente de repenser sa place de "soignant". Lou est une personne transgenre. Il a été assigné femme à la naissance, a vécu en tant que femme pendant 30 ans, puis a fait une transition de genre.
Dans cet épisode, il évoque son engagement, son parcours de transition, et en quoi ils éclairent sa pratique professionnelle, axée sur l'autonomisation et l'inclusivité en matière de santé sexuelle et reproductive.
Références utiles/
Korpo Real propose des planches anatomiques et des outils éducatifs et inclusifs dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive.
Chrysalide
Brochure Safer Sex pour les personnes Trans, Association Les Klamydia's
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans cet épisode, Aurore Koechlin, docteure en sociologie, nous parle de son ouvrage “La norme gynécologique, ce que la médecine fait au corps des femmes” (Ed. Amsterdam). Elle revient notamment sur l'histoire de la gynécologie médicale et interroge l'évidence d’un suivi spécifique, long et régulier, nécessaire pour les femmes, ainsi que les effets induits par un tel suivi. Elle propose également une lecture intersectionnelle de la relation gynécologique, présente les conditions d'apparition des violences avant d'aborder les espaces de résistance disponibles pour les patientes.
Références/
A. Koechlin, La norme gynécologique, ce que la médecine fait au corps des femmes, Ed. Amsterdam, 2022
A. Koechlin, L'auto-gynécologie: écoféminisme et intersectionnalité, Travail, genre et sociétés n°42 – Novembre 2019
Photo @Stéphane BurlotHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Sophie Bergeron est professeure au département de psychologie de l’université de Montréal, où elle est titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur les relations intimes et le bien-être sexuel. Une partie importante de ses travaux porte sur les douleurs pelviennes, le trouble de la pénétration et l’impact des traumas sur la sexualité. Les résultats de ses recherches ont mené au développement de nouvelles thérapies cognitivo-comportementales (TCC) de groupe et de couple.
Dans cet épisode, elle revient sur la définition de santé sexuelle et la terminologie des douleurs; l'étiologie et le traitement des douleurs avec un focus sur la vestibulodynie et la sexualité dans le couple; les bienfaits des TCC et le cas du traitement des douleurs associées à un trauma.
/POUR ALLER PLUS LOIN
TCC et vestobulodynie : Corsini-Munt, S. Bergeron, S., Rosen, N. O., Steben, M., Mayrand, M-H., Delisle, I., McDuff, P., Aerts, L. & SanterreBaillargeon, M., A comparison of cognitive-behavioral couple therapy and lidocaine in the treatment of provoked vestibulodynia: Study protocol for a randomized clinical trial, Trials, 2014
Douleurs et trauma: Charbonneau-Lefebvre, V., Vaillancourt-Morel, M-P., Rosen, N. O., Steben, M., & Bergeron, S. (2022). Attachment and childhood maltreatment as moderators of treatment outcome in a randomized clinical trial for provoked vestibulodynia. Journal of Sexual Medicine, 19(3), 479-495.
Sur le manuel cité qui détaille séance par séance le travail des thérapeutes avec les couples:
Cognitive-Behavioral Couple Therapy (CBCT), Treatment Manual for Provoked Vestibulodynia, S. Corsini-Munt, M.A, Nathalie O. Rosen, Ph.D. & Sophie Bergeron, Ph.D., 2013, revised 2021
Disponible sur demande (en anglais uniquement).
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Militante dans la sphère de la périnatalité depuis plus de vingt ans et co-présidente du CIANE (Collectif interassociatif autour de la naissance), Anne Evrard accompagne des
femmes et des couples en phase de recours suite à des violences obstétricales. Elle travaille les questions de formation des professionnels de périnatalité, de collaboration avec les soignant.e.s et d'information des femmes tout au long du parcours de grossesse et d'accouchement.
Dans cet épisode, elle revient sur la genèse des violences obstétricales et gynécologiques, les conséquences sur la santé et les recours disponibles.
Références :
CIANE
Stop VOG
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Les pathologies vulvaires sont à l'interface entre gynécologie et dermatologie. Il est difficile d’en estimer la prévalence exacte en raison du manque d’études sur la question et du fait que les intéressées s’expriment peu sur cette symptomatologie. Au cours de leur vie, face à des douleurs persistantes, les femmes s’entendent souvent dire que « ce n’est rien », « c’est dans la tête ». Pour en parler, Micheline Moyal-Barracco, dermatologue
et vénérologue, spécialiste des pathologies vulvaires.
Pour aller plus loin:
- Le petit guide illustré des pathologies vulvaires, Vulvae
- Les Clés de Vénus Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Leslie Fonquerne est docteure en sociologie, rattachée au laboratoire Certop de l’université de Toulouse Jean Jaurès et membre du Laboratoire Junior Contraception&Genre. Sa thèse, soutenue en 2021, interroge les prescriptions et les usages de la contraception orale dans un contexte marqué par la « crise de la pilule ». Dans son témoignage, elle revient sur les concepts de norme et de charge contraceptives, sur les violences médicales et gynécologiques ainsi que sur les inégalités d’accès à l’information et à la prescription contraceptives.
Publications de l'invitée:
- Fonquerne L., « ‘’C’est pas la pilule qui ouvre la porte du frigo !’’ Violences médicales et gynécologiques en consultations de contraception », Santé Publique, vol. 33, n° 5
- Fonquerne L., 2021, « Être (re)connue dans la pharmacie : délivrance d’une contraception ‘’en crise’’ en France et contournement de l’autorité (para)médicale », Enfances Familles Générations, n° 38, https://journals.openedition.org/efg/11765#authors
- Fonquerne L., 2020, « À qui faire avaler la pilule ? Pratiques de soin et inégalités en consultations de contraception », Émulations - Revue de sciences sociales, no 35‑36, p. 65‑79, https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/article/view/fonquerne
- Fonquerne L. et Zeller J., 5 mars 2018, « Mémoires et actualités de la contraception et de l’avortement en France », Mondes Sociaux, https://sms.hypotheses.org/11128
- Le Guen M., Roux A., Rouzaud-Cornabas M., Fonquerne L., Thomé C. et Ventola C. pour Le Laboratoire Junior Contraception&Genre, 2017, « Cinquante ans de contraception légale en France : diffusion, médicalisation, féminisation », Population & Sociétés, vol. 549, n°10, p. 1-4, https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/cinquante-ans-de-contraception-legale-en-france/
Autres références de l'invitée citées dans le podcast:
- Ventola C., 2017, Prescrire, proscrire, laisser choisir : Autonomie et droits des usagers des systèmes de santé en France et en Angleterre au prisme des contraceptions masculines, Thèse de doctorat en sociologie, Paris Saclay, Paris, 604 p, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01795009/document
- Ventola C., 2014, « Prescrire un contraceptif : le rôle de l’institution médicale dans la construction de catégories sexuées », Genre, sexualité et société, 1 décembre 2014, no 12, p. 2‑16., https://journals.openedition.org/gss/3215
- Sur la "norme contraceptive" : Bajos Nathalie et Ferrand Michèle, 2004, « La contraception, levier réel ou symbolique de la domination masculine », Sciences sociales et santé, 2004, vol. 22, no 3, p. 117‑142., https://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_2004_num_22_3_1630
- Sur la "crise de la pilule" : Bajos Nathalie, Rouzaud-Cornabas Mylène, Panjo Henri, Bohet Aline, Moreau Caroline, et l’équipe Fécond, 2014, « La crise de la pilule en France : vers un nouveau modèle contraceptif ? », Population & Sociétés, 2014, vol. 511, no 5, p. 1‑4., https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/crise-pilule-france-nouveau-modele-contraceptif/
- La notion de "crise de la pilule" est issue de cette thèse (non accessible en ligne) : Rouzaud-Cornabas Mylène, 2019, « Alerte à la pilule ». Politiques contraceptives et régulation du risque au prisme du genre, Thèse de doctorat en Santé publique, option sociologie, Paris Saclay, Paris.
- Sur le "travail contraceptif" : Thomé Cécile et Rouzaud-Cornabas Mylène, 2017, « Comment ne pas faire d’enfants ? La contraception, un travail féminin invisibilisé », Recherches sociologiques et anthropologiques, 2017, no 2, p. 45‑64., https://journals.openedition.org/rsa/2083
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Marie-Rose Galès est patiente-experte, c’est-à-dire qu’elle est touchée par l’endométriose
et s’engage auprès de chercheurs.ses et d’associations pour informer et sensibiliser autour de cette maladie. Dans cet épisode, elle revient sur les fondamentaux de l’endométriose, tout en abordant l'impact sur la santé mentale et les recherches en cours.
Références:
* Marie-Rose Galès, EndométriOSE poser tes questions : Tout ce qu'il faut savoir sur l'endométriose, Véga, 2021
* Marie-Rose Galès, Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre, Josette Lyon, 2020
*Marie-Rose Galès, Endo & Sexo : Avoir une sexualité épanouie avec une endométriose, Josette Lyon, 2019
* Podcast Endométriose Mon Amour Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
En 2013, une enquête nationale auprès d’étudiant.e.s en médecine rendait compte des violences subies durant leurs études. D’autres enquêtes ont été publiées depuis, notamment celle d’Amélie Jouault qui, en 2020, réalisait sa thèse sur les violences subies par les étudiant.es en médecine générale*. Les résultats viennent confirmer les chiffres de manière alarmante: 98% d’étudiants en médecine ont subi des violences pendant leurs études.
Amélie partage sa propre expérience, nous parle du sexisme structurel et de la violence omniprésente, des effets délétères sur la santé et des pistes de prévention. Elle présente aussi les actions de l'association Pour une M.E.U.F (Pour une médecine engagée et féministe) dont elle est membre.
* La thèse est le résultat d’une étude nationale quantitative réalisée avec sa collègue Sara Eudeline. 2200 réponses sur 3000 questionnaires envoyés.
Références de l'épisode
- A. Jouault, Violences subies par les étudiant.es en médecine générale, thèse de médecine générale, 2020
- Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple, Recommandation de bonne pratique, HAS, 2019 (mise à jour 2020)
- Rapport sur la qualité de vie des étudiants en santé, Dr Donata Marra, 2018
- V. Auslender, Omerta à l’hôpital, le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé, Michalon, 2017
- La santé des étudiants et jeunes médecins, Conseil National de l’Ordre des Médecins, 2016 Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Méconnaissances, mythes et tabous sur le sexe, le genre et la sexualité sont légion, que ce soit chez les professionnel.e.s de l'éducation scolaire et universitaire, les professionnel.le.s de santé ou le grand public.
Céline Brockmann est biologiste et co-fondatrice du Bioscope, le laboratoire public de l'Université de Genève dans le domaine des sciences de la vie et biomédicales. Elle revient sur les étapes du développement sexuel, les notions de sexe et de genre, les cours enseignés en faculté de médecine sur la diversité sexuelle et de genre ainsi que les différents outils développés dans le cadre du programme éducatif et scientifique Sciences, sexes, identités, qui vise la promotion de la santé sexuelle et l’égalité des genres.
Références :
- Projet Sciences, sexes, identités: www.unige.ch/ssi
- Biologie et Sexualités - E-learning pour enseignant-es de Biologie: www.unige.ch/ssi/pedagogie/biologie-et-sexualites/
- Sexesss, brochure éditée par le Bioscope de l’Université de Genève en collaboration avec RTS Découverte
- Mon sexe & moi, mon corps sous la loupe, brochure éditée par le Bioscope de l’Université de Genève en collaboration avec RTS Découverte et SANTE SEXUELLE SUISSE
- Hey you, une brochure d'éducation sexuelle sur l'amour, la sexualité, la contraception et plus encore, SANTE SEXUELLE SUISSE
- Site collaboratif SVT Egalité : www.svt-egalite.fr
- Anne Fausto-Sterling, Corps en tous genres, la dualité des sexes à l’épreuve de la science, La Découverte, 2012
- Thierry Hoquet, Des sexes innombrables, le genre à l’épreuve de la biologie, Le Seuil, 2016Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Les mutilations génitales féminines (MGF) touchent près de 200 millions de femmes et de filles à travers le monde. Elles seraient 500 000 à en avoir subi au sein de l’Union européenne. Pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles entre l'enfance et l'âge de 15 ans, les MGF sont une forme de violence basée sur le genre qui ont de lourdes conséquences sur la santé physique, psychologique et sexuelle des femmes.
Avec Jasmine Abdulcadir, gynécologue obstétricienne qui coordonne une consultation spécialisée et pluridisciplinaire sur les MGF aux Hôpitaux Universitaires de Genève, nous discutons de ce que recouvrent les MGF, les conséquences sur la santé, la question de la sexualité et de la reconstruction, ou encore la formation des professionnel.le.s de santé.
Crédit photo @ David WagnièresHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Le sexe comme le genre ne sont pas des concepts sans histoire. Dans cet épisode, nous revenons sur l’historicité de cette relation, la construction des corps et des organes féminins, les déterminaux sociaux de santé. Nous abordons enfin l’histoire de la santé des corps masculins qui demeure un terrain à explorer.
Francesca Arena est historienne, spécialiste de la santé et du genre. Ses terrains de recherche portent notamment sur l’histoire de la médecine et du genre, l’histoire de la santé mentale, la question de l’intersectionnalité en santé et plus récemment l’histoire de la santé des corps masculins. Elle participe à l’enseignement de l’histoire de la médecine
et du genre à la faculté de médecine de l’Université de Genève. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
























