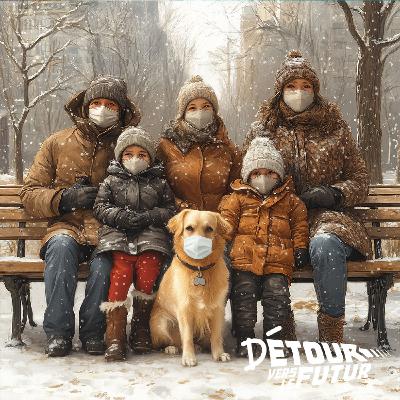Discover Détour vers le futur
Détour vers le futur

Détour vers le futur
Author: Quai des Savoirs
Subscribed: 37Played: 365Subscribe
Share
© Quai des Savoirs - Toulouse Métropole
Description
Détour vers le futur, le podcast sciences du Quai des Savoirs à Toulouse qui explore les recherches d’aujourd’hui pour imaginer le futur proche. Chaque mois, en lien parfois avec l'exposition présentée, nous rencontrons des scientifiques et des spécialistes qui partagent leurs découvertes et leurs enjeux : intelligence artificielle, environnement, climat… Deux temps forts rythment l’émission : un clin d’œil au passé grâce aux archives sonores de l’INA, et une escapade dans un futur possible à travers un récit de science-fiction. Un voyage sonore entre science et prospective… pour mieux comprendre les recherches d’aujourd’hui et enrichir sa culture scientifique.
Détour vers le futur, le podcast science du Quai des Savoirs à Toulouse. Une émission proposée par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, en partenariat avec l’INA.
Production Quai des Savoirs | 2023-2025 | https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
41 Episodes
Reverse
Du BPA dans les biberons dans les années 2000, des parabènes et des phtalates dans les cosmétiques dans les années 2010, des PFAS (pifasses) dans les poêles plus récemment... L’actualité ces dernières décennies a été maillée d’alertes à la présence de substances aux noms énigmatiques mais qui ont un dénominateur commun, celui d’être des perturbateurs endocriniens. De quoi est-il réellement question ? Où se trouvent ces substances et quels sont les risques pour la santé ou pour l’environnement ? Existe-t-il de réelles alternatives ? Avec : Nicolas Cabaton Chargé de recherche INRAE dans l’unité Toxalim, centre de recherche en toxicologie alimentaire à Toulouse, ses recherches visent à étudier le devenir et les effets des contaminants alimentaires et environnementaux perturbateurs endocriniens à travers des études in vivo et in vitro. Expert en toxicologie, il participe à deux groupes de travail au sein de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) depuis 2015, et à la Commission Européenne depuis 2021. Jessika Moreau Maître de conférences des universités et praticienne hospitalière spécialisée en médecine de la reproduction, elle est titulaire d’un double parcours hospitalo-universitaire. Elle exerce conjointement son activité entre la prise en charge clinique des couples présentant des troubles de la fertilité au sein du service de médecine de la reproduction du CHU de Toulouse, et des missions d’enseignement et de recherche. Sur le plan universitaire, elle enseigne au sein de la Faculté de Santé de Toulouse, où elle participe à la formation des étudiants en médecine ainsi qu’à celle des filières paramédicales. Son activité de recherche est menée au sein de l’équipe EXPER de l’UMR 1331 Toxalim de l’INRAE. Ses travaux portent sur l’amélioration des pratiques dans les laboratoires d’assistance médicale à la procréation (AMP), ainsi que sur l’impact des toxiques environnementaux sur la fertilité. Extrait sonore INA : Les emballages dangereux - extrait de l'émission "À la bonne heure"diffusée sur TF1 le 08/06/1975Capsule sonore : "Le nutriTox" : Texte Li-Cam | Voix Corinne Mariotto | Sound design et réalisation Christophe RuetschUn podcast du Quai des Savoirs en partenariat avec l'INA et en collaboration avec le centre INRAE Occitanie - Toulouse, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Les années 50 ont vu l’arrivée et la démocratisation d’un matériau incontournable aujourd’hui : le plastique ! Fabrication simple, possibilités presque infinies, on lui a vite associé des mots comme "Révolution", "Libération", signe d’un véritable tournant dans notre quotidien. Quelques décennies plus tard, le plastique est omniprésent, avec désormais de véritables continents de déchets, des impacts sur l’environnement mais aussi sur la santé humaine. Au-delà de son aspect bien visible, où se cache-t-il dans certains produits et dans l’environnement ? Comment évolue-t-il et pourrons-nous un jour nous en débarrasser ? Avec : Fabienne Lagarde Maître de Conférences en chimie de l’environnement, Fabienne Lagarde s’est spécialisée sur l’utilisation des spectroscopies vibrationnelles pour la détection et la quantification de polluants dans l’eau. Depuis 10 ans, à l’Institut des Molécules et des Matériaux du Mans, ses activités de recherche portent essentiellement sur la quantification de microplastiques dans différentes matrices environnementales (eaux, sédiments et biote) et sur le devenir ultime des plastiques dans l’environnement. Elle travaille également avec l’industrie pour la mise en place d’une économie plus circulaire des plastiques et siège depuis 2022 au conseil d’administration du centre technique de l’institut de la plasturgie et des composites (IPC). Elle a participé à la création du premier groupement de recherche (GDR) français "Polymères & Océans" financé par le CNRS et en a été la directrice adjointe de 2019 à 2024. Depuis 2023, elle est membre de l’International Scientific Coalition, groupe international de scientifiques soutenant un traité contraignant pour mettre fin à la pollution plastique d’ici 2040 et fait partie de la délégation française en tant qu’experte scientifique. Muriel Mercier BonninDirectrice de recherche INRAE et directrice adjointe de l’unité de Toxicologie alimentaire (Toxalim) à Toulouse, Muriel Mercier-Bonin a débuté ses activités de recherche au Toulouse Biotechnology Institute à l’INSA, en étudiant les mécanismes d’interaction entre les micro-organismes et les surfaces. Elle a ensuite rejoint l’unité MICALIS à Jouy-en-Josas pour étudier le rôle structurel et fonctionnel du mucus, un acteur clé de l’homéostasie intestinale. Depuis plusieurs années, elle anime au sein de l’équipe Neuro-Gastroentérologie et Nutrition de Toxalim une thématique de recherche sur les interrelations entre les contaminants alimentaires, le microbiote, le mucus et l’hôte dans le tractus digestif, en conditions physiologiques et physiopathologiques. Depuis 2018, elle s’intéresse à l’impact des micro et nano-plastiques sur la santé humaine, avec un focus sur l’écosystème intestinal. Extrait sonore INA : Le 7ème continent de plastique - extrait du JT de 20h sur France 2 diffusé le 11/06/2013Capsule sonore "Le coût environnemental" : Texte Li-Cam | Voix Corinne Mariotto | Sound design et réalisation Christophe RuetschUn podcast du Quai des Savoirs en partenariat avec l'INA et en collaboration avec le centre INRAE Occitanie - Toulouse, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Grippe, gastro, rougeole, variole, COVID... des épidémies il y en a eu, il y en a et il y en aura encore... Mais qu’est-ce qui fait qu’une maladie, parfois sous des airs de simple maladie de l’hiver, devient une épidémie mondiale ? Peut-on les prévenir ? Et avons-nous une idée du portrait-robot de la potentielle prochaine épidémie mondiale ? Avec :Mircea SofoneaIl est maître de conférences habilitées de l'Université de Montpellier depuis 2018, où il enseigne notamment l'analyse spatiale, les biostatistiques, l'épidémiologie et la modélisation dans des cursus de biologie et de santé. Formé aux stratégies anti-infectieuses, il est aussi épidémiologiste au CHU de Nîmes. Il est par ailleurs professeur invité au Conservatoire national des arts et métiers et à l'École normale supérieure (Paris). Au sein de l'unité de recherche INSERM PCCEI, il co-anime un pôle visant à améliorer la surveillance et le contrôle des pathogènes, en particulier des virus respiratoires, par la modélisation mathématique, statistique et computationnelle. Attaché au dialogue entre santé et sciences formelles pour préparer la société aux crises sanitaires, il a rejoint le groupe d'expertise Air & COVID de l'ANSES et est régulièrement sollicité par les pouvoirs publics et les médias sur les questions épidémiologiques. Depuis 2022, il est co-directeur en charge de la recherche de l'Institut de l'exposome de l'Université de Montpellier (ExposUM), en charge de l'accélération de projets interdisciplinaires en santé environnementale. Depuis 2025, il est coordinateur du programme national de recherche "Préparation pandémique au virus respiratoire X", financé par l'ANRS MIE et France 2030. Guillaume Martin-BlondelIl est praticien hospitalier dans le service des maladies infectieuses du CHU de Toulouse, Professeur de maladies infectieuses à l'Université de Toulouse et membre de l'Institut Toulousain des Maladies Infectieuses et Inflammatoires (Infinity). Il est le médecin référent pour la gestion du risque épidémique et biologique pour le CHU de Toulouse, établissement sanitaire de référence régional pour l'Occitanie, et pour l'ARS Occitanie. Il coordonne l'axe de recherche Neo-I3D du CHU de Toulouse dont la thématique porte sur les maladies infectieuses et inflammatoires émergentes. Extrait sonore INA : Interview en plateau de Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Bichat, Paris - extrait du Journal télévisé du 20h sur France 2 diffusé le 28/02/2020 Capsule sonore "La distanciation sociale de niveau 3" : Texte Li-Cam | Voix Corinne Mariotto | Sound design et réalisation Christophe RuetschUn podcast du Quai des Savoirs en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
IA par ici, IA par-là, il ne se passe pas une journée sans qu’un média, un collègue de travail, ou une relation amicale nous parle d’intelligence artificielle. Pour trouver des recettes de cuisine, savoir quoi visiter dans tel pays, résumer une vidéo qu’on n’a pas envie de regarder en entier, ou encore nous aider à rédiger une lettre de motivation, on accommode l’IA à toutes les sauces ! Comme si on ne savait plus rien faire par nous-mêmes ! Comme si on avait perdu toute créativité. C’est justement le sujet de cet épisode de Détour vers le futur. Avec : Thomas PeyruseDe formation ingénieur à l'école Centrale de Nantes, Thomas Peyruse commence sa carrière comme consultant en robotique et automatique à Toulouse sur des systèmes complexes passionnants comme les satellites géostationnaires et plus longuement sur le pilotage manuel de l'A350-XWB. Deux ans après avoir quitté l'école, il s'essaie au théâtre comme amateur au Grenier Théâtre puis au TNT. En 2015, il expérimente robotique et scène et fait partie de la régie robotique humanoïde et drone pour les créations "School of Moon", "Lesson of Moon" et "Phoenix" de la compagnie Shonen qui tournent dans toute l'Europe. Il co-fonde en 2017 la compagnie Caliban Midi pour travailler sur une Machine Vivante qui sera exposée au salon Experimenta 2018.Il travaille les robots comme des marionnettes, des personnages de dessin animé, des instruments qui prennent vie. Il a ainsi animé pendant 7 ans un atelier de court-métrage avec des robots au département d’art plastique de l’Université de Jean Jaurès de Toulouse. À partir de 2022, il intègre déjà l’usage de l’IA générative dans la plupart de ses projets artistiques et professionnels et co-écrit en 2025 avec Luc Truntzler le livre "l’IA pour la créativité" aux éditions First sur la base de ses expériences. Luc TrunzlerTrès présent dans l’écosystème IA en France via notamment le Hub France IA où il participe aux groupes de réflexion sur l’IA générative, l’IA auprès des ressources humaines et l’IA frugale, Luc Trunzler a notamment contribué en tant qu’expert sur 2 normes AFNOR dans le cadre de la stratégie nationale sur l’IA. Il a été nommé par le ministère de l’économie en 2025 Ambassadeur IA dans le cadre du mouvement national Osez l’IA. Il a fait toute sa carrière dans les Intelligences Artificielles Conversationnelles et plus récemment en tant que directeur associé chez Spoon.ai. Conférencier et formateur, il s'applique à donner les outils aux entreprises mais aussi aux étudiants et enseignants pour mieux développer leur esprit critique sur ces nouvelles technologies. Aujourd’hui, il s’intéresse particulièrement à la manière dont l’IA générative peut ouvrir de nouvelles voies pour libérer la créativité, éveiller les idées et transformer notre façon de penser, de créer et de collaborer. Extraits sonores INA : Musique électronique - Ponchelet François, extrait du Journal de Paris / ORTF diffusé le 17 février 1965Capsule sonore : Texte Li-Cam | Voix Corinne Mariotto | Sound design et réalisation Christophe RuetschUn podcast du Quai des Savoirs en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans cet épisode, nous allons parler musique ! Si vous l’avez déjà visitée, vous savez dans que l’exposition “Comme des moutons ?” que nous présentons au Quai des Savoirs jusqu’au 2 novembre prochain, il y a un karaoké. Un karaoké pour démontrer que nous chantons plus juste quand nous chantons ensemble. C’est quelque chose que les chefs de cœur connaissent bien : par imitation avec les autres, nous avons chacun tendance à nous synchroniser en rythme et en harmonie. Nous vous proposons de découvrir tout l’inverse, et de rencontrer un musicien et un chercheur qui expérimentent la désynchronisation... Avec :Sylvain Darrifourcq Percussionniste, multi-instrumentiste, improvisateur et compositeur, Sylvain Darrifourcq fait son apprentissage en tant que percussionniste classique. Il a collaboré avec de nombreuses personnalités françaises européennes et américaines telles Joëlle Léandre, Joachim Kühn, Tony Malaby, Michel Portal, Louis Sclavis, Marc Ducret, Andrea Parkins, Akosh S, Kit Downes... Passionné par les questions de temporalité, d’espace et de rupture en musique, il crée aujourd’hui un langage très personnel, construit autour des notions de « poly-vitesse », de « physiqualité » et de mécanisation du geste sonore. Ses recherches l’amènent à se questionner sur la dimension plastique de ses productions. En 2019, en compagnie de Nicolas Canot, il donne naissance à l’éco-système FIXIN - ensemble de projets allant de l’installation sonore à la performance - mettant en scène des moteurs commandés numériquement dans une scénographie lumineuse minimaliste et immersive. Curieux des conséquences psycho-acoustiques de ses travaux, c’est vers la science qu’il se tourne désormais, en créant des projets hybrides avec les chercheurs en cognition de la musique, Clément Canonne (IRCAM, CNRS) et Thomas Wolff (European Central University). En 2023, il crée HECTOR Editions dans le but d’éditer des ouvrages à caractère sociologique sur les mondes de la musique et de la culture, et publie le livre 20 000 MOTS qu'il co-écrit avec Antoine Le Bousse. Clément Cannone Après des études de piano au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon et un doctorat en musicologie, Clément Canonne est recruté comme chercheur par le Centre National de la Recherche Scientifique et rattaché à l’Ircam (Paris). À l’Ircam, il dirige l’équipe « Analyse des pratiques musicales » et mène des recherches scientifiques et artistiques sur l’improvisation collective, l’appréciation esthétique, l’attention auditive et l’humour musical. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues internationales à comité de lecture et a publié deux CDs sur le label Urborigène Records (Improvisation in the Lab, 2021 ; Florent Schmitt : Scènes de la Vie Moyenne, 2025). Extraits sonores INA :Déphasage circulaire - Karl Naegelen, Sylvain Darrifourcq, Toma GoubanExtrait YouTube essai Romain N’Tamack finale Top 14 2023 Capsule sonore : Texte Li-Cam | Voix Corinne Mariotto | Sound design et réalisation Christophe RuetschUn podcast du Quai des Savoirs en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Océans et mers recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l’eau sur Terre. Ils connectent les humains, fournissent nourriture et oxygène et contribuent à réguler le climat en absorbant plus du quart du CO2 produit. Si depuis toujours ils sont exploités, considérés comme inépuisables et presque invulnérables, leur étude scientifique est relativement récente et nous sommes aujourd’hui bien loin d’avoir percé les nombreux mystères de leur fonctionnement. Comment explore-t-on ces écosystèmes extrêmes qu’ils soient polaires ou à plusieurs milliers de mètres de profondeur ? Qu’étudie-t-on pour tenter de comprendre leur fonctionnement ? Sait-on aujourd’hui comment sont distribués, comment circulent les éléments indispensables à la vie dans ces masses d’eau planétaires ? Que nous apprennent les sciences des océans ?Avec : Catherine JeandelDirectrice de recherche émérite au CNRS, océanographe géochimiste, travaille au Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales (LEGOS), où elle étudie la géochimie marine pour comprendre les mécanismes qui déterminent le fonctionnement de l’océan, en particulier les interactions continents-océans. Elle a effectué plus d’une quinzaine de campagnes en mer, et coordonne un projet mondial d’exploration géochimique des mers intitulé GEOTRACES (www.geotraces.org). Auteure ou co-auteure de plus de 150 articles de rang A, elle a écrit, avec Matthieu Roy-Barman, un livre consacré à la géochimie marine et co-édité avec Rémy Mosseri et CNRS-Édition : Le Climat à découvert, L’énergie à découvert puis L’eau à Découvert. Hélène PlanquetteHélène Planquette est chercheuse en biogéochimie marine, spécialiste du cycle des métaux traces dans l’océan. Directrice de recherche au CNRS au LEMAR (Laboratoire des sciences de l’environnement marin) à Brest, elle conduit des travaux à l’interface entre géochimie, océanographie et microbiologie, avec un fort ancrage dans les grandes campagnes internationales comme GEOTRACES. Elle est également très impliquée dans les dynamiques collectives de la science ouverte, des bases de données FAIR et de la recherche collaborative à l’échelle internationale, en lien avec des enjeux comme le climat, la gouvernance de la haute mer ou la neutralité carbone. Extrait sonore INA : La mer aux trésors, extrait de l'émission Visa pour l'avenir, diffusée le 23/08/1963Capsule sonore : Texte Li-Cam | Voix Corinne Mariotto | Sound design et réalisation Christophe RuetschUn podcast du Quai des Savoirs , en coproduction avec le CNRS et en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulCes recherches et ce podcast ont été financés en tout ou partie, par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Il sera une fois les futurs – sous ce titre énigmatique, nous vous proposons une petite immersion dans l’envers du décor de ce podcast. Parce que si parler de l’histoire des sciences ou de l’actualité de la recherche est nécessaire mais maîtrisé, proposer de se projeter dans le futur est une autre affaire. C’est un exercice de pensée complexe auquel nous ne sommes pas habitués et il est souvent plus simple pour nos cerveaux, de se laisser porter par les imaginaires sombres des scénaristes d’Hollywood. Mais dans Détour vers le futur, nous avons choisi une alternative... celle de parler de prospective et de travailler en direct avec une autrice de science-fiction pour créer nos chroniques du futur. Avec :Li-CamLi-Cam partage sa vision du monde singulière à travers des personnages hors normes à la psychologie complexe. Ses écrits nous interrogent sur notre relation à l’altérité, mais également sur l’importance de notre culture dans notre vision du monde. Ces dix dernières années, les questions écologiques ont pris une part importante dans son travail. Lemashtu – Chroniques des Stryges, le premier volet d’une trilogie de fantasy urbaine, est paru en janvier 2009. Asulon, véritable conte philosophique 3.0, aborde les craintes que suscite l’intelligence artificielle, mais également la problématique des libertés individuelles et du contrôle de l’information à l’ère des réseaux mondiaux. Asulon a obtenu le prix Bob Morane 2016. En 2019, Li-Cam aborde de nouveau l’Intelligence Artificielle dans Résolution, une novella humaniste et scientifique interrogeant la notion d’effondrement, parue à La Volte dans la collection Eutopia. En 2023, Visite, un roman choral imaginant une société « L’écoume » organisée autour de la préservation du Vivant et écrit dans une langue « écologique », est également paru à La Volte. Ce roman a été nommé pour le prix SGDL Yves et Ada Rémy des Littérature de l’Imaginaire. À ce jour, elle est l’auteure de sept romans et d’une cinquantaine de nouvelles, explorant tous les genres des littératures de l’imaginaire. En parallèle, Li-Cam anime des ateliers d’écriture et crée ou participe à des évènements sur l’axe Art Science, notamment autour de l’Intelligence Artificielle et l’Écologie. Nicolas HervéNicolas Hervé est professeur en didactique des transitions écologiques à l’École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole. Il est directeur adjoint de l’UMR EFTS (Éducation – Formation – Travail – Savoirs) de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Il est spécialiste de l’utilisation de la prospective en contexte éducatif et est l’auteur du livre Penser le futur. Un enjeu d’éducation pour faire face à l’Anthropocène, édité en 2022 aux éditions Le Bord de l’Eau.Capsule sonore : Texte Li-Cam | Voix Corinne Mariotto | Sound design et réalisation Christophe Ruetsch Un podcast du Quai des Savoirs présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de sonHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Voilà l’été, ses fêtes et ses festivals ! Détour vers le futur s’intéresse aujourd’hui aux foules festives, sous le regard des sciences...Les beaux jours approchent et nous sommes nombreuses et nombreux à attendre avec impatience de pogotter, de growler ou de chanter à l’unisson avec nos artistes préférés sur les scènes des festivals. Mais que recherchons nous en participant à ces rassemblements qui dépassent parfois l’entendement ? Et comment les villes font-elles pour littéralement vivre au rythme de ces manifestations festives ?Avec : Corentin CharbonnierDocteur en anthropologie et ATER à l'université de Tours. Ses recherches portent sur l'industrie musicale, notamment sur les "metal studies". Il a publié divers articles dans des revues telles que Urbanités et Hypothèses. Il est le commissaire de l'exposition Metal qui s’est tenue à la Philharmonie de Paris (2024) et il est en charge des statistiques officielles du Hellfest et de Motocultor.Philippe SteinerProfesseur émérite de sociologie à Sorbonne université. Ses recherches portent sur la fête et le matching. Il a récemment publié : Faire la fête. Sociologie de la joie, Presses universitaires de France (2023) et La société du matching, en collaboration avec M. Simioni, Presses de Sciences-Po (2024).Extrait sonore INA : Festival Hellfest : Devant la scène - 19/20 édition Pays de la Loire France 3 Régions - 22/06/2016Capsule sonore : Texte Li-Cam | Sound design et réalisation : Christophe Ruetsch | Voix : Corinne MariottoUn podcast du Quai des Savoirs présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Altruisme, démocratie, apprentissage ou encore communication, il ne sera pourtant pas question des humains aujourd’hui mais des insectes sociaux. Ces petites bêtes sont en effet capables de comportements collectifs incroyables et chaque jour, les scientifiques mettent en évidence des capacités toujours plus stupéfiantes. Ont-elles aussi une forme d’intelligence individuelle ? Détour vers le futur s'intéresse aujourd'hui aux abeilles et aux fourmis.Avec :Audrey Dussutour Directrice de Recherche au CNRS, elle se consacre à l'étude du comportement des animaux et particulièrement des fourmis et des blobs. Elle a été une des premières à démontrer qu'un organisme dépourvu de système nerveux peut apprendre et mémoriser. Elle est l'auteur de plus de 70 articles scientifiques et de quatre livres grand public : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Blob, sans jamais oser le demander en 2017 (Equateurs, Prix Science pour Tous), L'odyssée des fourmis en 2022 (Grasset), Moi, Le blob en 2022 (humenSciences, Prix Le goût des Science 2023, Prix La Science se Livre 2024) et les Champignons de l'Apocalypse en 2025 (Grasset). Elle dirige une collection d'ouvrages scientifiques chez Tana consacrée à l'étude du comportement animal intitulée Chroniques Sauvages et est éditrice associée de plusieurs revues scientifiques. Elle a obtenu plusieurs prix pour ses travaux scientifiques sur les fourmis et les blobs dont le prix Le Monde de la recherche en 2007, le prix Wetrems de l'Académie des Sciences de Belgique en 2011 et le prix Fermat de l'Académie du Languedoc en 2022. En 2023, elle est élue membre associée de l'Académie Royale des Sciences de Belgique. Elle a coordonné deux projets de sciences participatives d'envergure : Elevetonblob, proposé par le CNES en partenariat avec le CNRS, qui a réuni plus de 5000 établissements scolaires et 350 000 élèves pour étudier l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob à bord de l'ISS, et Derrière le blob, la recherche proposé par le CNRS, qui comptait 15 000 volontaires étudiant les effets du réchauffement climatique sur la survie et la croissance du blob. Ses nombreuses activités de médiation auprès du grand public ont été récompensées par l'ordre national du mérite et la première médaille de médiation du CNRS en 2021.Mathieu LihoreauEthologue au CNRS, Mathieu Lihoreau est un expert de l’intelligence animale, en particulier de celle des insectes. Après avoir percé à jour la personnalité des blattes, le sens de l’orientation des bourdons ou encore le vote des mouches, il dirige actuellement une équipe de recherche à Toulouse avec laquelle il scrute les mouvements des abeilles grâce à des radars et à des plantes robotiques.Passionné par la vulgarisation scientifique, il est l’auteur de À quoi pensent les abeilles ? (humenSciences, 2022) et La planète des insectes (Tana, 2025)Extrait sonore INA : Journal Les Actualités Françaises - 01/07/1959Capsule sonore : Texte Li-Cam | Sound design et réalisation : Christophe Ruetsch | Voix : Corinne MariottoUn podcast du Quai des Savoirs présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Pour nourrir la planète et sa population, il faut produire et il faut produire beaucoup. On le constate, les productions se sont largement orientées vers les systèmes intensifs et leur lot d’impacts sur la santé, sur les écosystèmes, ou encore sur les productions elles-mêmes. Diverses alternatives sont pratiquées, expérimentées, testées pour produire autrement. On entend de plus en plus parler de transition agro-écologique. Mais de quoi est-il question ? Quelles évolutions recherche-t-on ? Pour quelles conséquences sur nous, humains et consommateurs et sur les écosystèmes ?Avec :Tiphaine Chevalier Des études en agronomie et une thèse en Science du Sol (Montpellier SupAgro), l'ont conduit à étudier la dynamique des matières organiques des sols, le cycle du carbone dans les sols, les effets des changements d’usage des sols et des changements climatiques sur ce cycle. Directrice de recherche à l’IRD, l’institut de recherche pour le développement, Typhaine Chevalier travaille avec de nombreux chercheurs internationaux, en particulier africains à travers le réseau CaSA pour Carbone des Sols pour une agriculture durable en Afrique en utilisant à la fois la variabilité naturelle des propriétés des sols dans l’espace et dans le temps et des manipulations expérimentales afin d’estimer la vulnérabilité des agro-écosystèmes aux changements globaux. Elle enregistre également, régulièrement, des chroniques sur les merveilles invisibles du sol sur Euradio !Mathieu HanemianChercheur INRAE au Laboratoire des interactions plantes-microbes-environnement (LIPME – INRAE/CNRS) du centre INRAE Occitanie-Toulouse depuis octobre 2019, ses travaux visent à mieux comprendre les interactions entre plantes. Ces interactions, qui sont peu connues, jouent pourtant un rôle majeur dans le fonctionnement des communautés végétales. Dans les systèmes agricoles également, la compétition entre les espèces cultivées et les plantes adventices est bien connue pour réduire les rendements, en particulier en absence de traitement herbicide. Par ses recherches, il espère qu’une meilleure compréhension des interactions entre plantes pourrait à terme être utilisée dans la transition agroécologique, par exemple pour composer des mélanges de cultures performants et viables pour les professionnels. Dans ses travaux actuels (projet CoCultures), il met en œuvre une démarche de sciences citoyennes pour co-construire de nouvelles associations de cultures de légumes en collaboration avec des jardiniers et des maraîchers de la région toulousaine, pour les expérimenter ensuite de manière participative. Grâce à la quantité et la diversité des personnes impliquées, ces expérimentations permettent de générer des données robustes, de créer des associations de cultures pertinentes et d’établir des ponts entre sciences et société.Extrait sonore INA : 19 20 Édition Côte d'Azur - France 3 Régions - 02/05/2014Un podcast du Quai des Savoirs en partenariat avec l'INA et en collaboration avec le centre INRAE Occitanie - Toulouse et l'IRD, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Ce podcast explore les avancées et les défis de la recherche sur les implants cérébraux, notamment pour traiter les maladies neurologiques et neurodégénératives. Des experts discutent des électrodes implantables pour la détection et le traitement, en particulier pour la maladie de Parkinson et l'épilepsie. L'émission aborde les aspects techniques, tels que les nouveaux matériaux pour des électrodes plus durables et flexibles, ainsi que les enjeux liés à la biocompatibilité et à la réponse inflammatoire. Elle examine également les perspectives offertes par des approches moins invasives comme les ultrasons focalisés, tout en considérant les attentes des patients et les limites des annonces futuristes comme celles d'Elon Musk.Avec :Ali MazizChargé de recherche CNRS en neuro-ingénierie au Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS). Ses travaux de recherche se concentrent sur le développement d'implants cérébraux souples et biocompatibles afin de mieux comprendre et traiter des troubles neurologiques tels que l'épilepsie et la maladie de Parkinson. Après un doctorat en ingénierie des matériaux à Paris et un post-doctorat en bioélectronique en Suède, il rejoint le LAAS en 2018. Là, ses recherches se portent principalement sur le développement d'interfaces neurales novatrices permettant la détection et la modulation précise des signaux neuronaux. En parallèle, il explore les mécanismes électrochimiques sous-jacents à l'activité cérébrale pathologique, visant à améliorer le diagnostic et les traitements de ces affections.Marion Simonetta-MoreauNeurologue au CHU Purpan de Toulouse, Marion Simonetta-Moreau est Professeur associée de Neurophysiologie à L’Université Paul Sabatier de Toulouse (UPS) et chercheure INSERM dans l’unité ToNIC1214. Son activité clinique est centrée sur les pathologies de la motricité (Tremblements, Dystonies, Parkinson et maladies apparentées, maladies neurologiques rares), au sein de l’équipe « Mouvements Anormaux » du service de Neurologie du CHU. Elle est référente régionale et nationale pour le Tremblement Essentiel et les dystonies. Elle coordonne la prise en charge des traitements par injections de toxine botulique dans les indications neurologiques. Elle assure le monitoring peropératoire de la chirurgie par stimulation cérébrale profonde du Parkinson, des Tremblements et des dystonies depuis 25 ans. Elle enseigne la neurophysiologie à la Faculté Santé de l’UPS.Ses thématiques de recherche sont centrées sur la motricité, la plasticité du cerveau, la neuromodulation et l'utilisation d’outils tels que la stimulation magnétique transcrânienne dans la physiopathologie des troubles du mouvement.Extraits sonores INA :Elon Musk veut développer un implant cérébral connecté 20 heures - Collection : A2 / France 2 - 05/09/2020Capsule sonore : Texte : Li-Cam | Sound design et réalisation : Christophe Ruetsch | Voix : Corinne MariottoUn podcast du Quai des Savoirs, en coproduction avec le CNRS et en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulCes recherches et ce podcast ont été financés, en tout ou partie, par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR). Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Comment se forment les foules ? Et comment les mouvements collectifs agissent et parfois même transforment le cours des choses ?Cette saison, le Quai des Savoirs présente l’exposition Comme des moutons ? qui met à l’honneur les foules ! Foules qu’on retrouve notamment à la Révolution française, lors des printemps arabes, ou encore en mai 68… Notre histoire est jalonnée de ces bouleversements qui transforment plus ou moins nos sociétés. Mais comment ces révolutions naissent-elles ? Quels sont les déclencheurs ?Avec : Mehdi MoussaïdChercheur en sciences cognitives au Max Planck Institute à Berlin, il est l’auteur du livre Fouloscopie et anime la chaîne YouTube du même nom. Ingénieur en informatique, docteur en éthologie, il a travaillé préalablement dans un laboratoire de physique avant de rejoindre le centre de recherche sur la rationalité adaptative. Ce parcours pluridisciplinaire lui permet d’intégrer les différentes dimensions de la recherche autour des foules. Il est le commissaire scientifique de l’exposition Comme des moutons présentée au Quai des Savoirs.Sophie Wahnich Directrice de recherche en histoire et science politique au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).Spécialiste de la Révolution française, formée à l'analyse du discours et à la théorie politique, Sophie Wahnich s'intéresse aux bouleversements historiques et à leurs conséquences sur le tissu politique, social et affectif des sociétés. Son travail d'universitaire et d'intellectuelle publique aborde les questions contemporaines auxquelles sont confrontées les démocraties occidentales (terreur, nationalisme, mondialisation, réfugiés, guerre, traumatisme, religion, mémoire collective, etc.) en s'appuyant sur les acquis historiques et les idéaux universels de la Révolution française. Dans ses publications, ses expositions et ses interventions publiques, Sophie Wahnich mesure avec un regard critique les défis et les ambitions des idéaux de la Révolution française dans les luttes politiques, sociales économiques et environnementales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui.Sophie Wahnich a écrit et coédité de nombreux livres, dont certains ont été traduits : In Defense of Terror, Liberty or Death in the French Revolution (2012), La Liberté ou la mort, essai sur la terreur et le terrorisme (2003), La longue patience du peuple, 1792, naissance de la République (2008), Les émotions de la Révolution Française et le présent (2009), La Révolution des sentiments, comment faire une cité 1789-1794, Paris (Seuil, 2024).Extraits sonores INA : Egypte : la génération "Facebook" dans le mouvement d'opposition, A2 / France 2, 06/02/20211Capsule sonore : Texte : Li-Cam I Sound design et réalisation : Christophe Ruetsch I Voix : Corinne MariottoUn podcast du Quai des Savoirs en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Y a-t-il un pilote dans le brouillard ? Qu’est-ce que les sciences nous apprennent sur ce phénomène météorologique ? On tente d’y voir plus clair aujourd’hui dans Détour vers le futur. Brouillard épais, brume du matin, brouillard givrant… Pour certains mystérieux, pour d’autres inquiétant, le brouillard est dans tous les cas très impactant et notamment dans le secteur du transport aérien.Peut-on prévoir ce phénomène qui semble parfois si local ? Et à défaut de pouvoir le dissiper, quelles adaptations humaines ou techniques pour permettre décollages et atterrissages en sécurité ?Avec :Léa SzpicC’est un un vol dans un cockpit d’Air France qui donne à Léa Szpic l'envie de devenir pilote. Elle commence par piloter des planeurs, obtient son brevet et découvre la liberté du vol sur ces machines, puis intègre l’ENAC pour sa formation de pilote de ligne.Elle termine sa formation en 2018 et fait de l’instruction et du vol de montagne dans les "Alpes sur Mousquetaire”, de l’aviation d’affaires dans la région de Genève sur Citation Jet. Elle est pilote chez Air France depuis 3 ans, qualifiée sur Airbus A320 et opère sur le réseau court et moyen courrier. Marc JolimaitrePilote de planeur dès 16 ans, Marc Jolimaitre a rejoint les cockpits d'Air France après avoir suivi le cursus de formation de l'ENAC à Toulouse. En 25 ans, il a totalisé plus de 15000 heures de vol et exerce aujourd'hui sur Airbus A320 en tant que Commandant de Bord et Instructeur.Frédéric BurnetFrédéric Burnet est ingénieur et chercheur à Météo France. Il dirige depuis 2013 l’équipe dédiée à l’étude des propriétés physico-chimiques des aérosols et des nuages, dans le groupe de météorologie expérimentale et instrumentale du CNRM.Ses recherches portent sur l’étude expérimentale de la microphysique des nuages et il a participé à de nombreuses campagnes de mesure pour étudier les processus pilotant les propriétés des gouttelettes de nuage.Il contribue depuis une dizaine d’années aux travaux de recherche menés pour améliorer l’observation et la prévision du brouillard, et a récemment coordonné le projet ANR SOFOG3D visant à mieux comprendre les mécanismes mis en jeu pour mieux prévoir son cycle de vie.Extraits sonores INA :Épais brouillard sur Londres et annulations de vols, journal 12-13, FR3, 21/12/2006Los Angeles, passagers coincés par un brouillard tenace, journal du matin A2, 24/12/1985Capsule sonore : Texte : Li-Cam I Sound design et réalisation : Christophe Ruetsch I Voix : Corinne MariottoUn podcast du Quai des Savoirs, en coproduction avec le CNRS et en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent Codoul Ces recherches et ce podcast ont été financés, en tout ou partie, par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Est-ce que la gagne se transmet des parents aux enfants ? Est-ce que c’est héréditaire ? On apprend de nos expériences passées, c’est un fait, mais certaines sont plus “marquantes” que d’autres et seront transmises aux générations suivantes. Au-delà des traumatismes ou des dangers, existe t’il des expériences qui nous impactent davantage que d’autres ? Conditionnement, transmission, épigénétique, génétique, évolution on fait le point aujourd’hui sur cette vaste question qu’est l’hérédité. C’est la question qu’on se pose aujourd’hui dans Détour vers le futur.Avec :Séverine TrannoyAprès un Master et un doctorat en Neurosciences de l'Université de Jussieu, Paris 6 Séverine Trannoy a réalisé sa thèse dans le laboratoire de Thomas Préat, à l'ESPCI, Paris, où elle a étudié les circuits moléculaires et neuronaux impliqués dans la mémoire olfactive en utilisant les Drosophiles comme modèle animal. Elle a ensuite effectué un postdoctorat à Harvard Medical School, à Boston, dans le laboratoire d'Edward A. Kravitz, et étudié les bases neuronales du comportement agressif inné et appris chez les drosophiles. Elle y a concentré ses recherches sur l’étude des conséquences comportementales des interactions agressives et sur la façon dont celles-ci peuvent être intégrées dans le cerveau. En octobre 2018, elle est nommée chargée de recherche au CNRS au Centre de Recherche en Cognition Animale à Toulouse, France, où ses questions scientifiques s’articulent autour du fonctionnement du cerveau et son implication dans la régulation des comportements sociaux, incluant l’agressivité et la parade nuptiale.Etienne DanchinAncien élève de l'ENS Ulm, agrégé de biologie, directeur de recherche émérite au CNRS, Étienne Danchin est spécialiste de l’évolution du comportement, de l’évolution culturelle et de l'hérédité non génétique. Il a commencé sa carrière au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, au centre de bagage des oiseaux, puis a rejoint le laboratoire d’écologie de l’ENS Ulm, puis a dirigé le laboratoire "Évolution & Diversité Biologique" (EDB) à Toulouse. Il a été le co-fondateur et co-directeur du LabEx TULIP regroupant 700 participants de sept laboratoires en Occitanie. TULIP en fait proposait de mettre concrètement en œuvre la Synthèse inclusive de l’évolution en Occitanie.Un podcast du Quai des Savoirs, en coproduction avec le CNRS et en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulCapsule sonore : Texte : Li-Cam I Sound design et réalisation : François Donato I Voix : Corinne MariottoCes recherches et ce podcast ont été financés en tout ou partie, par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Ce mois-ci nous vous proposons une plongée au-delà du visible, décryptage des mystères de la physique quantique dans Détour vers le futur. C’est la physique qui se cache, à une échelle infiniment petite, derrière toutes les technologies de l’information et de la communication que nous utilisons au quotidien. Nous allons parler aujourd’hui de nanotechnologies et de physique quantique, et tenter d’y voir clair, au-delà du visible…Avec : Julien Bobroff est physicien et professeur à l'Université Paris-Saclay. Après 20 ans de recherches en physique quantique, il anime maintenant une équipe de recherche, La Physique Autrement, autour des questions de vulgarisation et d'enseignement de la physique.Gonzague Agez est physicien et universitaire français. Diplômé d’un doctorat en physique des lasers de l’Université de Lille, il effectue ses études post-doctorales à l’Université du Chili à Santiago, puis à Nice, avant d’être nommé Maître de conférences à l’Université de Toulouse 3 en 2007. Il y enseigne essentiellement la physique expérimentale au département de Mesures Physiques de l’IUT. Ses recherches au laboratoire CEMES-CNRS concernent les propriétés optiques des cristaux liquides, la physique des lasers et la nano-photonique.Un podcast du Quai des Savoirs, en coproduction avec le CNRS et en partenariat avec l'INA, présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau | Réalisation : Arnaud Maisonneuve | Prise de son : Laurent CodoulCapsule sonore : Rencontre I Texte : Li-Cam I Sound design et réalisation : François Donato I Voix : Corinne MariottoCes recherches et ce podcast ont été financés en tout ou partie, par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Est-ce que l’IA est en train de révolutionner le monde de la création artistique ? L’IA est-elle un outil comme les autres ou bien peut-elle aller jusqu’à prendre la place des créateurs humains ? Et quid des droits d’auteur ? Nous ouvrons le dossier dans ce podcast à l’occasion de la 10ème édition de notre festival artistique et scientifique Lumières sur le Quai, qui a pour thème cette année la question “Créer avec l’IA ?”Avec :Clément Libes : Diplômé du conservatoire classique de Toulouse et de Bruxelles, Clément Libes commence sa carrière en 2013 avec le projet de rock alternatif Kid wise. Fasciné par l’univers du studio, il commence à travailler pour d'autres artistes comme Christophe, Gaëtan Roussel, Josman, Tim Dup, Kyan Khojandi ou Bigflo et Oli dont il rejoint l’équipe live en tant que musicien et directeur musical. En parallèle il développe son projet “Bruit” avec lequel il parcourt l’Europe lors d’une tournée de 60 concerts. C’est par ce biais qu’il est alors contacté en 2023 par M83 pour devenir directeur musical et musicien pour la tournée mondiale “Fantasy Tour”. En 2024 Clément continue la collaboration en studio avec M83 et sur scène avec Bigflo et Oli et prépare le 2nd album de Bruit. https://bruitofficial.bandcamp.com/Sylvain Sarrailh : Après une scolarité à dessiner sur cahiers, tables et murs, Sylvain Sarrailh travaille dans l'architecture, la BD et le concept art. Il monte le studio de création Umeshu Lovers avec son associé pour réaliser des jeux vidéo aux ambitions artistiques à la hauteur de leurs inspirations communes. La nature, les toits d'immeubles et le ciel bleu sont leur signature pour des projets toujours plus poétiques et optimistes. https://umeshulovers.com/Justine Emard : Artiste, Justine Emard explore les nouvelles relations qui s’instaurent entre nos existences et la technologie. En associant différentes technologies de l’image, elle situe son travail dans un flux alliant la robotique, les neurosciences, la vie organique et l’intelligence artificielle. Son travail a été exposé lors de biennales internationales, dans des musées en France et à l’étranger. En 2023-2024, elle est artiste-professeure invitée au Fresnoy, studio national des arts contemporains. Ses œuvres font partie de collections nationales et internationales. En 2023, elle est lauréate de la distinction « 100 femmes de culture » en France. Justine Emard est directrice artistique de l’exposition permanente du Pavillon de la France pour la prochaine exposition universelle à Osaka en 2025. https://justineemard.com/Une émission présentée par Marina Léonard et Laurent Chicoineau Réalisation : Arnaud Maisonneuve - Prise de son, mixage : Thomas GouazéEn partenariat avec l'INA.Production Quai des Savoirs - Toulouse Métropole 2024Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Jusqu’où peut-on s’adapter au changement climatique ? Est-ce que nous inspirer du vivant serait une bonne idée ? Phénomènes extrêmes, hausses de températures et du niveau des océans, modification des régimes de précipitations, les conséquences du changement climatique sont nombreuses et impactantes pour la biodiversité, nous humains, inclus. Est-il possible de s’adapter à ces changements et jusqu’à quel point ? Avec :Régis Céréghino est Professeur à l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier (UT3), et Directeur du Centre de Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement, unité mixte de recherche de l’UT3, du CNRS, de Toulouse INP, et de l’IRD. Ses recherches portent sur l’impact des changements environnementaux locaux à globaux sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, en tirant parti d’un écosystème naturel miniature considéré comme un modèle pour tester des théories en écologie : les broméliacées à réservoir d’eau, des plantes Néotropicales qui retiennent un volume d’eau de pluie entre leurs feuilles, et les organismes aquatiques qui s’y développent. Ses travaux permettent de comprendre comment différentes échelles d’organisation biologique, organismes, réseaux trophiques, méta-communautés, et leurs interactions, permettent la résilience des écosystèmes aquatiques néotropicaux, suite à des épisodes de sécheresse allant de la norme actuelle à des événements extrêmes et prévisions du GIEC. Il est auteur de plus de 180 publications dans des revues scientifiques internationales, ouvrages, et revues grand public.Anne Gaillard est paysagiste conceptrice et urbaniste, diplômée de l’ENSP-Versailles et de Sciences Po Paris. Elle a conçu et piloté de nombreux projets d’aménagement urbain, parcs, jardins, espaces publics, en France et à l’international (Europe, USA), assuré des missions de conseil auprès des collectivités territoriales, et enseigné dans les écoles de paysage et d’architecture (France, UK). Spécialiste de la gestion intégrée des territoires, elle porte au sein de Ceebios, le développement de l’urbanisme régénératif, elle explore également la bioinspiration territoriale depuis 2018, à travers le projet de recherche-action-transmission Territory Lab, dont elle assure le copilotage. Elle s’intéresse aux processus de changement, de la stratégie urbaine et territoriale (prospective) à la programmation, la conception jusqu’aux solutions fondées sur la nature. Elle est par ailleurs, impliquée dans la formation « Habitat bio inspiré » de Ceebios, ainsi que dans les formations en prospective territoriale et biomimétisme, en partenariat avec l’Institut des Futurs Souhaitables (IFs). Elle est aussi Paysagiste Conseil de l’État.Ces recherches et ce podcast ont été financés en tout ou partie, par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
2024 a été marquée par l’explosion de l’intelligence artificielle dans tous les domaines. C'est ce phénomène que nous avons exploré dans presque tous les épisodes de ce podcast Détour vers le futur . Cette année, nous présentons au Quai des Savoirs l'exposition IA : Double Je, l'occasion de discussions passionnantes avec de nombreux scientifiques de disciplines différentes. Pour terminer cette saison, nous vous proposons dans ce best-of quelques morceaux choisis qu’il ne fallait pas manquer ! Vous allez pouvoir retrouver : Farah Benamara, chercheuse à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT)Bertrand Monthubert, mathématicien et président de EKITIA, une association professionnelle spécialisée dans la gestion éthique des données personnellesMarie-Eve Rougé-Bugat, médecin généraliste et professeure à l'Université Paul Sabatier de ToulouseYann Ferguson, sociologue, directeur scientifique de LaborIA (INRIA)Jessica Pidoux, chercheuse en humanités numériques à l'Université de Lausanne, et directrice de l'association Personal Data IODominique Boullier, sociologue du numérique et chercheur à Sciences Po ParisCatherine Tessier, membre du Comité national pilote d'éthique du numérique Détour vers le futur, un podcast présenté par Marina Léonard et Laurent Chicoineau. Merci à Eloïse Bonnin pour la préparation de ce best-of. Réalisation : Arnaud Maisonneuve. Prise de son : Thomas Gouazé. Production : Quai des Savoirs 2024.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
On dit de nos données personnelles qu’elles sont le carburant de l’économie numérique, et encore plus à l’heure de l’IA. Décryptage des enjeux dans ce numéro de Détour vers le futur !Que ce soit par nos interactions sur les réseaux sociaux, nos recherches sur Internet, ou même l’utilisation du GPS sur nos smartphones, nous laissons tous les jours, souvent sans en avoir conscience, quantité d’informations personnelles. Que deviennent-elles ? Qui peut les utiliser ? Avec les puissances de calcul de l’IA, jusqu’où peut-on aller dans leur exploitation ? Ces usages sont-ils cadrés, et par qui ?Avec : Jessica Pidoux, sociologue du numérique à l'Université de Neuchâtel, Institut de sociologie. En tant que chercheuse postdoctorale, elle mène des enquêtes à l'intersection de la sociologie des algorithmes et de la sociologie du travail, en utilisant des méthodes de sciences participatives. Elle est titulaire d'un master en sociologie de l'Université de Lausanne et d'un doctorat en humanités numériques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Ses recherches sur la dynamique des rencontres en ligne ont porté sur les algorithmes d'appariement, les pratiques des développeurs et les expériences des utilisateurs et utilisatrices, mettant en évidence divers types de biais algorithmiques et contribuant aux connaissances sur les processus de communication entre l'humain et la machine. Elle est également directrice de PersonalData.IO, une ONG suisse spécialisée dans l'exercice des droits d’accès aux données personnelles et de protection de la vie privée. À ce titre, elle a mené des audits algorithmiques sur des plateformes de travail telles que Deliveroo et Uber, contribuant ainsi à l'instauration de conditions de travail équitables pour les travailleurs, plus largement, aux débats sur les politiques publiques de régulation du numérique.Bertrand Monthubert, président du Conseil National de l'Information Géolocalisée, qui regroupe des représentants de la très grande variété d’acteurs qui composent l’écosystème de la géo-donnée en France. Il est également président d'Ekitia, une association regroupant des acteurs publics et privés désireux de créer un cadre de confiance pour l'économie de la donnée.Il préside OPenIG, la plateforme régionale d'Occitanie pour l'information géographique. Il est aussi co-président du groupe de travail sur la gouvernance des données au sein du partenariat mondial de l'intelligence artificielle (Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI).C'est un acteur du développement de l'usage des données au niveau territorial, national et international, au service des usages citoyens et des politiques publiques. À ce titre il est co-auteur d'un rapport, avec Christine Hennion et Magali Altounian, sur le thème "Data et Territoires", remis en novembre 2023 à Stanislas Guérini, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
La médecine du futur va-t-elle se résumer à un dialogue entre le patient et une IA ? Détour vers le futur décode la répartition des tâches entre les médecins et l’intelligence artificielle dans le futur proche.Que ce soit pour détecter un mélanome ou un cancer du sein, pour établir des probabilités de déclencher telle ou telle maladie pour un patient, ou encore pour assurer le bon fonctionnement de l’application de prise de RV médicaux, l’IA semble désormais faire partie intégrante de nos parcours de santé. Mais peut-on faire confiance à l’IA pour les questions de santé, et quelle place pour les médecins dans le futur ?Avec : Marie Eve Rougé- Bugat, Professeur de Médecine Générale à l’Université Paul Sabatier et médecin généraliste exerçant à Toulouse. Titulaire du DESC de Cancérologie intervenant à l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole. Elle est également chercheur de l’unité Mixte de recherche UMR1295 équipe CERPOP « Centre d'Epidémiologie et de Recherche en santé des POPulations ». Jérôme Béranger, Docteur en éthique du digital, conférencier et dirigeant de la société ADELIAA spécialisée dans l’accompagnement et l’évaluation éthique des projets digitaux. Chercheur associé dans l’équipe BIOETHICS à l’UMR 1295 – CEROP de l’INSERM de l’Université de Toulouse III.Ses recherches sont centrées sur l'approche morale et sociétale de la révolution digitale centrée sur le concept de l’Ethics by Evolution. Il a publié plus d’une centaine de contributions écrites à la fois scientifiques ou non, ainsi que cinq ouvrages. Enfin, il est membre du Conseil du Numérique en Santé.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.