Discover Projet Utopia
Projet Utopia

Projet Utopia
Author: Projet Utopia
Subscribed: 27Played: 390Subscribe
Share
© All rights reserved
Description
Aiguisons notre esprit critique envers les discours trompeurs, interrogeons des experts et questionnons nos certitudes, afin d'améliorer ensemble notre lecture du réel. Le podcast s'intéresse à la question de la science au sein de la société et tente de remettre la connaissance au coeur du processus démocratique, en offrant un canal de diffusion aux réflexions d'experts sur diverses thématiques sociétales en lien plus ou moins direct avec les thématiques chères au rationalisme et au scepticisme scientifique ( = doute méthodique) : la rationalité, l'esprit critique, l'épistémologie, la science, mais aussi la désinformation, les fake news, l'emprise mentale, les dérives sectaires, les pseudo-sciences, le paranormal ou encore le complotisme...
Nous soutenir :
patreon.com/ProjetUtopia ()
ou
https://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
31 Episodes
Reverse
Qu'est-ce qui se cache derrière la rhétorique complotiste ?Aujourd'hui je vous présente le fruit d'un travail en cours d'écriture, où je m'interroge sur la rhétorique complotiste et comment celle-ci rejoint les connaissances scientifiques sur le complotisme. À travers différentes phrases types, voire clichées, je vous propose une réflexion sur les différentes dimension qui peuvent émerger de ces discours. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à "On ne nous dit pas tout !", une préoccupation centrale du discours conspirationniste.Cet épisode Bonusà été entièrement rédigé par Loïc Massaïa (moi-même), et "lu" grace à Eleven labs, un générateur de voix artificielles.-------------------Soutenir mon travail :https://fr.tipeee.com/projet-utopiaouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Suite et fin de mon entretien avec Séverine Falkowicz, spécialiste de l'influence sociale et de la manipulation comportementale. Elle est également co-autrice, avec Alexander Samuel, Thierry Ripoll et Fabien Girandola, du livre « Complotisme et manipulations, petit guide pour déjouer les fausses croyances, fake news, et autres fadaises », publié aux éditions Book e Book.Aujourd'hui, nous cherchons à comprendre comment se prémunir contre l’attrait des théories conspirationnistes, et comment dialoguer avec les personnes qui adhèrent à de telles croyances. À travers son expertise, Séverine nous proposera des pistes concrètes pour engager le dialogue.Restez avec nous pour cet échange éclairant sur le développement de l'esprit critique face aux fausses croyances qui se répandent sur internet !------------------------------------------Les livres de Séverine, avec les sources soutenant ses propos :https://www.book-e-book.com/livres/225-complotisme-et-manipulation.htmlhttps://www.editions-eyrolles.com/livre/au-coeur-de-l-esprit-critique-------------------------------------------Soutenir mon travail :https://fr.tipeee.com/projet-utopiaouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Suite de mon entretien avec Séverine Falkowicz ! Spécialiste de l'influence sociale et de la manipulation comportementale, elle est également co-autrice du livre “Complotisme et manipulations. Petit guide pour déjouer les fausses croyances, fake news, et autres fadaises”, au éditions Book e Book, avec Alexander Samuel, Thierry Ripoll et Fabien Girandola.Dans cet épisode, nous allons parler d’esprit critique. Alors, les complotistes en ont-ils trop ou pas assez ? Et quels sont les processus psychologiques qui peuvent conduire à adhérer aux théories du complot ?Je remercie à nouveau Éliot et Clémence pour leur accueil lors de l’enregistrement de cet épisode, et n’oubliez pas que si vous souhaitez me remercier pour ce travail, il est désormais possible de me laisser un pourboire via Tipeee ou Liberapay… --------------------------Les livres de Séverine, avec les sources soutenant ses propos :https://www.book-e-book.com/livres/225-complotisme-et-manipulation.htmlhttps://www.editions-eyrolles.com/livre/au-coeur-de-l-esprit-critique-------------------------Soutenir mon travail :https://fr.tipeee.com/projet-utopiaouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'un phénomène qui fascine autant qu'il divise : le complotisme. Pourquoi tant de gens croient-ils à des théories alternatives, où un groupe d’individus cachés et malveillants tirent les ficelles de nos sociétés ? Et quoi de mieux que la psychologie sociale pour comprendre un phénomène aux dimensions multiples, qui touche à la fois à la manière de voir le monde, aux raisonnements, mais également à la société et à ses mécanismes qui nous guident et nous façonnent ?Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Falkowicz, spécialiste de l'influence sociale et de la manipulation comportementale, elle est également co-autrice du livre “Complotisme et manipulations. Petit guide pour déjouer les fausses croyances, fake news, et autres fadaises”, au éditions Book e Book, avec Alexander Samuel, Thierry Ripoll et Fabien Girandola. À travers ce podcast, elle nous éclairera sur les mécanismes socio-psychologiques qui sous-tendent les théories du complot. Si vous vous posez des questions sur le complotisme, il est probable que vous trouviez des réponses en nous écoutant.Avant de commencer je tenais tout particulièrement à remercier Eliot et Clémence d’avoir eu la gentillesse de nous accueillir chez eux jusqu’à 2h du matin pour enregistrer cet épisode ! Encore une fois, un grand merci !Soutenir mon travail :https://fr.tipeee.com/projet-utopiaouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Les livres de Séverine :https://www.book-e-book.com/livres/225-complotisme-et-manipulation.htmlhttps://www.editions-eyrolles.com/livre/au-coeur-de-l-esprit-critiqueHébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Aujourd’hui, nous retrouvons Jérémy Attard pour un 3eme et dernier épisode autour de sa thèse : "Vers un modèle unitaire de la scientificité". Une question essentielle traverse ses recherches : existe-t-il une frontière claire entre ce qui est scientifique et ce qui ne l’est pas, ou devons-nous repenser cette démarcation ?Dans les épisodes précédents nous avons vu comment penser la question de la scientificité au-delà de la vision de Karl Popper, notamment à travers différents critères de scientificité. Nous avons également abordé la scientificité des sciences humaines et sociales, et en particulier la sociologie.Aujourd'hui, nous allons voir comment la science pourrait être vue comme un processus d’optimisation, puis nous parlerons des limites du travail de Jeremy avant d’en finir avec les prochains objectifs qui pourraient permettre d’améliorer cette réflexion !Une fois n’est pas coutume, préparez votre aspirine et bonne écoute !--------------------------------------Source : Attard Jeremy. Vers un modèle unitaire de la scientificité. Thèse de doctorat. 2024. En ligne sur : https://philpapers.org/archive/ATTVUM-2.pdf--------------------------------------Nous soutenir :patreon.com/ProjetUtopiaouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Petit bonus rigolo pour le 1er avrilNous soutenir :patreon.com/ProjetUtopia ouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Aujourd’hui, nous retrouvons Jérémy Attard pour un 2eme épisode autour de sa thèse : "Vers un modèle unitaire de la scientificité". Une question essentielle traverse ces recherches : existe-t-il une frontière claire entre ce qui est scientifique et ce qui ne l’est pas, ou devons-nous repenser cette démarcation ?Au fil de cet épisode, nous plongerons dans les défis que pose la définition de la science elle-même. Peut-on réellement établir des critères universels pour dire qu’une discipline, une théorie ou une méthode est scientifique ? Quels sont les risques d’une vision trop rigide ou, au contraire, trop permissive de la scientificité ? Et quelle est la place des sciences humaines et sociales, et en particulier la sociologie, dans tout ça ?À travers son approche, Jérémy nous invite à dépasser les clivages traditionnels hérités de Karl Popper et à interroger nos propres certitudes. C’est ce que nous allons continuer à explorer ensemble. Installez-vous confortablement, préparez cette fois-ci encore votre cachet d’aspirine et laissez-vous porter par cette réflexion captivante sur l’essence même de la connaissance scientifique.-----------------------------------Source : Attard Jeremy. Vers un modèle unitaire de la scientificité. Thèse de doctorat. 2024. En ligne sur : https://philpapers.org/archive/ATTVUM-2.pdf-----------------------------------Nous soutenir :patreon.com/ProjetUtopia ouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Aujourd’hui, on va s’attaquer à une question complexe : qu’est-ce qui fait qu’une théorie est scientifique ? Cette question de la scientificité est centrale en philosophie des sciences et reste encore largement débattue aujourd’hui.Pour en parler, j’ai avec moi Jérémy Attard, physicien et philosophe des sciences. Dans sa thèse de doctorat, Jérémy s’est plongé dans cet intense débat intellectuel, en essayant de répondre notamment à la question des différentes épistémologies des sciences. Pour faire simple une épistémologie pourrait être définie comme étant l’ensemble des méthodes et principes qui permettent de construire et de valider des connaissances.En s’appuyant sur des figures comme Popper, Kuhn ou encore Lakatos, Jérémy va remettre en question certaines de nos idées reçues. Il nous expliquera pourquoi la seule notion de "falsifiabilité" de Popper n’est pas suffisante et comment il est possible d’appréhender la scientificité autrement.Mais on ne s’arrêtera pas là ! On parlera également des sciences sociales, qui se revendiquent souvent d’autres épistémologies que celles en vigueur en physique ou en biologie... Ont-elles réellement besoin de leur propre épistémologie ? Et comment pourrait-on essayer de réunir ces différentes approches sous une même bannière, une même scientificité ?Ce podcast vous offrira quelques clés et pistes pour vos propres réflexions. Choses bien utiles pour votre esprit critique ! Cela vous permettra notamment d’enrichir votre cadre épistémique, d'étayer la lutte contre les fausses sciences, de réfléchir à la place des disciplines émergentes et d’améliorer votre regard critique sur la science elle-même. Une chose est sûre : après cette conversation, vous ne verrez plus la science de la même manière !Alors, installez-vous, prenez une aspirine et plongeons ensemble dans ces questions complexes, mais fascinantes.-----------------------------------Source : Attard Jeremy. Vers un modèle unitaire de la scientificité. Thèse de doctorat. 2024. En ligne sur : https://philpapers.org/archive/ATTVUM-2.pdf-----------------------------------Nous soutenir :patreon.com/ProjetUtopia ouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Suite et fin de mon entretien avec Yvan Sonjon. Si vous avez raté les deux précédents épisodes, je vous invite à les écouter avant celui-ci, car il sont indispensables pour bien comprendre ce que nous allons aborder aujourd’hui !En effet, dans le premier épisode nous avions abordé la notion de cognition sociale, et dans le 2ème, nous avons parlé de la douleur, pour enfin en venir dans cet épisode au lien entre les deux. Pour cela, Yvan va nous parler plus précisément de son travail de thèse, qui le passionne !Et je profite de cette introduction pour vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2025 !Les travaux scientifiques d'Yvanhttps://doi.org/10.1016/j.kine.2022.12.020https://doi.org/10.31219/osf.io/kztrc (preprint) Conférence « La douleur c'est dans la tête! » : qu'en dit la recherche scientifique ? - Yvan Sonjonhttps://www.youtube.com/watch?v=2PAGvNuDoh4Nous soutenir :https://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ oupatreon.com/ProjetUtopia Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Part. 2. La douleur : une expérience subjective complexePourquoi ressentons-nous de la douleur ? Est-ce une simple réaction physique ou existe-t-il d’autres dimensions à explorer ? Pour nous guider dans ces questionnements, nous accueillons aujourd’hui Yvan Sonjon, doctorant au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Ensemble, nous allons explorer le lien entre douleurs chroniques et cognition sociale, une thématique essentielle qui nous permettra de mieux comprendre comment nos interactions sociales et nos perceptions influencent notre expérience de la douleur.Dans le précédent épisode nous avons parlé de cognition sociale, et c’est aujourd’hui le tour de la douleur. Qu’est-ce que la douleur, comment la définit-on, quelles sont ses multiples dimensions ? Voilà ce qui va être développé dans ce deuxième épisode, et croyez-moi, vous allez découvrir des choses sur ce phénomène pourtant si commun !-------------------------------------Nous soutenir :patreon.com/ProjetUtopia ouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ ------------------------------------SourcesChen, J. (2011). History of pain theories. Neuroscience Bulletin, 27(5), 343‑350. https://doi.org/10.1007/s12264-011-0139-0Melzack, R. (2005). Evolution of the Neuromatrix Theory of Pain. The Prithvi Raj Lecture : Presented at the Third World Congress of World Institute of Pain, Barcelona 2004. Pain Practice, 5(2), 85‑94. https://doi.org/10.1111/j.1533-2500.2005.05203.xRaja, S. N., Carr, D. B., Cohen, M., Finnerup, N. B., Flor, H., Gibson, S., Keefe, F. J., Mogil, J. S., Ringkamp, M., Sluka, K. A., Song, X.-J., Stevens, B., Sullivan, M. D., Tutelman, P. R., Ushida, T., & Vader, K. (2020). The revised International Association for the Study of Pain definition of pain : Concepts, challenges, and compromises. Pain, 161(9), 1976‑1982. https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939Site internet de l’IASP : https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/#painBrodal, P. (2017). A neurobiologist’s attempt to understand persistent pain. Scandinavian Journal of Pain, 15, 140‑147. https://doi.org/10.1016/j.sjpain.2017.03.001Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Épisode 1 : La cognition sociale, cadre théorique et concepts clésPourquoi ressentons-nous de la douleur ? Est-ce une simple réaction physique ou existe-t-il d’autres dimensions à explorer ? Pour nous guider dans ces questionnements, nous accueillons aujourd’hui Yvan Sonjon, doctorant au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Ensemble, nous allons explorer le lien entre douleurs chroniques et cognition sociale, une thématique essentielle qui nous permettra de mieux comprendre comment nos interactions sociales et nos perceptions influencent notre expérience de la douleur.Ce podcast sera divisé en 3 parties. Aujourd’hui nous nous consacrerons à la cognition sociale, une discipline trop méconnue des sciences cognitives, et dont les mécanismes sont cruciaux pour comprendre nos relations interpersonnelles mais également l’influence du contexte social dans le fonctionnement de notre cerveau.Dans les prochains épisodes, nous discuterons de la question de la douleur, puis, enfin, nous verrons comment et pourquoi les sciences cognitives s'intéressent aujourd’hui à sa dimension sociale.J’espère que vous êtes prêt… C’est promis, on va essayer de ne pas trop vous faire souffrir !Nous soutenir :patreon.com/ProjetUtopia ouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ ------------------------------------------------------------------------Sources :Miller, G. A. (2003). The cognitive revolution : A historical perspective. Trends in Cognitive Sciences, 7(3), 141‑144. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00029-9Carlston, D. E. (Éd.). (2013). The Oxford handbook of social cognition. Oxford University Press.Quesque, F., Apperly, I., Baillargeon, R., Baron-Cohen, S., Becchio, C., Bekkering, H., Bernstein, D., Bertoux, M., Bird, G., Bukowski, H., Burgmer, P., Carruthers, P., Catmur, C., Dziobek, I., Epley, N., Erle, T. M., Frith, C., Frith, U., Galang, C. M., … Brass, M. (2024). Defining key concepts for mental state attribution. Communications Psychology, 2(1), 29.https://doi.org/10.1038/s44271-024-00077-6Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Avec Antonin Atger, auteur de science fiction et doctorant en psychologie sociale sur le thème du complotisme, nous continuons notre exploration de la fiction en lien avec l’esprit critique. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment la fiction se servait du complotisme pour tisser ses récits, et comment le complotisme s’inspirait de la fiction, et notamment des films pour enrichir son propre storytelling. Si vous désirez connaître les travaux scientifiques sur la question, ils ne sont pas très nombreux, mais vous pourrez en avoir une synthèse dans l’excellent ouvrage de Sébastian Dieguez et Sylvain Delouvée “Le complotisme, cognition, culture et société”. Et plus précisément au sein du chapitre 1 : la vérité est ailleurs, le complotisme comme fiction.Mais aujourd’hui, nous allons parler de tout autre chose… Comment la fiction peut- elle être utilisée pour solliciter, entretenir, activer notre esprit critique...ATTENTION plusieurs fins de films sont spoilées !Nous soutenir :patreon.com/ProjetUtopia ouhttps://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/ Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
En lisant ou en regardant de la fiction, on ne pense pas forcément que celle-ci puisse solliciter notre esprit critique. Pire même : peut-être qu'en lisant des histoires de complots, d'aliens ou de fantastique, nous venons à croire que ces éléments ne sont peut-être pas si fictionnels que ça ! Que ce soit par la forme ou le fond, la fiction est un puissant outil de réflexion sur le monde. Elle est également vectrice d’idéologies et de valeurs qui peuvent être interrogées, et elle peut même aller jusqu’à suggérer une vision complotiste du monde.Alors, qui de mieux qu’Antonin Atger pour parler de tout ça ? En effet, Antonin est auteur de romans d’anticipation, interrogeant notre société et les rapports humains, mais il est également doctorant en psychologie sociale sur le sujet du complotisme.Cette série de podcast sera construite sur deux grands axes, dans un premier temps, nous parlerons du lien entre fiction et complotisme, puis nous verrons dans un deuxième temps comment la fiction peut nous entraîner à user de notre esprit critique !Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans le précédent épisode, nous avons vu avec Valentin Ruggeri ce que veut dire “ça marche” en médecine… Comment s’assure-t-on de l'efficacité d’un traitement, et quels sont les biais à éviter lorsqu’on veut s’assurer qu’il marche ou non ?Si vous ne l’avez pas encore écouté, je vous conseille vivement de le faire avant d’entamer ce 2eme épisode, car nous allons entrer dans le vif du sujet, en mettant en perspective l’efficacité des médecines complémentaires vis à vis de tout ce qui a été développé précédemment . Nous nous poserons alors la question qui brûle les lèvres de tout le monde : Mais alors, qu’est-ce qui marche vraiment dans toute cette histoire ?Pour rappel, Valentin est médecin nucléaire, et vous pouvez le suivre sur X/Twitter sous le pseudonyme @scintigraphiste. Nous vous conseillons également un excellent livre intitulé Médecines alternatives et complémentaires, qu’est ce qui marche ? deFlorian Gouthière et Alexandra Delbot, aux éditions Les arènes. Gageons qu’il s’agit là du parfait complément à ce double épisode du podcast !Aller, c’est parti, voyons désormais qu’est-ce qui marche dans ces médecines très prisées par le grand public…-----------------L'effet contextuel de la consultation sur le syndrome de l'intestin irritable : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2364862/-----------------Soutenir le projet Utopia avec Liberapay : https://liberapay.com/Projet_Utopia/Avec Patreon : https://www.patreon.com/ProjetUtopiaNous suivre sur X/Twitter : https://twitter.com/Utopia_RabbitFacebook : https://www.facebook.com/ProjetUtopiaInstagram : https://www.instagram.com/projet.utopia/Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Souvent décriées, les médecines alternatives et complémentaires rencontrent pourtant un certain succès auprès de la population. Homéopathie, naturopathie, ostéopathie ou encore acupuncture, vous connaissez forcément des personnes ne jurant que par ces thérapies, et peut-être même que vous en êtes plus ou moins adeptes…Car de la bouche même de celles et ceux qui les ont essayés, cela ne fait aucun doute: ça marche ! Si tout le monde le dit, c’est que ça doit être vrai !Dans ce podcast en 2 parties, nous allons vous expliquer, pourquoi ça marche. Ou plutôt pourquoi on a l’impression que ça marche, et qu’est ce qui marche vraiment dans toute cette histoire ! Mais au fait, savez-vous vraiment ce qu’on entend en disant que ça marche ?Avec Valentin Ruggeri, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Le scintigraphiste sur X-Twitter, nous allons parler de tout ça. Médecin nucléaire s’intéressant aux médecines alternatives, il va nous expliquer comment on évalue l’efficacité d’un médicament ou d’un soin. Car oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de bien comprendre diverses notions indispensables…Hasard du calendrier : les journalistes Florian Gouthière et Alexandra Delbot viennent de publier un excellent livre intitulé Médecines alternatives et complémentaires, qu’est ce qui marche ? Aux éditions Les arènes. Gageons qu’il s’agit là du parfait complément à ce double épisode du podcast !----------------------------------Aller plus loin :Cochrane :https://www.cochrane.org/Cochrane library, pour retouver tout les publis cochrane :https://www.cochranelibrary.com/Cochrane france :https://france.cochrane.org/--------------Soutenir le projet Utopia avec Liberapay : https://liberapay.com/Projet_Utopia/Avec Patreon : https://www.patreon.com/ProjetUtopiaNous suivre sur X/Twitter : https://twitter.com/Utopia_RabbitFacebook : https://www.facebook.com/ProjetUtopiaInstagram : https://www.instagram.com/projet.utopia/Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Suite et fin de notre entretien avec Denis Caroti.Ensemble,nous allons continuer notre exploration de l’esprit critique et plonger toujours plus profondément dans la complexité du sujet. Pour bien comprendre tout ce dont il sera question ici, je vous conseille donc d’écouter les deux précédents épisodes, ou au moins le second, si ce n’est pas déjà fait !Concentrez-vous, nous aborderons ici les notions les plus cruciales dans la compréhension de l’esprit critique telles que l’autonomie intellectuelle, le positionnement politique, la neutralité scientifique, le risque scientiste ou encore le boss final de la complexité : la question les valeurs individuelles.sourcesConférence de Claudine Tiercelin, Les vertus épistémiqueshttps://youtu.be/UFFVZ6-fkx4Suivez-nous sur X/Twitter, facebook, instagram, Threads ou encore BlueskySoutenez-nous via Patreon ou Liberapay !Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Suite de notre dernier épisode en compagnie de Denis Caroti. Il s’agit de la 2ème partie de cette émission dédiée à l’esprit critique, qui se clôturera avec un 3ème volet le mois prochain.Avant de vous présenter l’épisode du jour, je désirais vous souhaiter une très bonne année 2024, à vous chers auditeurs et auditrices, et à vos proches. Merci d’être présent et à l’écoute, et merci de suivre et de soutenir le Projet Utopia sous toutes ses formes !D’ailleurs, pour cette nouvelle année, j’ai ouvert une page Patreon et Liberapay ! Alors, si vous voulez soutenir le projet et contribuer à son développement vous pouvez faire un don sur une de ces plateforme, avec une préférence de notre part pour Liberapay qui est un service libre qui prendra soin de vos données personnelles. Ces dons nous permettront de réduire le montant de nos dépenses annuelles. Je ferai bientôt une vidéo et un podcast expliquant combien nous coûte et nous rapporte notre travail, pour un maximum de transparence ! Mais revenons à l’émission du jour !Aujourd’hui, nous allons approfondir la question de l’esprit critique, tenter d’en exprimer les contours et la complexité. Où en est Denis dans ses questionnements actuels ? Peut-on limiter l’esprit critique à l’utilisation de certains outils épistémiques ? Peut-on transmettre l’esprit critique et si oui est-ce simple d’y parvenir ? Avec Denis, docteur en sciences de l’éducation et formateur dans le cadre de l’éducation nationale aux questions en lien avec la citoyenneté et l’esprit critique, nous allons tenter de répondre à ces questions…--------------Conférence de Claudine Tiercelin, Les vertus épistémiqueshttps://youtu.be/UFFVZ6-fkx4Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Aujourd’hui, nous recevons Denis Caroti. Denis à de nombreuses casquettes, mais celles qui nous intéressent aujourd’hui sont celles de formateur et de chercheur sur le thème de l’esprit critique.
Avec lui, nous allons parler dans ce premier épisode du parcours qu’il a suivi pour en arriver là où il en est aujourd’hui, puis dans le prochain épisode, nous aborderons les difficultés, ainsi que la complexité liées à l’esprit critique, de sa définition jusqu’à la question de la transmission. L’esprit critique est un long parcours, une odyssée faite de subtilités, de complications et de remises en questions, ensemble, nous allons d’abord parler zététique, outils et méthode, pour ensuite embarquer vers des horizons bien plus houleux et complexes. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Suite de notre podcast sur la psychanalyse avec Nathanaël Larigaldie. Dans le premier épisode nous avons parlé du parcours de Nathanaël, qui a adhéré aux préceptes psychanalytiques au début de ses études, et qui, depuis, porte de sérieuses critiques à cette psychothérapie encore énormément répandue en France.
À ce stade, si vous ne connaissez pas vraiment les critiques portées contre la psychanalyse et que vous désirez aller plus loin, nous pouvons vous conseiller de lire des articles critiques sur l’approche psychanalytique de l’autisme ou sur les élucubrations psychanalytiques utilisées dans la justice, par ex. Sur d’autres supports, nous conseillons en vidéo “Regard scientifique sur la psychanalyse” sur la chaîne de la Tronche en Biais, et “Que vaut la psychanalyse” sur le podcast Meta de choc. Les arguments contre la psychanalyse sont nombreux et généralement pertinents, et démontrent surtout les nombreux risques qu’il y a à adhérer ou à espérer se faire soigner grâce à elle. Son paradigme, culpabilisant tout particulièrement les parents et surtout les mères, témoigne des représentations culturelles et sexistes d’un autre âge. Pourtant, certaines critiques parfois employées contre la psychanalyse, depuis devenue des idées reçues, mériteraient certaines nuances et précisions. En effet, pour bien comprendre quels sont les problèmes posés par cette pratique, il faut poser un peu d’esprit critique sur notre propre compréhension épistémologique des choses. Pour rappel, notre objectif n’est pas de redorer le blason de cette discipline, mais de recentrer les critiques sur des questions plus pertinentes…
Cher Utopistes, soyez prêts, car non seulement ça va un peu piquer certains arguments que peut-être vous chérissez, mais aussi, nous n’allons pas épargner la psychologie scientifique, dont certaines limites peuvent être approchées de celles de la psychanalyse !
Sources :
L'IRM dévoile les modification cérébrales induites par l'acting :
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.181908
L'Anna Freud Society donne des formation doctorales en collaboration avec l'UCL (Université de Londres) :
https://www.annafreud.org/training/postgraduate-study/ucl-postgraduate-programmes/psychoanalytic-studies-mphil-phd/
On peut trouver une page dédiée sur le site de l'UCL :
https://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/
aller plus loin :
[Podcast]
Critique approfondie de la psychanalyse :
https://metadechoc.fr/podcast/que-vaut-la-psychanalyse/
https://metadechoc.fr/podcast/la-psychanalyse-a-lepreuve-de-lhistoire-et-de-la-science/
[Articles]
Critique de l’approche psychanalytique de l’autisme :
https://informations.handicap.fr/a-autisme-approche-psychanalytique-alerte-32017.php
http://www.psychomedia.qc.ca/autisme/2018-07-22/essai-clinique-packing
La psychanalyse dans les tribunaux :
https://www.nouvelobs.com/justice/20191022.OBS20163/tribune-pourquoi-les-psychanalystes-doivent-etre-exclus-des-tribunaux.html
Avec son complément ici : https://menace-theoriste.fr/les-psychanalystes-ne-savent-pas-defendre-leurs-pratiques/
[Vidéos]
Regard scientifique sur la psychanalyse
https://www.youtube.com/watch?v=RBd2sm-0eyM&t=4s
La psychanalyse est-elle une secte ?
https://www.youtube.com/watch?v=Y1g7UmLV4LQ
[livres]
Critique détaillée de plusieurs anciens psychanalystes :
https://www.babelio.com/livres/Meyer-Le-livre-noir-de-la-psychanalyse--Vivre-penser-et/4598
Nous soutenir :
patreon.com/ProjetUtopia
ou
https://fr.liberapay.com/Projet_Utopia/
Depuis sa création, la psychanalyse séduit autant qu’elle irrite. Historiquement, elle représente le cheminement logique de l’avènement de la neurologie moderne portée par Charcot et Duchenne dans la deuxième moitié du XIXème siècle. En effet, Sigmung Freud, neurologue lui-même, déduisit des travaux de Charcot sur l’hystérie qu’il existait des mécanismes inconscient qu’il passa sa vie à tenter d’explorer.
Aujourd’hui, 130 ans après son invention et autant d’années de vives critiques de mieux en mieux étayées, la psychanalyse inspire encore l’intérêt et la fascination. Mais seulement en France… Et en Argentine… En effet, tous les autres pays du monde l’auraient abandonnée, la reléguant là où est sa place : auprès des pseudosciences...
Mais est-ce que tout ça est parfaitement exact ?
Aujourd’hui, nous recevons Nathanaël Larigaldie, docteur en neurosciences computationnelles, qui à lui-même adhéré aux théories psychanalytiques pendant ses études, avant d’en déconstruire petit à petit ses représentations. Avec lui, nous ne compilerons pas toutes les critiques faites à cette discipline, mais nous attarderons essentiellement sur son parcours, et parlerons également de certaines inexactitudes concernant les critiques de la psychanalyse. Dans cette optique, nous poseront notamment certaines nuances, non pas pour redorer le blason de cette pratique, mais pour recentrer les critiques sur des questions plus pertinentes… Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.





![La rhétorique complotiste #1 - "On ne nous dit pas tout !", par Loïc Massaïa [BONUS] La rhétorique complotiste #1 - "On ne nous dit pas tout !", par Loïc Massaïa [BONUS]](https://s3.castbox.fm/a8/e1/7a/5113229f18e06561bcd0220f41a25dff44_scaled_v1_400.jpg)




![Le bullshiteur et la mamie [Les fables de la foutaise #1] Le bullshiteur et la mamie [Les fables de la foutaise #1]](https://image.ausha.co/qxmELnL1PA85oG7xDOnzHam5eNsG5UB9ikwSHi6e_1400x1400.jpeg?t=1754653734)












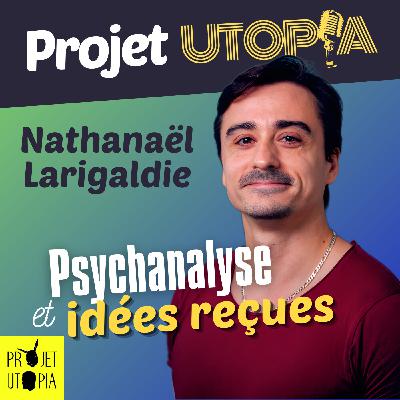




sujet et écriture ok mais vocalisation IA ça c'est non.. Les. micro pauses et les respirations dans l'élocution sont hasardeuses, désagréables à l'écoute. C'est fatiguant à écouter. De plus c'est profiter d'une technologie qui pille et fragilise notre capacité à créer et les emplois de ces secteurs créatifs. Pas. bien. du tout.