Discover BorderLine
BorderLine
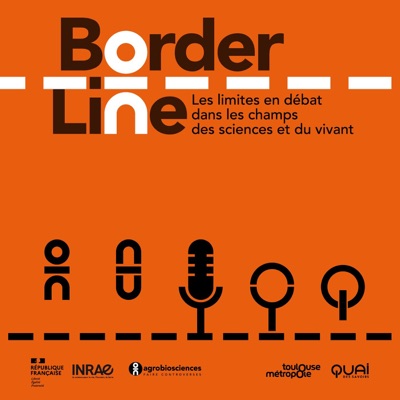
BorderLine
Author: BorderLine
Subscribed: 0Played: 0Subscribe
Share
© Quai des savoirs - Inrae Mission Agrobiosciences
Description
Les limites en débat dans les champs des sciences et du vivant.
BorderLine, une série de podcasts coproduit par le Quai des Savoirs et la Mission Agrobiosciences-INRAE. Cette émission vous est présentée par Marina Léonard (Quai des Savoirs) & Valérie Péan (Mission Agrobiosciences-INRAE), avec l’aide de Laura Martin-Meyer et Christophe Tréhet. Prise de son : Laurent Codoul, captation vidéo : Vidélio, réalisation : Arnaud Maisonneuve.
Coprodution AGROBIOSCIENCES - QUAI DES SAVOIRS | 2021-2022
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
BorderLine, une série de podcasts coproduit par le Quai des Savoirs et la Mission Agrobiosciences-INRAE. Cette émission vous est présentée par Marina Léonard (Quai des Savoirs) & Valérie Péan (Mission Agrobiosciences-INRAE), avec l’aide de Laura Martin-Meyer et Christophe Tréhet. Prise de son : Laurent Codoul, captation vidéo : Vidélio, réalisation : Arnaud Maisonneuve.
Coprodution AGROBIOSCIENCES - QUAI DES SAVOIRS | 2021-2022
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
7 Episodes
Reverse
On dit l'expertise scientifique en crise, l'expert mal-aimé et instrumentalisé. Il faut dire que la défiance du citoyen peut être légitime. Souvenons-nous de la pandémie et des experts mis en avant par le gouvernement avec le Conseil scientifique Covid-19, mais aussi l’inflation d’experts "autoproclamés" sur les plateaux. Sans oublier les soupçons qui pèsent sur les évaluations des risques sur les pesticides et autres substances. Au milieu des discours cacophoniques, qui croire ? Et au fait, c’est quoi, vraiment, un expert scientifique ? Entre savoir et pouvoir, quelles sont les contraintes de son exercice et comment en dépasser les limites ?
Pour en débattre : Jean-Pierre CRAVEDI, président du conseil scientifique d’Aprifel, ancien directeur de recherche INRAE, ancien expert au sein de l’EFSA ; Pierre-Benoît JOLY, président du centre INRAE Occitanie-Toulouse, spécialiste de sociologie de l’innovation, président du groupe de travail "Crédibilité de l’expertise scientifique" issu du conseil scientifique de l’Anses ; Didier POURQUERY, journaliste, président de The Conversation France et de Cap Sciences ; Bruno SPIRE, directeur de l’équipe SanteRCom (Inserm), ancien président de l’association AIDES. Avec les réactions - nombreuses - du public du Quai des Savoirs.
Co-organisée par la Mission Agrobiosciences-INRAE et le Quai des Savoirs, cette rencontre s'est déroulée le jeudi 06 juillet 2023. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Entregistré au Quai des Savoirs, ce nouveau podcast de la série BorderLine s'intéresse à la Sécurité Sociale de l'Alimentation, cette initiative expérimentée en plusieurs territoires français qui vise notamment à lutter contre la précarité alimentaire. Le principe : intégrer l’alimentation dans le régime général de la sécurité sociale, en proposant une carte vitale de l’alimentation qui donnerait accès à des produits conventionnés, pour un montant de 150€ environ.
Au micro, Dominique Paturel, chercheuse INRAE en sciences de gestion, membre du collectif Démocratie alimentaire et Franck Le Morvan, inspecteur général des affaires sociales qui a piloté le groupe de concertation du Conseil National de l’Alimentation « Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire » évoquent les enjeux de cette question de la précarité alimentaire. Respectivement coordinatrice de Caissalim-Toulouse et membre du Collectif Acclimat'action, Sarah Cohen et David Fimat témoignent de l'esprit qui anime les caisses qui se structurent pas à pas à Toulouse et Bordeaux. Dernier à prendre la parole, Nicolas Da Silva, chercheur au Centre d'économie de l'Université Paris 13, rappelle que, si nous en avons dorénavant l'image d'un projet consensuel, l'histoire de la Sécurité sociale est, avant tout, une histoire conflictuelle.
Pour aller toujours plus loin dans l'analyse et la mise en débat, chaque séquence est suivie d'un temps d'échange avec la salle. Où l'on analayse notamment les conditions de mise en oeuvre d'une véritable démocratie alimentaire, représentative et partagée. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
L’annonce avait provoqué la surprise. Début janvier 2022, une équipe de chirurgiens américains de l’École de médecine du Maryland réussissait la transplantation d’un cœur de porc génétiquement modifié chez un patient, David Bennett, hélas décédé deux mois plus tard. Qualifiée toutefois de prouesse technologique, cette opération, dite « xénogreffe » (forgé sur le grec xenos, « étranger ») suscite une foule d’interrogations : quelles sont les frontières biologiques, morales, éthiques ou encore juridiques que viennent bousculer ces transplantations inter-espèces ? Faut-il fixer des limites à leur expansion ? Quelle humanité dessinent-elles ? Oliver Bastien, ancien directeur des prélèvements et des greffes d’organes et de tissus à l’Agence de la biomédecine, Jean-Michel Besnier, philosophe à Sorbonne Université, et Fabien Milanovic, sociologue à Sup’Biotech ont débattu du sujet avec le public, le 15 décembre 2022 au Muséum de Toulouse. Vous n’avez pas pu y assister ? Montez le son, avec ce nouvel épisode de la série BorderLine, coproduite par la Mission Agrobiosciences-Inrae et le Quai des Savoirs. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
On ne cesse de le dénoncer : les dommages causés par les générations passées et actuelles compromettraient l’existence des générations futures. D’un côté, l’urgence climatique ; de l’autre, les effets à long terme des technologies, pollutions ou dégradations environnementales en tous genres, réclament en effet d’agir dès au présent pour ne pas obérer l’avenir. En clair, le concept de générations futures – et à travers lui l’idée d’en défendre les droits – offre pour certains un nouvel horizon plus soutenable à l’action publique. Cette temporalité inédite qui entre en tension avec l’étroitesse des mandats politiques peut-elle être opérable ? Comment esquisser un futur souhaitable sans peser trop fortement sur les seules générations présentes, ni remettre à demain l’ampleur des changements à initier aujourd’hui ?
Avec Valérie Deldrève, directrice de recherche en sociologie à l’INRAE Nouvelle-Aquitaine, spécialiste des inégalités environnementales ; Emilie Gaillard, maître de conférences en droit à Sciences-Po Rennes et coordinatrice générale de la Chaire d’excellence CNRS Normandie pour la paix ; Pousse, étudiante et militante au sein du mouvement Youth for Climate. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Ours, loups, renards, lynx, bouquetins, sangliers, sans parler des oiseaux, insectes et
amphibiens… Les habitats de tous ces animaux ont été bouleversés par les activités humaines, de l’agriculture à l’urbanisation en passant par les loisirs. En France, comme ailleurs, les animaux sauvages n’ont plus guère « lieux » d’être. Protégés ou réintroduits pour pallier l’effondrement de la biodiversité, ils continuent de se heurter à des milieux déjà occupés, où leur présence crée de nouveaux conflits de voisinage. Au plus près des humains, des cheptels ou des cultures, ils sont accusés de maints dégâts, attaques et transmissions de maladies. Le sort réservé à ces fauteurs de troubles économiques, politiques et/ou sanitaires ? Bien souvent effarouchements ou abattages. Un constat qui, pour les uns, doit amener à réfléchir à de nouvelles modalités de cohabitation quand d’autres prônent la coexistence voire un éloignement radical, une remise à distance de ces animaux au sein de territoires exclusivement dédiés. Alors, entre présence humaine et faune sauvage, y a-t-il une bonne distance, ni trop proche, ni trop lointaine ?
Table ronde suivie d’un débat avec le public, avec Béatrice KREMER-COCHET, membre du conseil d’administration de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et coautrice avec Gilbert Cochet de « L’Europe réensauvagée » (Actes Sud, 2022) ; François MOUTOU, vétérinaire et épidémiologiste, ancien directeur adjoint du
laboratoire Santé animale de l’ANSES ; Ruppert VIMAL, géographe, Université de Toulouse-Jean Jaurès (GEODE-CNRS) et Joëlle ZASK, philosophe et notamment auteure de Zoocities (Premier Parallèle, 2020) et de Face à une bête sauvage (Premier Parallèle, 2021).
Une rencontre coanimée par Lucie Gillot (MAA-INRAE) et Marina Léonard (Quai des Savoirs) Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Ours, loups, renards, lynx, bouquetins, sangliers, sans parler des oiseaux, insectes et
amphibiens… Les habitats de tous ces animaux ont été bouleversés par les activités humaines, de l’agriculture à l’urbanisation en passant par les loisirs. En France, comme ailleurs, les animaux sauvages n’ont plus guère « lieux » d’être. Protégés ou réintroduits pour pallier l’effondrement de la biodiversité, ils continuent de se heurter à des milieux déjà occupés, où leur présence crée de nouveaux conflits de voisinage. Au plus près des humains, des cheptels ou des cultures, ils sont accusés de maints dégâts, attaques et transmissions de maladies. Le sort réservé à ces fauteurs de troubles économiques, politiques et/ou sanitaires ? Bien souvent effarouchements ou abattages. Un constat qui, pour les uns, doit amener à réfléchir à de nouvelles modalités de cohabitation quand d’autres prônent la coexistence voire un éloignement radical, une remise à distance de ces animaux au sein de territoires exclusivement dédiés. Alors, entre présence humaine et faune sauvage, y a-t-il une bonne distance, ni trop proche, ni trop lointaine ?
Propos introductifs par Sergio DALLA BERNARDINA, ethnologue, Université de Bretagne Occidentale : entre crainte et fascination, regard sur la faune sauvage.
Emission coanimée par Lucie Gillot (MAA-INRAE) et Marina Léonard (Quai des Savoirs) Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
En partie au nom de l’urgence climatique, la figure du « chercheur-militant » ressurgit fortement, suscitant de nouveaux questionnements et tensions. Avec, d’un côté, les tenants d’une « autonomie » des sciences et, de l’autre, ceux qui estiment qu’il faut engager les savoirs dans l’espace politique. Au-delà des logiques binaires, ce débat propose d’explorer les limites posées traditionnellement entre sciences et militantisme et que semblent franchir de plus en plus de chercheurs dans des disciplines variées. Que dit ce phénomène de la place et du rôle des sciences – et des scientifiques - dans notre société contemporaine ? Doit-il nous inviter à renouveler les approches et les cadres de pensée en matière de production de savoirs ainsi qu’à réfléchir à de nouvelles régulations ?
Au programme de l'émission
"En cause"
Une remise en contexte des mobilisations au sein des mondes académiques et des notions clés du débat telles que la neutralité, avec le sociologue Francis Chateauraynaud (EHESS) et l’historien Pierre Cornu (Inrae).
"En pratique"
Au nom de quoi s’engager ou s’en abstenir ? Qu’est-ce que cela produit ? Témoignages, arguments et échanges entre Laure Teulières (UTJ2), Julian Carrey (INSA), tous les deux membres de l’Atécopol (Atelier d’écologie politique), plateforme d’expertise de la Maison des sciences de l’homme de Toulouse (CNRS-UFT), et Jean-Paul Krivine, rédacteur en chef de Science et pseudo-sciences.
"A la limite…"
Éthique et responsabilité du chercheur, nouvelles configurations sciences-société… Où placer le curseur ? Relecture croisée de Emmanuelle Rial-Sebbag, juriste, directrice de recherche Inserm en bioéthique et droit de la santé et Alain Kaufmann, directeur du ColLaboratoire de l’Université de Lausanne.
Une rencontre coanimée par Valérie Péan (MAA-INRAE) et Marina Léonard (Quai des Savoirs)Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.











