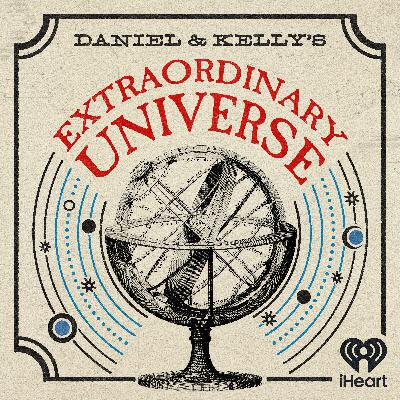Comment se forment les feux follets qui effraient les villages depuis des siècles ? - Choses à Savoir SCIENCES
Description
Depuis le Moyen Âge, les feux follets intriguent et effraient. Ces lueurs vacillantes, observées la nuit dans les marais, les cimetières ou les champs humides, ont longtemps été entourées de légendes. Les paysans d’autrefois pensaient qu’il s’agissait d’âmes perdues, de fantômes ou de démons cherchant à égarer les voyageurs. Dans la tradition européenne, on les appelait aussi « feux de Saint-Elme », « feux du diable » ou « esprits des marais ». Les récits médiévaux décrivent des petites flammes bleues dansant au ras du sol, capables de disparaître dès qu’on s’en approche. Mais la science moderne a fini par lever le mystère.
Les feux follets ne sont pas surnaturels : ils sont le fruit d’une réaction chimique bien connue. Ces phénomènes apparaissent dans les zones riches en matière organique en décomposition — comme les marécages ou les cimetières — où se dégagent naturellement des gaz. Lorsque des végétaux ou des animaux morts se décomposent dans un environnement pauvre en oxygène, des bactéries anaérobies produisent du méthane (CH₄), du phosphure d’hydrogène (PH₃) et du diphosphane (P₂H₄).
Or, ces deux derniers gaz — les phosphures — sont hautement instables et s’enflamment spontanément au contact de l’air. En brûlant, ils allument le méthane présent autour d’eux, créant ces petites flammes bleutées ou verdâtres que l’on perçoit la nuit. La lumière semble flotter, se déplacer ou s’éteindre brusquement, car la combustion est irrégulière et brève. C’est donc un phénomène chimico-atmosphérique, issu d’une combustion lente et localisée de gaz produits par la décomposition biologique.
Dans certains cas, des phénomènes lumineux similaires ont été confondus avec des effets électriques naturels, comme les feux de Saint-Elme — des décharges de plasma apparaissant sur les mats de navires ou les clochers lors d’orages. Mais le feu follet typique, celui des marais, relève bien de la chimie du phosphore et du méthane.
Les scientifiques ont tenté de reproduire ces flammes en laboratoire dès le XIXe siècle, notamment avec des expériences de combustion de phosphine. Les résultats ont confirmé l’hypothèse : les gaz issus de la putréfaction pouvaient effectivement s’enflammer spontanément et produire la même couleur bleue fantomatique.
Aujourd’hui, les feux follets ne sont plus un mystère. Ce sont des flammes naturelles, nées du mélange entre la chimie du vivant et les conditions particulières des sols humides. Ce qui, finalement, rend le phénomène encore plus fascinant : derrière ce spectacle jadis attribué aux esprits se cache simplement l’expression lumineuse de la chimie de la vie et de la mort.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.