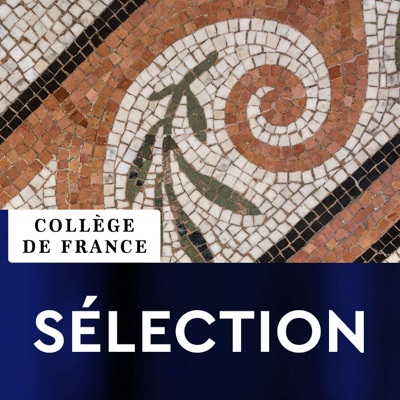Grand événement - Le futur en héritage : Récits de science-fiction et futurs climatiques
Description
Grand événement - À la recherche d'un Avenir Commun Durable
Le futur en héritage
Récits de science-fiction et futurs climatiques
Collège de France
Année 2024-2025
Intervenants :
Jean-Baptiste Minnaert
Professeur d'histoire de l'art contemporain, Université Paris-Sorbonne. Membre de du Centre Chastel
Noëmie Maurin-Gaisne
animatrice-coordinatrice de l'Association régionale des cités-jardins d'Ile-de-France
Benjamin Campech
Chef de projet Avenir Commun Durable
Les cités-jardins sont nées d'une volonté à la fois politique et sociale de sortir les ouvriers anglais du système capitaliste qui les amassait dans des lieux de résidence souvent insalubres. En pleine révolution industrielle, l'urbaniste Ebenezer Howard publie To-morrow: a peaceful path to real reform (1898), ouvrage dans lequel il théorise la cité-jardin comme une ville avec peu d'habitations, où le foncier est géré par la municipalité, l'entrepreneuriat est soumis au vote des habitants, et qui subvient à ses propres besoins grâce à une agriculture qui lui est propre et des infrastructures publiques qui favorisent le loisir et la culture.
Entre les enjeux écologiques de préservation de la biodiversité et de création d'un mode de vie plus durable, et les enjeux sociaux d'amélioration de la qualité de vie et de création d'une communauté, la cité-jardin s'impose dans l'Europe du début du XXe siècle. Elle se veut une utopie salvatrice, innovatrice, et l'idéal d'une vie meilleure, voire d'un « paradis terrestre » (Georges Riser, « Les cités-jardins », 1909). Plusieurs années après l'apparition des premières cités-jardins, leur légitimité a commencé par faire débat, notamment par leur isolement spatial qui peut s'apparenter à un huis clos idéologique, ou encore par la remise en question de la durabilité écologique de ces modèles.
La table ronde « La cité-jardin revisitée : urbanisme durable au XXIe siècle », animée par des étudiants journalistes, propose de comprendre la cité-jardin, de la questionner et de débattre du phénomène d'un point de vue historique, mais aussi à travers un prisme actuel, qui croisera les questionnements politiques, sociologiques et éthiques de cet urbanisme durable, grâce à l'expertise de multiples invités.
-----
Dans le cadre de son engagement en faveur d'un avenir commun durable, le Collège de France propose un cycle de tables rondes réunissant des personnalités issues du monde académique, économique, associatif ou institutionnel, et des étudiants issus de l'enseignement supérieur.
Conçu comme un espace de dialogue structuré, ce cycle vise à permettre aux jeunes générations de questionner, comprendre et débattre des grands enjeux liés au changement climatique. Il s'inscrit dans une démarche de transmission des savoirs, mais aussi d'écoute active et de co-construction. Le Collège de France y joue un rôle de garant et de facilitateur, veillant à la qualité scientifique des échanges sans en orienter le contenu.
Chaque rencontre repose sur un principe fort : offrir aux étudiants d'Alma Mater, journal interuniversitaire, pluridisciplinaire et apartisan, une large autonomie dans la préparation et l'animation des échanges. Cette approche reconnaît leur légitimité à s'emparer des sujets qui concernent directement leur avenir, et valorise leur capacité à porter un regard exigeant, critique et engagé sur les transitions en cours.
Parce que les bouleversements climatiques appellent une réponse collective, intergénérationnelle et éclairée, Avenir Commun Durable ambitionne de créer les conditions d'un dialogue sincère, rigoureux et porteur de sens.
Sous le patronage des Prs Marc Fontecave, Dario Mantovani et Jean-Marie Tarascon.
L'initiative Avenir Commun Durable bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France, de ses grands mécènes la Fondation Covéa et TotalEnergies et de ses mécènes FORVIA et Saint-Gobain.