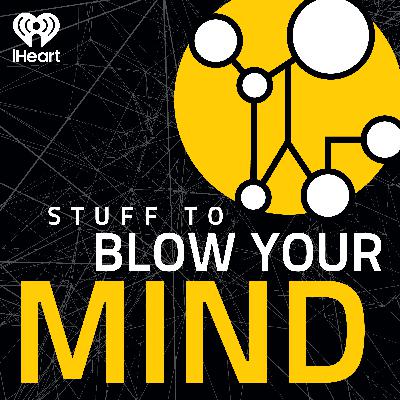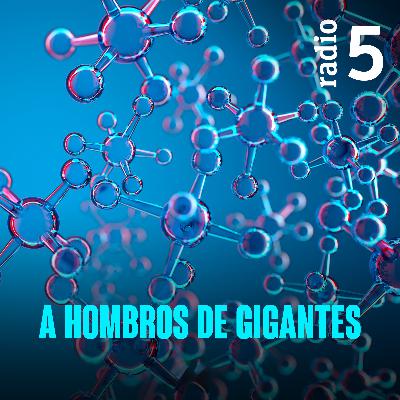Pourquoi y a-t-il toujours des mouches autour des yeux des chevaux ? - Choses à Savoir SCIENCES
Description
L’image est familière : en été, des mouches s’acharnent autour des yeux des chevaux. Ce n’est pas un simple hasard, mais le résultat d’une combinaison de facteurs biologiques, biochimiques et écologiques bien étudiés.
1. Des sécrétions lacrymales nutritives
Les larmes des chevaux ne sont pas de l’eau pure. Elles contiennent des protéines (notamment des lysozymes et des lactoferrines), des lipides, des sels minéraux et une fraction glucidique. Pour des mouches dites lacryphages (Musca autumnalis, Musca domestica ou Fannia spp.), ces sécrétions représentent une ressource énergétique et azotée de haute valeur. Une étude publiée dans Veterinary Parasitology (2007) a montré que la composition chimique des larmes attire spécifiquement les mouches des étables (Musca autumnalis), qui sont parmi les principaux nuisibles oculaires chez les équidés.
2. Des signaux chimiques et thermiques attractifs
Les mouches possèdent des récepteurs olfactifs très sensibles aux composés volatils. Or, les yeux et les zones périoculaires émettent des molécules organiques volatiles (acides gras, ammoniac, acide lactique) qui constituent de puissants attractifs. De plus, la température superficielle des yeux (environ 34–35 °C chez le cheval) fournit un gradient thermique qui guide les insectes vers cette zone riche en humidité.
3. Des vecteurs de pathogènes
Ce comportement a des implications sanitaires importantes. Les mouches oculaires sont des vecteurs mécaniques : elles transmettent agents infectieux et parasites en passant d’un individu à l’autre.
Elles propagent notamment la bactérie Moraxella bovis, responsable de la kératoconjonctivite infectieuse.
Elles participent aussi à la transmission de la thélaziose oculaire, une parasitose causée par des nématodes du genre Thelazia, retrouvés dans les conjonctives.
Une étude menée en Suisse (Kaufmann et al., Parasitology Research, 2013) a montré que la prévalence de Thelazia chez les chevaux pouvait atteindre 11 % dans des régions fortement infestées par les mouches.
4. Un comportement écologique adapté
Pour la mouche, le choix de l’œil est rationnel : la disponibilité constante de liquide, l’incapacité relative du cheval à s’en débarrasser efficacement, et le fait que ces insectes ne disposent pas de pièces buccales perforantes. Elles ne peuvent donc pas aspirer le sang comme les taons, mais dépendent de sécrétions corporelles accessibles, dont les larmes.
Conclusion
Si les mouches s’attroupent autour des yeux des chevaux, c’est à la fois pour des raisons nutritionnelles (accès à des sécrétions riches), chimiques (molécules attractives), écologiques (zone accessible) et pathologiques (transmission d’agents infectieux). Ce n’est pas une simple nuisance estivale : il s’agit d’un exemple concret d’interaction hôte–parasite–vecteur étudié en parasitologie vétérinaire.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.